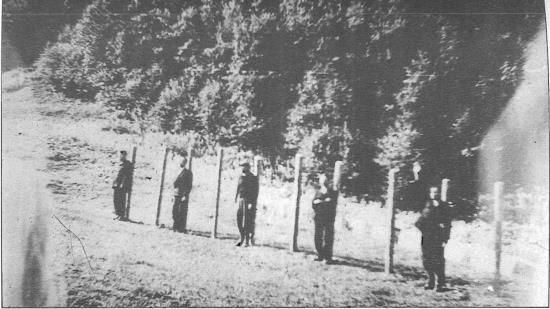Mythe et réalités de la Phalange (par Jean de Calatrava)
Cet article a été publié dans le numéro 13 de la revue Totalité.
Tenter de répondre à la question : « Qu’est-ce que la Phalange Espagnole ? », après une lecture attentive de la majorité des écrits qui lui sont consacrés, s’avère une entreprise fort décevante. Selon les sympathies ou les intentions de ses exégètes et de ses critiques, on déduira des interprétations différentes sinon opposées. La Phalange est une chose ou son contraire, en fonction de la personne qui prononce le mot. Il y a ceux qui prétendent que la Phalange et le Movimiento de Franco sont une seule et même chose et ceux qui, au contraire, soutiennent que la Phalange n’a rien à voir avec le Movimiento. Il y a ceux qui estiment que la Phalange n’a jamais occupé le pouvoir et ceux qui, au contraire, maintiennent qu’elle l’a toujours monopolisé. Il y a ceux qui affirment que le régime de Franco n’a rien mis en pratique de la théorie révolutionnaire nationale-syndicaliste et ceux qui déclarent qu’il l’a fait en partie. Il y a ceux qui pensent que la Phalange est autoritaire et ceux qui proclament qu’elle est démocratique. Il y a ceux qui voient dans la doctrine de la Phalange la synthèse classique du socialisme-national, qui l’apparente au fascisme, et ceux qui, à l’inverse, soulignent l’incompatibilité des composants doctrinaux du national-syndicalisme (philosophia perennis d’essence chrétienne) avec ceux du fascisme (vitalisme, hégélianisme, etc.).
À cela, des phalangistes ne manquent pas d’objecter que la lecture des prétendues ambiguïtés et contradictions de la Phalange, relevées par une pléiade d’exégètes, le plus souvent mal intentionnés, n’a guère d’intérêt. Néanmoins, nous lui reconnaîtrons un mérite incontestable. Celui de révéler une incompréhension radicale de la réalité nationale-syndicaliste qui a toujours pour origine une ignorance ou une occultation délibérée.
Répondre honnêtement à la question « Qu’est-ce que la Phalange ? » implique que l’on distingue immédiatement :
1°) « La Phalange de José Antonio », Phalange originelle et révolutionnaire qui va du 29 octobre 1933 au 20 novembre 1936.
2°) « La Phalange traditionaliste » ou « Phalange officialisée » qui est celle de la bureaucratie, des fonctionnaires et des contradictions, qui s’étale du décret d’Unification – 17 avril 1937 – à la disparition légale par la loi organique de l’État – 14 décembre 1966 –, enfin,
3°) « La Phalange proscrite », Phalange clandestine, dissidente ou mentale, née dès la mort de José Antonio et qui devient une réalité tangible après la condamnation à mort, le 5 juin 1937, de Manuel Hedilla.
Faute de pouvoir analyser chacune de ces trois dimensions1 dans le cadre restreint d’un article, rappelons brièvement l’évolution historique de la Phalange afin de mieux comprendre la nature et l’ampleur exacte de ses relations avec l’Espagne née du 18 juillet 1936.
La Phalange de José Antonio
Le 29 octobre 1933, le héros national de l’aviation, Julio Ruiz de Aida, le professeur de droit Alfonso Garcia Valdecasas et le jeune avocat madrilène José Antonio Primo de Rivera organisent un meeting au Théâtre de la Comédie de Madrid. Cet acte, qualifié vaguement « d’affirmation nationale », sera retenu par l’histoire comme date de fondation de la Phalange.
Au cours de son discours, José Antonio critique l’échec du libéralisme et déplore l’égarement du socialisme, désormais prisonnier du matérialisme marxiste. Son mouvement – dit-il – se présente comme un « anti-parti », ni de droite, ni de gauche, au-dessus des intérêts de groupes et de classes. Quant à ses moyens et à ses fins, ils seront avant tout :
– l’irrévocable unité de destin de l’Espagne,
– la disparition des partis politiques,
– le respect des valeurs éternelles de la personne humaine,
– la participation du peuple au pouvoir au travers des entités naturelles que sont la Famille, la Commune et le Syndicat,
– la défense du travail de tous et pour tous,
– le respect de l’esprit religieux « clef de voûte de l’histoire de l’Espagne », mais en distinguant l’Église de l’État,
– la restitution à l’Espagne du sens universel de sa culture et de son histoire,
– la violence, si nécessaire, mais, seulement après avoir épuisé tous les autres moyens : « Il n’y a pas d’autre dialectique admissible que celle des poings et des revolvers quand on porte atteinte à la Justice et à la Patrie »,
– enfin, une nouvelle manière d’être : « Il faut adopter devant la vie entière l’esprit de service et de sacrifice, le sens ascétique et militaire de la vie ».
À peine née, la Phalange se lance dans une première campagne électorale. Le 19 novembre, elle se retrouve pourvue de deux sièges aux Cortès : Primo de Rivera et Moreno Herrera. Parallèlement, des pourparlers sont engagés avec divers représentants des JONS.
Les JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) sont un groupement constitué deux ans plus tôt, le 30 novembre 1931, à l’instigation d’un jeune intellectuel de 26 ans, Ramiro Ledesma Ramos. Parmi les fondateurs des JONS, on retrouve, outre Ramiro Ledesma Ramos, la majorité des rédacteurs de l’hebdomadaire La Conquista del Estado (mars-octobre 1931) et, à Valladolid, le fondateur de la Junta Castellana de Actuacion Hispanica : Onesimo Redondo.
Les membres des JONS viennent de positions idéologiques diverses, en général de la gauche révolutionnaire anarchiste ou marxiste. Une déception commune en face des différentes attitudes des partis révolutionnaires et une volonté identique de « resituer l’Espagne dans l’Histoire » les réunissent. Ils se trouvent en outre rapprochés par un même rejet du système capitaliste et des défauts du parlementarisme. Tous enfin sentent la nécessité d’un changement total des structures sociales à partir d’un principe directeur.
Les voies parallèles, l’enthousiasme juvénile des militants, la projection révolutionnaire tant de la Phalange que des JONS conduisent les deux mouvements à se rapprocher. Le 13 février 1934, les négociations aboutissent. Elles donnent naissance à un nouveau mouvement : FE de las JONS. Devises et symboles des JONS sont adoptés par la nouvelle entité : les slogans « Arriba Espana ! Espana Una Grande y Libre ! », « Por la Patria, el Pan y la Justicia ! » et le drapeau rouge et noir des anarchistes avec au centre l’emblème : le faisceau de cinq flèches (blason d’Isabelle Ire de Castille) croisé par un joug (blason de Ferdinand V d’Aragon). L’appellation « camarade » et le tutoiement sont de rigueur. La chemise bleue, « couleur nette, sérieuse et prolétaire », sera choisie personnellement par José Antonio. Enfin, la fusion est parachevée par la désignation de triumvirats exécutifs dans toutes les provinces et d’un exécutif national à Madrid, formé par José Antonio, Ramiro Ledesma Ramos et Julio Ruiz de Aida.
Huit mois plus tard, début octobre 1934, le premier Conseil national de la Phalange élit José Antonio Chef national à la majorité des voix. Élu pour trois ans, conformément aux statuts, il a alors 31 ans. Les séances du Conseil seront écourtées. Dehors la révolution socialiste a éclaté dans toute l’Espagne et la Généralité de Catalogne s’est soulevée. Dans la nuit du 6 octobre, les conseillers retournent précipitamment dans leurs provinces respectives. Ils doivent contrôler la participation et l’organisation à la lutte contre l’insurrection.
En novembre, les membres du Comité exécutif rédigent un projet de programme du Mouvement pour répondre au vœu du Conseil national. Ledesma Ramos articule l’ensemble et le transmet à José Antonio, qui se charge de la rédaction définitive. Les fameux 27 points sont bientôt publiés dans toute l’Espagne.
À cette époque, la police perquisitionne les locaux phalangistes sous le moindre prétexte. La révolution socialiste d’octobre vaincue, la Phalange apparaît comme un redoutable compétiteur aux yeux de la droite conservatrice et libérale. Celle-ci, qui est alors au pouvoir, va s’employer à l’affaiblir. Tout au long de l’année 1935, une série interminable de fermetures de locaux, d’interdictions de réunions, de refus de légaliser les sections provinciales, de suspensions et de censures de presse frappera la Phalange. En réponse, les organes nationaux-syndicalistes réserveront leurs polémiques les plus dures à l’usage de la coalition gouvernementale Cedo-radicale.
En janvier 1935, la Phalange doit faire face à de sérieuses difficultés. Ledesma Ramos et une minorité de jonsistes quittent le parti. À l’origine des griefs de Ledesma, il y a l’insurrection socialiste et séparatiste d’octobre 1934. Il reproche à José Antonio de n’avoir pas été capable de lancer ses troupes à l’assaut du pouvoir. D’accord sur les fins, les deux hommes s’opposent sur les moyens. Pour l’un, « il faut se lancer dans la lutte quel que soit le résultat », pour l’autre, « il faut d’abord convaincre ». José Antonio se méfie de la démagogie révolutionnaire de Ledesma et ce dernier lui reproche ses doutes, ses scrupules, ses hésitations, son manque d’allant révolutionnaire. Le conflit d’abord latent, puis ouvert, se solde, le 15 janvier, par l’exclusion de Ramiro Ledesma et d’un petit groupe de ses fidèles. Une réconciliation entre les deux hommes suivie d’une nouvelle collaboration n’interviendront qu’en mai 1936.
José Antonio sort indemne et renforcé de la scission. Tirant les leçons de l’expérience, il accentue les préoccupations sociales et révolutionnaires de son mouvement. « Primo de Rivera – constate Ramiro Ledesma – sut avec intelligence tirer les enseignements de ce révulsif. Ce qui lui permit […] de reprendre à son compte les propositions des éléments scissionnistes. » « Il insista avec plus de force que jamais sur les consignes du jonsisme, se faisant leur meilleur propagandiste. Dans ses discours, il accentua son caractère anti-réactionnaire et juvénile […]. Il épura son mouvement des phalangistes les plus ineptes de la première heure, et accentua la consigne d’un syndicalisme national. »
Dans le même temps, l’enthousiasme de José Antonio pour le fascisme italien semble diminuer. Dans ses discours, il met régulièrement en cause la valeur de l’un des piliers du système fasciste : les corporations. À l’inverse, il développe l’idée d’un syndicalisme total fonctionnant organiquement sans comités paritaires. Cette aspiration repose essentiellement sur « l’assignation de la plus-value, non au capitaliste, ni à l’État, mais au producteur encadré dans ses syndicats ». « Contre le critère capitaliste qui assigne la plus-value au capital, dit-il, nous défendons le critère syndicaliste de la plus-value pour la communauté organique des producteurs. » Il faut donc « substituer au capitalisme la propriété familiale, communale et syndicale ». Enfin, deux réformes sont nécessaires : « celle du crédit par la nationalisation des services de la Banque et une réforme agraire installant révolutionnairement – c’est-à-dire avec ou sans indemnisation – la population paysanne espagnole en unités familiales et syndicales selon la nature des terres ».
En décembre 1935, le cabinet Portela Valladares ne peut éviter la septième crise ministérielle de l’année. Il doit se résoudre à la dissolution des Cortès. À la veille des élections, José Antonio tente vainement de rompre l’isolement de la Phalange dû à l’hostilité conjointe de la gauche et de la droite. À trois reprises, durant la campagne, il visite le chef de la CEDA : Gil Robles. Ce dernier expliquera l’échec des négociations par le caractère excessif des demandes phalangistes (25 à 30 candidatures). En réalité, il est heureux d’écarter de la vie politique le chef de la Phalange. Il ne lui pardonne pas ses critiques féroces contre son action au pouvoir.
L’échec des pourparlers laisse la Phalange en dehors du « Bloc national », coalition anti-révolutionnaire comprenant la CEDA (démocratie chrétienne présidée par Gil Robles), Rénovation espagnole (monarchiste de Calvo Sotelo), la Communion traditionaliste (carlistes de Fal Condé), les Agrariens, les Radicaux (de Lerroux) et les Républicains conservateurs (de Miguel Maura). Notons bien la composition de ce « Bloc national » ! Cinq mois plus tard, il constituera l’essentiel des forces civiles qui soutiendront le soulèvement du 18 juillet 1936.

Les phalangistes, sans illusions sur leurs possibilités électorales, présentent une vingtaine de candidats. Ils obtiendront un peu moins de 45 000 voix. Sans doute la majorité des militants, qui a moins de vingt ans, n’a pu voter, mais ce chiffre donne une idée du caractère marginal de la Phalange. Dès le début, la trajectoire historique de la Phalange est conditionnée par l’absence d’une base importante. À sa naissance elle compte 2 000 à 3 000 membres. Trois ans plus tard, à la veille des élections, l’effectif total n’excède guère 15 000. Surgissant dans l’arène politique alors que les fronts idéologiques sont clairement délimités, la Phalange apparaît condamnée à demeurer une minorité activiste ou à intégrer un bloc plus représentatif. La fidélité à son programme idéologique exige nécessairement son isolement. Inversement, le développement de sa base implique la renonciation ou la modification de ses objectifs doctrinaux. Poursuivre à la fois la fidélité au programme et l’audience populaire est quasiment irréalisable en 1935 et 1936. Or, si l’on ne tient pas compte de ce dilemme, on se condamne à ne rien comprendre à l’histoire du mouvement phalangiste.
Cependant, on aurait tort de chercher la raison de la faiblesse des effectifs de la Phalange dans l’absence de toute attraction de ses idéaux sur les secteurs prolétariens. Le ralliement d’une série de leaders d’extrême gauche témoigne bien du contraire. Alvarez de Sotomayor, Guillen Salaya, Olalla, Llorente sont tous d’anciens leaders et membres de la Centrale anarchiste ; Guitarte, Quesada, Garcia Vara, Rivas Villar, Montera Diaz sont d’anciens responsables des jeunesses communistes. Le leader de la CONS (Central Obrera Nacional-Sindicalista, Centrale ouvrière nationale-syndicaliste), Manuel Mateo, était membre du Comité central du Parti communiste espagnol en 1931-19322. L’écrivain phalangiste Maximiano Garcia Venero souligne non sans raison : « Dialectiquement, il n’est pas acceptable que le seul angle d’observation d’un mouvement politique et social soit celui de l’importance numérique. L’Histoire contemporaine est féconde en mouvements qui commencèrent avec une base numérique dérisoire ». La première Internationale fut constituée par cinquante hommes… En février 1917, après plus de cinq ans d’existence, le Parti bolchevik avait une base numérique insignifiante : elle ne dépassait guère les 20 à 25 000 membres. En 1905, après dix-sept ans d’existence, aux élections, les voix obtenues par le parti socialiste espagnol s’élevaient à peine à 26 000. Or, au début de l’année 1936, la Phalange venait juste de célébrer son troisième anniversaire…
Dès son entrée en fonction, le gouvernement Azana, du Front populaire, décide la clôture de tous les centres de la Phalange et la suspension de ses publications. Le 14 mars, José Antonio est incarcéré. Il ne recouvrera plus jamais la liberté. Sous la pression du gouvernement, il subira une interminable série de procès dont le seul but est de le maintenir en prison. Incarcéré quatre mois avant le soulèvement, il n’en sera pas moins condamné à mort par un « tribunal populaire », aux ordres du gouvernement, pour conspiration et rébellion militaire.
Le 14 mars, en quelques heures, la quasi-totalité des membres du Comité exécutif de la Phalange est emprisonnée. La répression s’étend ensuite à toute la province. Elle touchera près de 2 000 militants. Le jour même de sa détention, José Antonio vainc ses derniers scrupules et déclare une guerre totale au Front populaire : « La lutte n’est plus entre droite et gauche alternant au pouvoir […] – écrit-il dans un manifeste remis à son frère –. Aujourd’hui deux conceptions totales du monde s’affrontent ; celle qui vaincra, interrompra définitivement l’alternance accoutumée : ou la conception spirituelle, occidentale, chrétienne, espagnole, avec ce qu’elle suppose de sacrifice, mais aussi de dignité individuelle et politique, vaincra, ou vaincra la conception matérialiste, russe, de l’existence […]. »
Début mai, le Congrès ayant annulé les élections de plusieurs députés, de nouvelles élections sont organisées dans quelques circonscriptions. Des amis de José Antonio décident de présenter sa candidature à Cuenca. Vu la tournure des événements, son prestige s’est considérablement accru et il a désormais toutes les chances de polariser l’ensemble des voix de la droite. Aussitôt, sans le moindre scrupule, le gouvernement réagit et ordonne de ne pas comptabiliser les voix des candidats qui ne se sont pas présentés au soi-disant « premier tour ». La dernière chance de sortir José Antonio de prison s’évanouit.
En dépit de multiples mesures répressives du Front populaire, le nombre des affiliés de la Phalange ne cesse d’augmenter. Les jeunes des JAP (démocrates-chrétiens) rejoignent en masse les rangs de la Phalange. En peu de temps le nombre des militants passe de 15 000 à 50 000 début juin. Ils seront 150 000 fin juillet et 500 000 en octobre de la même année.
Le débordement par la droite devient l’obsession de José Antonio. Il multiplie les mises en garde à l’usage des cadres : « La Phalange n’est pas une force conservatrice – écrit-il le 20 juin – […] À gauche, on nous assassine […] Le gouvernement du Front populaire nous asphyxie. Mais attention, camarades, tout le danger n’est pas à gauche. Il y a encore des gens à droite […] ne suscitant en nous que colère et dégoût, qui croient encore que la mission de la Phalange est de mettre à leurs ordres de naïfs combattants […] Nous ne serons l’avant-garde, ni la force de choc, ni l’auxiliaire d’aucun mouvement confusément réactionnaire. Nous préférons même la claire lutte d’aujourd’hui à l’apathie d’un conservatisme vulgaire qui renaîtrait au profit de réactionnaires ambitieux ». Dans une circulaire du 24 juin il insiste : « […] Que tous nos camarades sachent combien il est offensant pour la Phalange d’être invitée à prendre part comme comparse à un mouvement qui ne mènerait pas à l’État national-syndicaliste […], mais restaurerait une médiocrité bourgeoise conservatrice (comme l’Espagne en a trop connu) embellie, pour plus de dérision, par l’accompagnement chorégraphique de nos chemises bleues ».
Fermement décidés à se soulever avec l’Armée, José Antonio et les principaux leaders de la Phalange s’inquiètent de l’influence grandissante des autres secteurs du complot. Un membre du Comité exécutif, Manuel Valdès Larranaga, témoignera des années plus tard : « […] à mesure que des groupes étrangers à la Phalange prenaient part à ce que l’on peut appeler le “Mouvement”, il y eut un secteur de la direction qui pensait que nous devions nous abstenir de participer »… La méfiance et le doute ne quittent plus José Antonio, qui écrit le 12 juillet : « Une des choses redoutables serait “la dictature nationale républicaine” […] qui chercherait à feindre une prospérité économique sans rien construire sur des bases profondes. À la fin du cycle de bien-être fébrile, une grande crise surviendra, trouvant un peuple, spirituellement démantelé, incapable de résister au dernier assaut décisif communiste […] Une autre expérience trompeuse que je redoute est l’implantation violente d’un faux fascisme conservateur, sans volonté révolutionnaire, ni sang jeune ».
L’accord définitif de la Phalange avec les militaires intervient les derniers jours du mois de juin. Celle-ci pactise exclusivement avec les militaires et compte sur eux pour éviter d’être débordée par les autres forces du complot. Enfin, l’action est envisagée comme un coup de force, en aucun cas comme une guerre civile sanglante et prolongée. Or, l’Espagne de 1936 est un pays où la guerre civile est devenue inévitable. La vie de la communauté nationale est désormais impossible. Un long processus de détérioration des rapports sociaux débouche inexorablement sur une lutte implacable entre le peuple et l’armée contre une autre partie du peuple et de l’armée, entre l’Espagne catholique, traditionnelle et spirituelle contre l’Espagne laïque, anarcho-communiste et matérialiste3.
La Phalange se voit donc emportée malgré elle dans une lutte qui la détourne de sa vocation initiale. Ce qui la convertit en un mouvement anti-révolutionnaire, ce n’est pas son programme, mais le fait d’accepter de se soumettre aux directives globales de la droite. À partir de cet engagement historique, le phalangisme est redéfini. Jusque-là, la Phalange de José Antonio se caractérisait par une doctrine antithétique se mouvant entre la droite et la gauche, entre nationalisme et socialisme. Tout le futur de la Phalange sera ensuite conditionné par son rôle nécessaire dans le 18 juillet 1936.
La Phalange et l’Espagne du 18 juillet 1936 :
Déjouant les espoirs de toute une partie de l’Espagne, le soulèvement est un semi-échec. Les forces nationales ne peuvent compter que sur la moitié des effectifs de l’armée (83 000 hommes sur 170 000) dont, à l’échelon des officiers, 50 % des généraux, 30 % des colonels et lieutenants-colonels et 80 % des jeunes officiers capitaines et lieutenants4. Dès le lendemain du soulèvement, la Phalange connaît des heures particulièrement difficiles. L’historien Hugh Thomas constate : « Il n’y avait pas un seul parti, chez les vaincus de la guerre civile, qui eut subi une hécatombe comparable à celle de la Phalange ». À Madrid, la majorité du Comité politique, prisonnière des républicains, ne tarde pas à périr. En quelques mois tous les principaux leaders trouvent la mort. Onesimo Redondo tombe dans une embuscade le 24 juillet, Julio Ruiz de Aida est assassiné en prison le 23 août, Manuel Mateo est « liquidé » par un commando communiste en septembre, Ledesma est abattu d’une balle dans la tête le 29 octobre, José Antonio est fusillé le 20 novembre après une parodie de procès… Environ 60 % des « vieilles chemises » périssent au cours du conflit.
Le 21 novembre, le IIIe Congrès national de la Phalange se réunit à Salamanque. Informé de la mort récente de José Antonio, il n’en décide pas moins de confirmer les pouvoirs d’un Comité exécutif provisoire de cinq membres, présidé par Manuel Hedilla. La difficulté essentielle à laquelle ne tarde pas à se heurter le Comité naît de sa volonté naturelle de s’affirmer en tant que direction indépendante des forces militaires. Les militaires veulent que les volontaires des milices nationales soient de simples soldats disciplinés, état excluant toute expression politique. De graves frictions ne manquent pas de se produire. D’autant plus que certains s’emploient à envenimer ces relations, développant une campagne de discrédit contre l’action de la Phalange. Les phalangistes sont appelés par les partis de droite « FAIO-langistas » en jouant sur le sigle de la Fédération anarchiste ibérique ou encore « nos rouges ». On leur reproche de nourrir leurs effectifs de tous les gens de gauche, anarchistes, socialo-communistes désireux d’échapper aux poursuites. Les journaux phalangistes ne proclament-ils pas inlassablement : « Notre parti est ouvert à tous les camarades désireux de sauver la Patrie » ? Toutes ces accusations ne manquent pas d’alarmer les autorités militaires qui ne veulent voir dans la Phalange qu’une force auxiliaire…
Au printemps, le Conseil national, soucieux de bien marquer son indépendance, décide, enfin ! d’élire un second Chef national. Le 18 avril 1937, dès le début de la session, Manuel Hedilla informe les conseillers qu’il a de bonnes raisons de croire que le général Franco s’apprête à assumer la direction de la Phalange. L’élection risque d’être perçue comme une provocation par l’état-major. Néanmoins, après délibération et mûre réflexion, la majorité des conseillers élit Manuel Hedilla second Chef national de la Phalange.
Hedilla conservera sa charge fort peu de temps. Le lendemain, 19 avril, un courrier du Quartier général lui remet une volumineuse enveloppe contenant le texte du discours que prononcera le chef de l’État à Radio nationale. Il s’agit du décret d’« Unification » déclarant la fusion de la Phalange espagnole des JONS et de la Communion traditionaliste. Moins d’un mois plus tard, les monarchistes d’Action espagnole et de Rénovation espagnole sont inclus dans l’Unification par disposition spéciale. Enfin, en avril, Gil Robles remet l’organisation et les milices des JAP et de la CEDA (démocratie chrétienne) dans les mains du Caudillo.
Les milieux phalangistes n’estiment pas suffisantes les garanties accordées par l’Unification ; ils ne peuvent pour autant réagir avec profit. Seul Franco inspire confiance à ceux qui soutiennent économiquement les armées nationales. Aux yeux des conservateurs, Hedilla et ses « vieilles chemises » ne sont que de « dangereux démagogues » tolérés dans la mesure où leur action reste limitée.
Deux voies s’ouvrent alors aux phalangistes : refuser tout compromis par fidélité à l’idéal – ce qui ne gênerait en rien l’entreprise de captation de la Phalange, l’immense majorité des néo-phalangistes étant plus franquiste que nationale-syndicaliste – ou accepter le fait accompli comme irréversible et choisir la voie de la participation afin de sauver du programme ce qui peut l’être.
Hedilla adoptera la première solution. À trois reprises, tentant de le séduire, des représentants de l’état-major lui proposent le Secrétariat général de la « Phalange traditionaliste ». Devant son refus, ils finissent par le placer devant l’alternative : le Secrétariat ou la prison. Le 25 avril 1937, la menace est mise à exécution. Accusé de rébellion, Manuel Hedilla comparaît, les 5 et 7 juin, devant deux conseils de guerre, en même temps qu’une vingtaine de phalangistes. Cinq accusés – dont Hedilla – seront condamnés à mort, les autres à des peines allant de deux ans de prison correctionnelle jusqu’à la réclusion à perpétuité5.
Dans l’ensemble, l’Unification est accueillie avec joie dans le camp nationaliste. Parmi les phalangistes qui l’admettent, bon gré mal gré, certains, comme le Dr Perales Herrero, s’en expliquent : « Beaucoup, parmi nous, pensaient que nous n’avions pas le droit de mettre en péril le sort de la guerre, ni la vie et la liberté de nos camarades […] Nous démontrâmes par là notre patriotisme et notre ingénuité […] ».
Cette compromission phalangiste avec le régime de Franco, qu’incarnent Pilar Primo de Rivera, José Antonio Giron et Raimundo Fernandez Cuesta, ce dernier la défend, lorsqu’il juge l’action des phalangistes dissidents : « Selon moi, cette attitude, respectable et si l’on veut esthétique, est politiquement inefficace, stérile, parce qu’elle ne sert qu’à abandonner des positions que d’autres se chargent vite d’occuper. En politique, il faut être présent ou se résigner à l’oubli. »
Après la condamnation de Manuel Hedilla, des foyers phalangistes plus ou moins en désaccord avec la Phalange officielle de Franco, ne cessent jamais d’exister. Tous les deux à trois ans, de petites révoltes éclatent, mais avortent toujours de la même façon. Dans l’Espagne de l’après-guerre civile, il ne saurait en être autrement. Le Caudillo et son régime ont, par la force d’attraction des causes triomphantes, un crédit d’opinion comme il en a très rarement existé. La nouvelle Phalange traditionaliste comptera jusqu’à 2 millions d’affiliés, dont 600 000 femmes.
À la fin de 1937, des éléments non identifiés se réclament de la FEA (Falange Espanola Autentica) clandestine. L’éphémère FEA ne réunit qu’une poignée d’hommes. Plus sérieusement, en 1940, un Comité clandestin phalangiste fonctionne à Madrid. Il compte sur l’appui du Général Yagüe, ardent phalangiste, pour écarter Franco du pouvoir et instaurer un régime national-syndicaliste. Découvert en mars 1941, le réseau est immédiatement dissous. Les conspirateurs se regroupent alors au sein de l’ORNS (Ofensiva de Recordo Nacional-Sindicalista) sous la direction d’Eduardo Ezquer. Ce dernier sera emprisonné six fois et comparaîtra cinq fois devant les tribunaux, sans que cela n’entame jamais sa résolution.
Il faut ensuite attendre les années cinquante pour assister à de nouvelles tentatives d’organisation de la Phalange proscrite. Naissent alors successivement l’Associacion 18 de Julio, les Juntas de Accion Hispanica, les Juntas de Accion Nacional-Sindicalistas et les Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas. Une agitation quasi permanente est également entretenue dans plusieurs centuries de la Guardia de Franco. Enfin, des foyers d’idéalisme phalangiste renaissent dans les Falanges Universitarias. Ces dernières seront à l’origine des Cercles Marzo dont les autorités ne tarderont pas à suspendre les publications et à fermer les locaux.
En 1959, après l’avènement au pouvoir des technocrates de l’Opus Dei, 1 500 phalangistes de Madrid créent les Cercles José Antonio. De 10 à 12 cercles au départ, on en compte bientôt 82 réunissant plus de 50 000 membres. Luttant contre la « falsification du national-syndicalisme par l’appareil officiel », les Cercles José Antonio sont tolérés par le gouvernement, mais leur revue Es Asi, extrêmement critique, est rapidement interdite.
En novembre 1961, afin de redonner vie au courant phalangiste ouvrier, le cercle Manuel Mateo est constitué. Il organise des conférences et participe activement à la création des premières Commissions ouvrières. Ses activités, jugées subversives, lui valent d’être définitivement fermé en 1966.
Enfin, en 1975, la mort de Franco sonnera le glas du Mouvement national. Une minorité de « phalangistes officiels », fidèle à l’idéal national-syndicaliste, rejoindra dans la dissidence ses adversaires d’hier6. Quant à l’immense majorité des cadres militants, elle se ralliera très vite au nouveau régime et soutiendra sans condition l’action de démantèlement du franquisme de l’ex-secrétaire général du Movimiento, devenu premier ministre par décision du Roi : Adolfo Suarez.
À l’heure du bilan, on retiendra que le destin de la Phalange fut d’être confronté – lors de circonstances exceptionnelles – au problème de la ligne de partage entre son projet révolutionnaire et son projet possibiliste. À partir de 1937, la FET ou Mouvement national, alliance des droites en vue de maintenir un ordre conservateur, utilise le langage, les symboles, la rhétorique phalangiste, mais n’a plus rien à voir avec le mouvement jeune et dynamique de José Antonio. Certains phalangistes de la première heure parviennent – à titre individuel – au pouvoir, mais alors ils le partagent, dans des proportions variant selon les moments, avec les représentants d’autres tendances ayant participé au soulèvement national. À l’échelon gouvernemental, sur 114 ministres du Caudillo, 7 seront phalangistes7. Leur action consistera à maintenir, avec plus ou moins de succès, une demande à caractère social et à freiner les appétits de l’oligarchie capitaliste. La quasi-totalité de l’œuvre sociale du régime de Franco sera d’ailleurs le produit de leur action politique8.
Mais les phalangistes seront toujours le même secteur du gouvernement : le secteur « social » ; celui qui tient compte des demandes, et jamais celui qui recueille ou administre l’argent, celui qui définit les lignes de la politique économique et budgétaire. À part le Secrétariat général du « Movimiento » et des Syndicats, les phalangistes s’occuperont seulement, avec une certaine exclusivité, des portefeuilles du Travail, du Logement et en partie de l’Agriculture, qui sont des ministères pauvres dans l’échelle de la stratification bureaucratique.
En 1975, à la veille de la mort du Caudillo, l’Espagne n’est en rien comparable à celle de 1936. L’Espagne franquiste a réalisé avec succès, pendant près de 40 ans, une série de réformes de structures qui ont arraché le pays au sous-développement économique et l’ont hissé au neuvième rang des nations industrialisées. Cela, seul l’aveuglement passionnel conduit à le nier ! Mais un simple regard sur la réalité socio-politique permet de constater qu’il n’y a pas eu de révolution nationale-syndicaliste. Celle-ci supposait non le perfectionnement d’un ordre existant, le libéralisme capitaliste, mais son remplacement par un autre ordre fondé sur des principes distincts. Comment nier que les idées essentielles du national-syndicalisme soient restées inédites : la désarticulation du système capitaliste par l’assignation de la plus-value du travail au syndicat, la nationalisation du crédit et la création de formes communautaires de propriété tant syndicales que communales ; la profonde réforme agraire afin d’abolir latifundia et minifundia ; l’essai de synthèse de la dichotomie politique… ?
Enfin et surtout, dans la dialectique nationale-syndicaliste, la société du bien-être matériel, désirable et recherchée, ne peut être une fin en-soi, mais seulement un moyen pour parvenir à la société du bien-être moral, seul but véritable. « Nous voulons implanter une justice sociale profonde – répétait José Antonio – pour que sur cette base les peuples retournent à la suprématie du spirituel. » On ne saurait mieux mesurer l’écart qui sépare l’Espagne rêvée par le jeune leader de la Phalange de celle d’aujourd’hui.
Jean de Calatrava
____________________________________
1 Pour une étude approfondie et documentée on se reportera à l’ouvrage d’Arnaud Imatz, José Antonio et la Phalange Espagnole, Paris, 1981, éd. Albatros.
2 Notons au passage les rapports de José Antonio avec le célèbre leader anarcho-syndicaliste Angel Pestana, et ses contacts avec l’un des principaux représentants de la fraction non marxiste du Parti socialiste, Juan Negrin.
3 À l’usage des victimes de la désinformation qui douteraient de cette interprétation « trop simpliste », nous rappellerons quelques témoignages édifiants : M. Sanchez Albornoz (chef du gouvernement en exil à Paris de 1962 à 1971) : « Si nous avions gagné la guerre, le communisme se serait installé en Espagne. On s’étonnera de lire que je ne désirais pas gagner la guerre civile, mais Azana ne le souhaitait certainement pas non plus, car nous aurions dû quitter l’Espagne ». (Arriba, 4 avril 1975).
W. Churchill : « Franco a entièrement raison, parce qu’il aime sa Patrie. En outre, Franco défend l’Europe du péril communiste » (La Nacion, Buenos Aires, 14 août 1938).
Dr Gregorio Maranon (co-fondateur de l’Association des intellectuels au service de la République)… « “Je défends les rouges parce que je suis communiste” ou “je sympathise avec les nationaux parce que je suis ennemi du communisme”. Voilà le nœud du problème » (Libéralisme et Communisme, Paris, 1961, NEL, p. 16). Nous ne pouvons – faute d’espace – reproduire les témoignages dans le même sens des plus prestigieux intellectuels espagnols de l’époque : Ortega y Gasset, Perez de Ayala, Unamuno, Pio Baroja, Manuel de Falla, José Maria Sert, Azorin, Andrés Segovia, Gutierrez Solano, Garcia Morente, Menendez Pidal, Ignacio Zuloaga, Manuel Machado, Jacinto Benavente, Peman, Dali, etc. N’en déplaise aux « écrivains d’histoire » qui prétendent que tous les intellectuels soutenaient le Front populaire, à l’heure de citer des noms, seuls Antonio Machado, Alberti, Pablo Casais, Duperier et Picasso reviennent inévitablement sous leurs plumes !
4 En 1939, l’armée nationale comptera 550 000 hommes dont 100 000 dans les « milices nationales » (phalangistes : 75 000, carlistes-requetés : 25 000).
5 Gracié 40 jours plus tard, Hedilla est emprisonné jusqu’en juillet 1941. Il sera ensuite confiné à Palma de Majorque. Libéré en avril 1946, ses antécédents pénaux seront radiés le 14 mai 1953.
6 Rappelons au passage qu’il convient aujourd’hui de distinguer nettement : FE de las Jons de R. Fernandez Cuesta et D. Marquez Horrillo (qui revendique l’orthodoxie nationale-syndicaliste) de Fuerzo Nueva de Blas Pinar qui incarne, non sans succès, l’esprit de la Phalange traditionaliste née du décret d’Unification.
7 Raimundo Fernandez Cuesta, Juan Yagüe, Rafaël Sanchez Mazas, Miguel Primo de Rivera, José Antonio Giron, José Luis de Arrese et Fermin Sanz Orrio.
8 Citons plus particulièrement : la création de Centres de formation professionnelle, la politique des salaires, la sécurité sociale, l’hygiène du travail, la participation aux bénéfices de l’entreprise, la stabilité de l’emploi, les logements, l’Université du travail, les comités d’entreprises, la juridiction du travail, les congés payés, les coopératives, le crédit populaire.





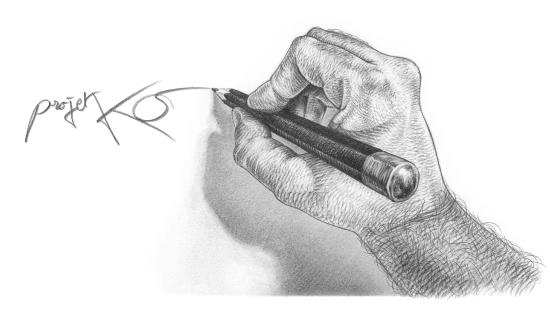


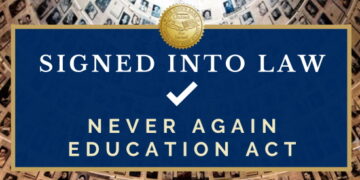














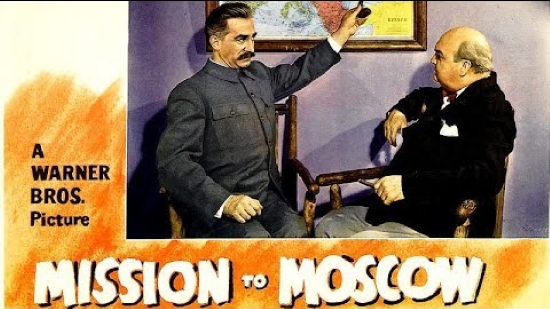



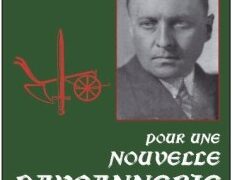


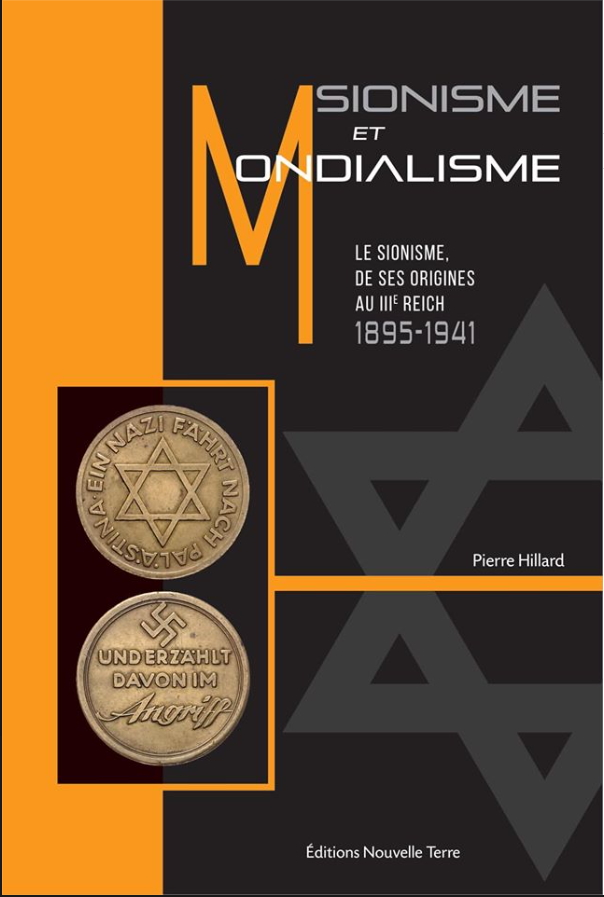
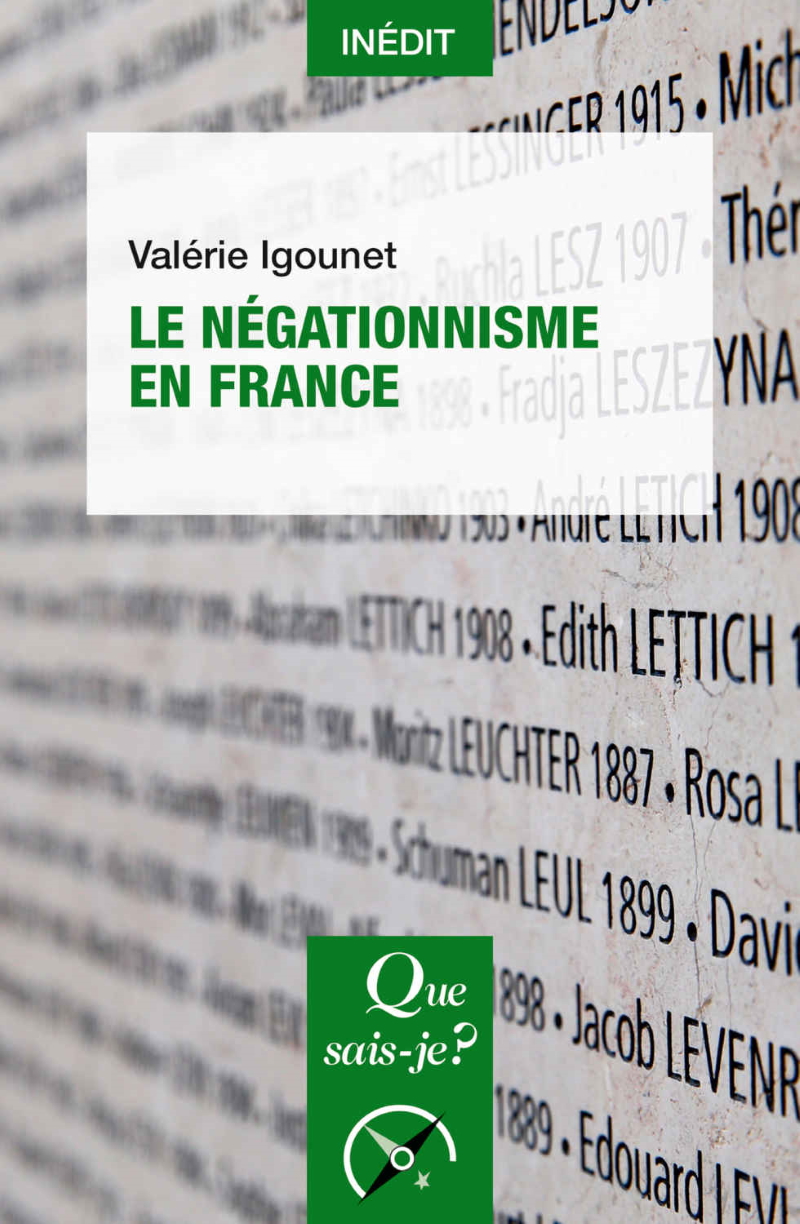



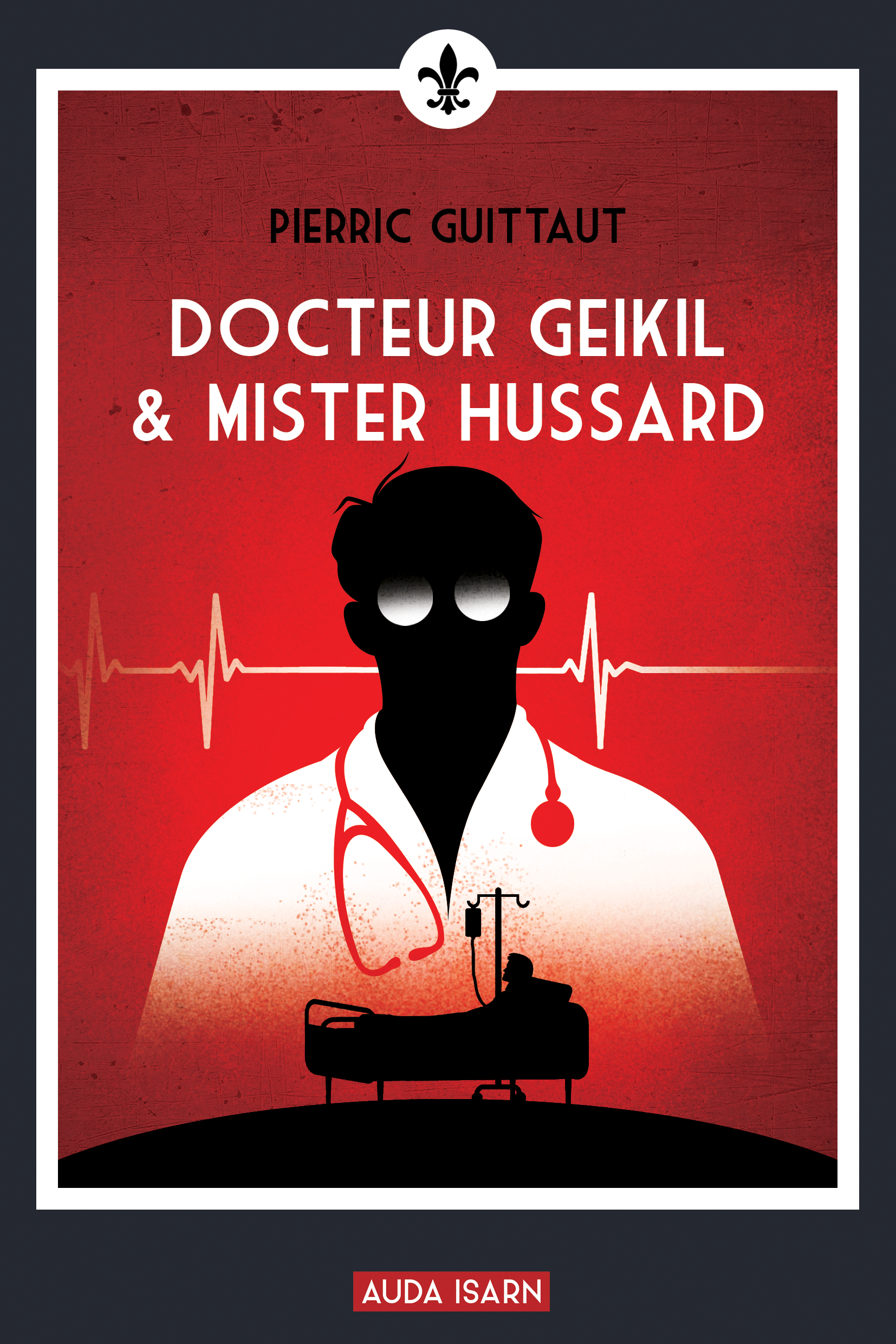









 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV