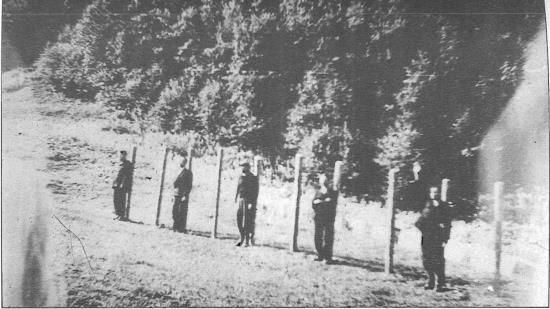Louis-Ferdinand Céline : confiné au Danemark !
à Olé Seyffart Sørensen.
Louis-Ferdinand Céline et son épouse Lucette ont résidé en semi- clandestinité entre les quatre murs d’une masure située dans un coin reculé du Danemark.
Pourquoi au Danemark ? Dans le contexte troublé de l’Après Guerre, les vainqueurs exécutaient à tour de bras ceux qu’ils avaient désigné comme ennemis de la démocratie. Et une balle tirée dans le dos était le plus sûr moyen de rétablir l’État de droit et la Liberté. Céline le proscrit, l’antisémite, la raciste figurait bien évidemment sur la liste noire. Peu importe si ses romans d’avant-guerre firent chavirer le cœur de tout un peuple ; peu importe s’il mit son talent de médecin à soigner les plus humbles. Il fallait que Céline paie pour des mots écrits sur du papier. Et il fallait qu’il le paie de sa vie.
La providence aida sans doute Céline a échapper aux mains des démocrates. La providence et l’intuition de Lucette. C’est elle l’Ariane qui tendit le fil dans le labyrinthe. L’Allemagne à feu et à sang, les trains de réfugiés, puis le royaume du Danemark, la fin du cauchemar ? Du moins presque. Après un procès et quelques années de prison, le couple trouva refuge dans une maison de campagne. Quelle bonne idée d’avoir gardé « confiné » notre grand écrivain dans un recoin isolé du Danemark ! Un geste sans doute salvateur qui honore Mikkelssen – l’avocat de Céline – pour l’éternité. Néanmoins, même dans ce recoin préservé des haines françaises, Céline vécu dans la crainte permanente qu’un démocrate plus zélé que les autres ne vienne lui trouer la peau avec son revolver.
Soixante dix ans plus tard, nous aussi sommes « assignés à résidence ». Nous vivons un peu dans la même crainte. Quitter notre domicile nous expose. Cela ne nous expose pas à une exécution, mais a un mystérieux virus. Un virus qui s’est répandu sur la surface de la terre entière en quelques semaines et que l’on peut attraper un peu par hasard, comme une balle perdue. Ce coronavirus ou «virus-couronne» est une si belle parodie du Christ-Roi que je ne peux m’empêcher d’y voir le retour de l’invisible dans le visible.
Nous oublions trop souvent que le monde palpable, matériel, ne l’est qu’en rapport au monde invisible. Sans conscience de l’invisible, le visible devient un écran, une prison, un cloaque. Mais lorsque l’invisible est conscientisé, honoré comme il se doit, il transforme le monde en la plus belle des aventures humaines, celle où chaque événement peut devenir signe.
Cloîtrés entre les quatre murs de nos maisons, nous écoutons les directives officielles de nos gouvernants. En France, le Général Macron vient de parler aux Français. « Nous sommes en guerre ! » martèle-t-il devant les caméras de télévision dans un style « 18 juin 40 » inimitable. Rassurons-nous, le Général prend toutes les mesures pour lutter efficacement contre notre ennemi invisible : « gestes barrières », « masques sanitaires », distance de sécurité entre individus… tout autant de funestes parodies de nos frontières nationales laissées désespérément ouvertes. Au moment où le virus était encore jugulable (avant que les visiteurs venus de Chine et d’ailleurs ne débarquent dans nos aéroports) les frontières devaient être fermées. Elles furent laissées grandes ouvertes par pure lubie mondialiste.
Résultat : les quatre murs de nos maisons sont devenus nos frontières. En un sens, on se retrouve un peu dans les conditions que Lucette et Céline ont vécues en exil. On quitte le domicile à nos risques et périls. Et la comparaison entre ces deux périodes ne s’arrête pas là. Les Français n’ont pas perdu les bonnes habitudes de la période de l’occupation ; chaque jour, la Police reçoit des milliers d’appels anonymes dénonçant les récalcitrants :
– «Monsieur l’agent, le voisin fait du barbecue sur son balcon» !
-« Monsieur l’agent, il y a un homme qui vend des masques sanitaires au marché noir !». Hier, des Français ont dénoncé les résistants et les juifs aux collabos, puis les collabos aux résistants ; aujourd’hui, ils dénoncent les récalcitrants aux mesures de confinement.
Des semaines de confinement au programme ! Un Voyage au Bout de l’Ennui qui réveille les pires aspects du peuple français – mais aussi les meilleurs : l’entraide spontanée, le dévouement des infirmières, exsangues en masques et autres tenues de protection.
Les Français : un peuple clair-obscur dont le docteur Céline a dit tout ce qu’il y avait à dire. Les pauvres « envieux » des «riches arrogants et hautins», le tout dirigé par des élites légales coupées du peuple réel. Et, dans l’heure de vérité que nous vivons, comme dans la période de la guerre, des plâtres du décor officiel qui s’effrite peu à peu.
Pour mieux entendre ce bégaiement de l’Histoire, il suffit d’ouvrir la bouteille de la tornade Céline. Nous n’avons aucune excuse pour ne pas ressortir nos vieux livres qui traînent sur les étagères de nos bibliothèques. Lire ou relire une des 80 000 pages acides et drolatiques écrites par Céline, c’est ouvrir une tornade qui emporte tout : les tournures convenues de la littérature, les fausses vérités du progrès sans l’homme, la propagande d’État ; ouvrir au hasard un livre de Céline et ce sont les usines à mensonges qui s’écroulent comme des châteaux de cartes !

RABELAIS EST DE RETOUR !
Je sais que des yeux experts se posent en ce moment sur ces lignes. Les yeux avertis des céliniens brillent de mille anecdotes sur l’aventure célinienne, parfois même non publiées, ces anecdotes qui s’échangent sous le manteau comme des énigmes vitales. Je veux dire à mes lecteurs : je vous vois faire les quatre cent pas dans vos appartements, confinés, rêveurs ou soucieux. Vous refaites le monde entre vos quatre murs. Ce texte, je l’ai écrit pour vous. Je relève un défi, j’ouvre une brèche, une craquelure dans le mur épais qui est face à vous. Pouvez-vous apercevoir dans la brèche le bleu de la mer Baltique ? Voyez-vous voir une vieille masure ? La silhouette d’une femme guillerette qui étend son linge en chantonnant, et cet homme, revêtu d’une vieille chemise trouée, qui jette des miettes de pain aux oiseaux ? Vous pouvez le voir ?
Si vous parvenez à voir ces silhouettes, c’est que mon texte a déjà un peu percé le mur de votre confinement. Tout le reste, les dimensions du roman célinen, les anecdotes de la vie de Céline, ce sera pour plus tard ; pour l’après confinement. La réputation sulfureuse de l’écrivain Louis- Ferdinand Destouche, dit « Céline », on en soupe depuis des décennies ! On finit même par y adhérer. Inutile d’y revenir maintenant. Lorsqu’on se place du côté de l’Histoire officielle – écrite par les vainqueurs – Céline a perdu.
Les balles de revolver ne l’ont certes pas atteint mais son aura littéraire, elle, est toute trouvée, comme les mains et les pieds du crucifié. Mais Céline ressuscite à chaque fois qu’on croit l’avoir enterré. Pour ma part, je laisse toutes ces récupérations politiciennes – défavorables ou favorables – au placard. Ce qui m’intéresse, c’est de résonner – avec – une œuvre et non de raisonner – sur – elle. En ouvrant un roman de Céline, j’ai de plus en plus le sentiment que Rabelais est de retour !
C’est tout ce qui m’importe. Le langage imaginé, paillard, hirsute, de Rabelais revient en force comme un mouvement de balancier. L’embourgeoisement de la langue est cloué sur la croix célinienne. Nous savons tous pourquoi nous en sommes arrivés là. Les rois de France eurent soin, à partir de vieux dialectes «françouais», d’inventer une langue académique unifiée. Le but était de faire du Français le viatique diplomatique nécessaire à l’hégémonie française en Europe, un second latin en somme.
Pour se faire, les poètes de cours eurent la tâche ingrat de désherber la langue, sélectionner les mots comme on sélectionne des bestiaux. Le résultat, une langue française déracinée de son substrat populaire. Une langue d’ambassade qui imposa presque dans toutes les langues du monde les mots « étage », « bagage », « chauffeur »…
L’apport considérable de Céline est d’avoir renouer la langue écrite avec l’argot populaire, le parlé parigo chantant de sa jeunesse. Il a réenchanté la langue écrite, notre bon Céline ! Il a extrait les pépites poétiques, les tournures argotiques de son patois. Le style rabelaisien actualisé, en somme. Cette gageure consistait à faire tenir la langue parlée dans le papier, oui, mais alors, la trame narrative, l’intrigue, la geste de ses personnages ? Décevante, banale, pauvrette, vous ne trouvez pas ?
Après mûres réflexions, j’avance ici l’hypothèse que la peau de chagrin des personnages des romans de Céline ne serait pas due au hasard ; elle serait intentionnelle ! Les personnages de Céline sont à chercher dans la vie de l’auteur, dans les vies de l’auteur ; Lucette, le chat Bebert, les oiseaux, les voyages, la Mer Baltique «mer sépulcrale, où les rares bateaux sont des cercueils»… sont les véritables personnages des romans de Céline.
En traversant une Allemagne à feu et à sang pour rejoindre le Danemark, on raconte que Céline était revêtu d’un gros manteau dont la couture intérieure était capitonnée de pièces d’or. Avec sa femme Lucette à ses côtés, le chat Bebert sur ses épaules, on parvient sans peine à imaginer la scène tragi-comique ! Ce chemin de croix à travers l’Allemagne allait finalement conduire notre Céline au Mont Golgotha, la prison de Copenhague, puis à la «Mise au Tombeau», la Masure des Sables.
Sur un total de sept années d’exil, Céline en passa en effet trois dans cette vieille masure située près de la mer Baltique. Cette masure sur laquelle plane bien des légendes, nous l’avons retrouvée ! Oui, nous l’avons retrouvée à la faveur d’un voyage à bicyclette au long cours !
En quittant la France, la mission que je m’étais investie était de quitter cette fournaise estival, cap au Nord toute. Je savais à peine où Céline avait connu l’exil. Le Danemark, oui, mais où ? De belles rencontres allaient me conduire devant la maison d’exil de Céline. Après quelques semaines à dos de bicyclette, j’arpentais les environs où vécurent Lucette et Céline. J’avais préparé un bout de papier sur lequel était écrit en grosses lettres : «Louis-Ferdinand Céline», juste pour voir la réaction des gens.
Allait-on appeler la Police ? Me jeter en prison ? Me cracher au visage ? Que Nenni ! L’agent de la bibliothèque communale où je venais d’entrer empoigna aussitôt son combiné de téléphone… Une heure plus tard, je me retrouvais face à un vieil homme à la chevelure blanche.
Il s’appelait Olé Seyffart Sørensen : «Vous avez des informations sur cet écrivain français qui a résidé dans la région après guerre ?», m’écriais-je, d’une voix polie comme un galet. Aussitôt, la brume des souvenirs se dissipa dans les yeux azurs de mon hôte, puis, les fleurs du souvenir se déplièrent une à une dans son esprit. En écoutant ce vieil homme – qui avait sept ou huit ans à l’époque de sa rencontre avec Céline – on aurait dit que l’auteur du Voyage au bout de la Nuit nous attendait dans la pièce d’à-côté, en caressant son chat.
Voici donc le récit de cette aventure hors du commun. Comment suis-je parvenu à retrouver, à dos de bicyclette, la masure à moitié engouffrée sous les sables de la Baltique et de la mémoire des Hommes ? Pour narrer au mieux cette aventure incroyable, remontons le cours des étapes qui précèdent ma rencontre avec Ole. Ces étapes qui furent autant de contacts avec le sol danois, ses îles mystérieuses, son génie, ses légendes.
CHEMINS ET BICYCLETTE
Le sentier de terre damée qui serpentait entre les hautes herbes me conduisit devant une sorte de mausolée. Je ne comprenais rien à l
´épitaphe gravée en vieux danois qui ornait le mausolée (mais appris plus tard qu´il s´agissait de la vieille tombe du gardien du phare). La rumeur de la mer se faisait à chaque instant plus précise. À travers le feuillage des grands pins, le bleu de la mer laissait passer quelques moutons d´écume, à la blancheur éclatante.
Je savais, depuis la veille, qu´un «shelter» se trouvait dans les parages immédiats. Un «shelter», qu’est-ce que cette méchante bête nordique ? Non ! amis lecteurs, aucune variété de moustiques voraces et sanguinaires ! Il s’agit simplement d’un abri de bois mis à disposition pour les randonneurs de passage.
En scrutant les alentours, je parvins enfin à discerner l’emplacement du dît shelter ; là, juste en contrebas de la falaise ! Une butte de terre au- dessus de la plage, un véritable « balcon sur la mer”.
Un randonneur m´avait devancé ce jour-là. Il avait planté sa tente devant les pierres encore chaudes du feu de camp. Nous n’allions pas tarder à faire connaissance, déballer de nos sacoches nos quignons de pain et nos anecdotes de voyage. J’allais vite apprendre ce que signifie « bål » en danois (prononcer « bôl ») : un feu de camp entouré de gros galets. Puis, en un rien de temps, nous allions nous endormir devant les flammes toutes crépitantes de légendes nordiques…
De l’autre côté de la mer, le bras de terre que l’on discernait à peine, c’était la Suède. Elle exposait ses habits dentelés de calcaire. Ses plages longues et ses forêts s’étalaient comme une dentelle froissée par le relief. Selon mon compagnon de la veille, la ville que nous pouvions apercevoir en face était Helsingør, petite ville enfoncée dans le golfe éponyme. Depuis notre point de vue, la côte suédoise voisine et la côte danoise semblaient se toucher, si bien qu’il nous fallait faire un véritable effort pour les discerner l’une de l’autre. Je trouvais ce chevauchement optique fascinant.
À la tombée de la nuit, je descendais les marches du promontoire à l’aide d’un morceau de corde accroché à un arbre. Enfin, je mettais le pied sur la plage. Je marchais dans le couloir de sable pendant une heure au moins puis enjambais de gros rochers jusqu´à ce que j´aperçoive une épave à demi ensablée dans la grève.
J´inspectai le squelette de la barque qui ressemblait à la coquille d’un mollusque. L’analogie était si frappante qu’elle se transforma en une leçon de choses… L’un des plus beaux objets jamais créés par l’homme
– une barque à la loupe de bois – calquait, pour ainsi dire, la « concrétude » d’une coquille de mollusque.
Le lendemain matin, je m’approchais du but. Cela était d’autant plus incroyable que je n’en sus rien moi même. La seule chose perceptible, c’était la chaîne d’or des événements (celle-là même que l’on appelle injustement le « hasard ») qui filait entre mes doigts comme la chaîne d’une ancre…
L’ABRI DE JARDIN
En effet, après plusieurs jours de voyage à la venvole, je me retrouvai dans l’Ouest de la grande île de Seyland, à l’extrémité d’un bras de terre entouré par la mer… Un gros orage allait éclater ; je trouvai un refuge providentiel dans un abri de jardin abandonné, près d’un voisinage discret et souriant. Il allait me permettre de déplier des souvenirs, et de m’ouvrir à d’étonnantes rencontres…
Un refuge dans un abri de jardin au bout d’un étroit bras de terre entouré par la mer. J’aime cet endroit abandonné et pourtant accueillant. J’aime les vieux tapis qui jonchent le sol. Et la fenêtre ronde, en haut, qui tel un hublot de bateau donne vers la mer.
Les changements de ciel sont extraordinaires. En fermant les yeux, on se croit sur le pont d’un navire pendant qu’un orage joue de l’orgue en haute mer.
Quelques arpents de terre plus bas, c’est la plage, à la fois ouverte et fermée sur le ciel comme un coquillage. J’ai cueilli ce matin quelques grandes feuilles vertes qui poussent dans le sable. J’en ai rempli une pleine sacoche. Les paysans du coin appellent cette plante pélagique « strandkaal », le chou des plages. Ensuite, j’ai joué à « saute caillou » et le jeu d’équilibre sur les rochers me rend pareil aux pigeons ramiers qui se déhanchent dans les vents contraires. Tout autant que le spectacle des lames de la mer sans cesse recommencé, ce jeu d’adresse déclenche en moi la ressouvenance des moments heureux de l’enfance.
Cette passerelle de bois plantée dans le rivage me rappelle le couloir de ma maison de Lyon, ce parquet sur lequel j’aimais tant plaquer mon oreille et jouer avec mes soldats de plomb. C’est drôle, d’imaginer une maison dont il ne reste que le couloir suspendu au dessus de la mer …
En sautant sur les rochers à pas de géant, je repère les plus beaux galets de la plage, aux belles couleurs. J’aime passer la paume de ma main sur ces cailloux chauffés par le soleil de midi ; ronds comme des œufs, omoplates d’animaux préhistoriques. Ce matin, un gamin des environs est venu à moi et m’a donné une « Kridt », grosse craie de calcaire avec laquelle il dessine sur les rochers plats de la plage. Je cherche un motif pour le dédier à la mer, aux oiseaux et à la fille de mes poèmes.
Je demandai à l’enfant le nom de l’île à l’horizon. L’enfant parlait anglais et comprit ma requête ; cependant, il me répondit dans sa langue maternelle : Det er ekke en oe, det er et fatamorgana, une phrase qui peut signifier : « Ce n’est pas une île [que tu vois à l’horizon] mais une fée morgane » ! Ce n’est que plus tard que je compris le sens de l’expression « fatamorgana », qui désigne une « illusion d’optique », l’effet miroir qui apparaît parfois à l’horizon pendant les fortes chaleurs.
J’ai rejoint l’abri de jardin, porté par cette découverte linguistique. Une fée celtique passée incognito dans la langue danoise ; ma vie elle-même enchantée par une fée. Ma plus incroyable découverte, la plus inattendue, celle de toute une vie peut-être, a eu lieu hier…
Ce que j’écris là, je l’écris à cette fée, et à travers elle, aux enfants des écoles, aux enfants du monde entier qui, un jour peut être, entendront l’histoire de ma découverte. C’est comme si les ondes verbales sautaient en ricochets d’un cœur à l’autre, d’une génération à l’autre. C’est comme si l’enfant que j’ai rencontré avait attendu, assis sur le rocher, pendant presque un trois-quart de siècle pour me raconter son histoire. Ce qui suit, il me l’a raconté avec ses yeux bleus et sa voix qui tremblaient comme la surface de la mer.
RENCONTRE «OLESIENNE»
«Ce jour-là, j’accompagnais mon père. La guerre était terminée depuis quelques années. Mon père, menuisier du village, se déplaçait souvent pour réparer les maisons des environs. Ce jour-là, nous allions visiter une vieille maison de bois située près de la mer où vivait un homme et une femme. J’accompagnais mon père en bicyclette alors qu’il y allait réparer un meuble. J’avais alors huit ou neuf ans.
Dès que nous sommes arrivés, je vis un homme à côté d’un gros chien. Comme il vit que j’avais peur, il éloigna aussitôt le chien. Puis, l’homme s’accroupit pour se positionner à ma hauteur ; on voyait qu’il aimait les enfants, cet homme-là ! Ensuite, il posa son doigt sur sa bouche et m’invita à sortir dehors avec lui. Nous sommes allés au bord de la mer toute proche…
La fois suivante, l’homme m’attendait avec une glace à la main ! Dans mon souvenir, il y avait mon père qui réparait les boiseries des maisons et des commerces du secteur et il y avait cet homme qui parlait une langue étrangère. Lui, c’était un vrai géant. Il y a aussi un gros chien dont j’avais peur.
Une femme habitait également dans la maison. Je me souviens de son sourire et de son calme. La plupart du temps, elle restait derrière le «géant». Lorsque je suis arrivé dans la maison la première fois, c’est elle qui éloigna le gros chien dont j’avais peur. Je crois bien.
J’ai vu mon ami le géant à six ou sept reprises durant l’été 1948. Mon souvenir le plus marquant, je m’en souviens comme si c’était hier : l’homme me fit signe de l’accompagner entre la maison et la mer, puis, devant les oiseaux, il jeta des petits bouts de pain. Du pain blanc très cher que le boulanger lui livrait plusieurs fois par semaine. J’étais fasciné par cet homme qui jetait du pain aux oiseaux !
Mon père m’avait en effet raconté l’histoire de Saint François d’Assise peu de temps avant ma rencontre avec «le géant». Et lorsque j’ai vu cet homme jetant du pain aux oiseaux près du portique à linge, là, près de la plage, je me suis imaginé que c’était Saint François d’Assise !
Ole Seyffart avait identifié Céline à Saint François d’Assise : sans m’en rendre compte, je m’identifiais au jeune enfant de neuf ans qu’il était alors. Je m’adressais au vieil homme qui était devenu en ces termes :
«votre papa portait un meuble et une plaque de cuisine afin de réparer la maison de Céline ; c’est drôle, le mien vendit notre maison familiale lorsque j’avais le même âge que vous, à l’époque, huit ou neuf ans.
Un soir, je l’ai surpris en pleur derrière les persiennes en bois de la cuisine. Il se cachait mais je l’ai vu. Il venait de vendre la maison sans rien dire à personne. Oui, la maison lyonnaise où je cachais mes trésors, où je construisais mes cabanes, il l’a vendu derrière notre dos !
Je me doutais bien que quelque chose se tramait car j’écoutais aux portes de la maison ; je savais que des gens allaient visiter la maison car j’étais un « enfant-espion » et j’étais au courant de tout. Avant que les gens ne viennent la visiter, j’avais creusé des trous dans les allées du jardin et les avais dissimulés avec des petites branches, de l’herbe et de la terre.
Je voulais qu’ils tombent dedans ! Oui ! Je me souviens du moment où une dame avait mis son pied dans le piège ! Dans ce jardin de la maison, je cachais en effet mes trésors, mes perles, mes billes de porcelaine, mes petits jouets. Le long du jardin, il y avait un portique vert, rougi de fraises. Sur le portique, des fils avec des pinces à linge.
Pendant que ma mère étendait le linge, je lui racontais des histoires que j’inventais. Ma sœur avait douze ans lorsque j’en avais sept. Elle passait son temps à m’empêcher de parler en me bâillonnant la bouche. Elle a toujours agi ainsi. En prenant de l’âge, les choses ne se sont pas vraiment améliorées entre nous. Elle prit l’initiative de mettre ma vieille mère dans une maison de retraite sans même m’en parler. Une maison de retraite située dans un endroit difficile d’accès, ce qui me priva de visites régulières. Enfant, elle a commencé par m’empêcher de parler à ma mère en me bâillonnant la bouche, et elle continue par d’autres moyens».
L’enfant ne m’écoutait pas vraiment et sans doute avait-il raison. Le linge sale se nettoie en famille. Il reprit son histoire aussitôt : «La dernière fois que je vis Céline, le «Géant», j’accompagnais mon père dans la librairie du village. Il livrait un petit meuble et une étagère en bois. J’avais posé une grosse couverture sur le triporteur afin que mon père dépose le meuble sans encombre. Nous sommes arrivés à la librairie et avons déposé l’objet dans l’arrière-boutique. Le libraire me dit : tu peux regarder dans cette étagère, il y a des livres pour enfants !
Quelques instants plus tard, la clochette de la porte tinta. Deux hommes entrèrent. Ils venaient acheter des enveloppes et du papier. C’est alors que l’un d’entre eux s’approcha de l’étagère puis, touchant l’ouvrage avec ses doigts, me dit : « c’est du beau travail !».
J’étais fier, très fier car celui qui avait réalisé l’étagère, c’était mon père ! L’un d’eux était habillé de vieux habits, c’était Céline !».
…. Lorsque j’étais un jeune garçon ou «gone» en lyonnais, on appelait ces gens habillés de vieux habits des «guenilles». C’était des gens mystérieux qui usaient les choses jusqu’à la corde. Ils n’étaient pas méchants mais ils faisaient peur aux enfants. Je ne crois pas en avoir rencontré mais j’ai entendu plusieurs fois le camion des Paties passer dans la rue. Ils sonnaient aux portes pour récupérer les vieux habits et les vieilles choses, les vieux meubles… Ils n’étaient pas méchants mais on disait qu’ils emportaient les enfants qui faisaient des bêtises…
De la même manière, on s’est servi de Céline pour faire peur à ceux qui ne veulent pas se fondre dans la démocratie chlorhydrique. Un siècle plus tard, deux cents ans peut-être, on se sentira obligé de condamner Céline dans nos discussions entre amis pour ne pas passer pour un salaud. Ce sera la victoire totale des ennemis de la vérité.
Je me suis retourné et j’ai embrassé l’air. L’eau était morte.
FÉERIQUES INSTANTS
De retour dans mon abri de jardin, je fais bouillir les «strandkaal» dans une casserole, et soudain une bonne odeur de chou se dégage, comme celle des choux de nos campagnes. Je somnole dans les vapeurs de la cuisine et les moments féeriques vécus pendant cette journée haute en couleurs, ma rencontre avec Ole alors que les pièces du puzzle de mes souvenirs s’assemblent une à une dans mon esprit…
Au fond, tout commence toujours par des rêves ! D’ailleurs, juste avant la fin de la guerre, il paraît que Lucette fit un étrange rêve. Elle vit un grand mur devant lequel on fusillait des prisonniers. Son mari, Céline, n’y figurait pas. C’est ce rêve prémonitoire qui décida le couple à fuir aussitôt en Allemagne, puis au Danemark. Je parle de Lucette et de Louis- Ferdinand Céline, le célèbre écrivain. Je parle d’eux car ils ont résidé dans les parages. C’est dans une de ces maisons situées près de la côte que le jeune Olé Seyffart, accompagné de son père, a rencontré à plusieurs reprises Louis Ferdinand Céline pendant l’été 1948.
Tout cela, vous le savez déjà chers lecteurs. Mais dans laquelle de ces maisons ? Lequel de ces pavillons au toit de chaume qui se dressent tels des vigiles le long de la côte ? Peut-être celui-là, entouré de vignes et légèrement plus trapu que les autres ? Peut-être celui-ci dont la cheminée penche du côté de la mer ? Ou encore cet autre en lisière d’un champ et d’où part un sentier qui mène à la mer ? En fait, les maisons de bois qui défilent à perte de vue le long de la côte se ressemblent toutes ; elles semblent toutes reliées au grand pont qui enjambe la mer, là-bas, vers le port industriel. Elles me font penser à autant de cabines de chalutiers ; leurs cheminées, elles, ressemblent à la pipe d’un capitaine. Les ciels pluvieux qui tournent au-dessus du cap rivalisent de gris avec les mouettes qui résistent au vent à grands coups d’aile.
Je dois maintenant trouver la masure décrite par Céline dans ses romans. Est-elle si inconfortable qu’il le dit ? L’intérieur de mon abri de jardin, lui, est sobrement meublé. Le désordre apparent des petits meubles et des objets anciens prennent tout-à-coup un ordre symbolique. Je me retrouve dans un tableau de Wilhelm Hammershøi.
Il paraît que le célèbre peintre danois venait passer l’été avec des amis sur cette plage, et ils dansaient nus sur la plage ! La chaleur estivale rend ici toutes choses flottantes et presque irréelles ; je comprends que l’on veuille danser nus sur les grèves ensablées avec les farfadets des feux de camps et les fées Morganes des soleils couchants ! On devine à peine dans la brume la silhouette des lointaines îles, mais on peut en effet se dire qu’il ne s’agit que d’un reflet, d’un grand vol d’oiseau à basse altitude, ou bien d’un rêve. Les rêves jouent un rôle dans nos vies. Sans le rêve prémonitoire de Lucette, Céline aurait sans doute été exécuté comme tant d’autres, comme Robert Brasillach, par quelques résistants de la dernière minute.
Un ami français m ‘écrivait l’autre jour que “L’Ombre et la Nuit” de Max Gallo évoque la montée du Fascisme et du courant germanophile français dans l’avant-guerre. Dans ce livre, l’ambiance est presque palpable, avec son côté glauque et inéluctable, désespéré et désespérant. L’on y recroise des auteurs comme Rebatet, Brasillach, Céline, et autres acteurs politiques de la France pro-Europa. Il y a également une belle histoire d’amour, comme il se doit, forte et tragique elle aussi. Tout existe et n’existe pas, tout est bancal, mal posé… Tout est pareil. Ô ange des désirs perdus… et “cette blessure”, dont je meurs !
Ces auteurs vivaient une autre époque, c’est-à-dire une autre fréquence ; ils étaient encore hantés par la loi naturelle, l’idée toute sotte que la terre tourne autour du soleil et que la femme et l’homme sont faits pour se marier ensemble. Ces auteurs sentaient monter en eux l’aurore rougeoyante de l’Europe Nouvelle. C’est la différence avec notre temps où l’idée d’Europe est scandée comme un slogan par des gens qui n’y croient pas eux-mêmes. L’Europe était une foi ; c’est devenu une donnée statistique, une courroie de transmission liant d’obscures rouages.
Les banques dirigent le monde, peut être. Elles ont besoin d’agents commerciaux pour faire leur travail, comme le Macron. C’est un «libéral» qui, comme tel, ne reconnaît pas l’existence des peuples, ni des traditions mais seulement des individus. Il croit qu’il peut faire danser un peuple comme une troupe de majorettes. Dans dix ans, il restera dans nos mémoires comme le doigt coincé dans la porte. Alors que Rebatet, Brasillach ou Céline brillent déjà comme des étoiles dans le ciel de la littérature française.
Il faudrait soulever le voile des évènements sur ce qui s’est vraiment passé là, dans le fascisme, le National-Socialisme, l’antisémitisme, l’anti- Bolchévisme. L’homme Rebatet focalise tout ce que j’aime (à tort ou à raison) dans cette galaxie d’écrivains. Non pas les idées, mais le courage. L’idée de rester fidèle. Sa plume d’écrivain, je la connais mal en effet. Soixante-quinze ans après la guerre, c’est toujours la même rengaine : les « résistants » étaient des saints et les « collabos », des traîtres, preuve que le « blabla » du système – dont parlait déjà Céline il y a un siècle – est devenu loi coercitive.
Dans mon enfance, j’ai entendu des témoignages – directs – qui ne vont pas tout à fait dans le sens de l’Histoire. Pour beaucoup de paysans de l’Ouest Lyonnais, les résistants, c’était les dix plaies d’Égypte, le vol de sauterelles qui ravageait les maigres récoltes. Parfois, ils menaçaient les paysans qui refusaient d’obtempérer.
Leur héroïsme consistait souvent à tirer dans le dos d’un soldat allemand, condamnant par là même dix otages innocents. Le grand poète René Char raconte une anecdote de guerre. Un jour, il tenait en joue un soldat allemand ; il lui aurait suffit d’appuyer sur la détente. Mais il ne le fit pas, car il aurait alors condamné à mort les paysans du tranquille village provençal. Tous les résistants n’eurent pas ce scrupule…
Bien sûr, il y avait des résistants authentiques mais, dans le lot, beaucoup de profiteurs, d’aventuriers et de vulgaires crapules. Idem dans l’autre camp. Mais, on parle toujours des bons «résistants» et jamais des «bons» de l’autre camp. C’est oublier que la couleur de l’Histoire n’est pas le noir ou le blanc, mais le gris. L’autre camp, c’était ceux qui ne voulaient pas qu’un jour le judéo-bolchevisme s’installe partout ; ils ne voulaient pas non plus que le judéo-capitalisme de Wall Street ne l’emporte finalement. Face à la double face de cette fausse monnaie, ils ont pris le train de l’«Europe Nouvelle».
Lorsqu’on prend de la hauteur, que l’on grimpe sur les sommets de l’Histoire ou, à l’inverse, lorsqu’on descend au fond de soi-même, on comprend qu’il y a toujours deux voies possibles. La voie de l’homme moderne, c’est de rêver perpétuellement sa vie. Au contraire, la voie de l’homme traditionnel est de parvenir à vivre son rêve.
Deux voies contradictoires.
Nous vivons une période où les premiers raillent les seconds d’être de fieffés « rêveurs », alors que tel est exactement le contraire. Les modernistes rêvent d’un monde sans frontière : ils savent qu’ils seront heureux lorsqu’ils auront recouvert la terre de buildings et d’autoroutes. Le matérialisme et toute la cohorte de dérivés utopistes et libérales commencent comme un rêve et finit comme un cauchemar. Les modernistes ne comprennent pas que le monde qu’ils cherchent à transformer en rêve est déjà une projection onirique, la leur, un «monde en ruine » que l’homme ne peut habiter que poétiquement en réalisant la royauté du Christ.
Il y a ceux qui veulent faire de ce monde un royaume et ceux, fidèles au christianisme authentique, qui recherchent à contrario «le royaume qui n’est pas de ce monde». Le message chrétien qui, selon moi, est l’épicentre du christianisme, est-il seulement compris par les Chrétiens eux-mêmes ?
Parmi toutes les utopies modernistes, les droits de l’homme et la démocratie, sont sans doute les scélérates de toutes. Lucien Rebatet estimait très justement qu’ «en-dessous d’une certaine latitude, la démocratie ne fonctionne pas». Elle fonctionne à peu près bien dans les pays scandinaves de mentalité protestante et relativement peu peuplés, comme le Danemark, mais pas dans les latitudes plus australes. Je ne vénère pas les idées de Rebatet, de Brasillach ou de Céline mais je respecte leur résistance au «blabla» de la propagande qui pénètre tout. Je respecte leur courage contre l’esprit du temps et leur style d’écriture incomparable.
Céline s’habillait comme il écrivait, avec des guenilles. Ce qu’il a fait au langage et à la pensée, c’est rapiécer des bouts de chiffon. Il a usé la langue jusqu’à la corde, pendant que d’autres changent de chaussures et d’idéologies toutes les semaines ; lui, gardait le même habit verbal, plein de trous.
J’en dirais tout autant de Louis Aragon qui est pour moi un des plus grands écrivains de cette époque. «Un faux pas. Une syllabe achoppée révèle la pensée de l’homme. Il y a dans le trouble des lieux de semblables serrures qui ferment mal sur l’infini », cette phrase tirée du « Paysan de Paris » fait mon admiration depuis des années. Tel un Augure, le jeune Aragon, en quête d’amour, déambule dans l’immobilier urbain de Paris à l’affût de signes. Nous voyageons, et les lieux que l’on traverse, les villages, les paysages, sont porteurs de signes. Les rencontres aussi, peuvent être porteuses de signes.
Je me souviens, par exemple, de cet après-midi pluvieuse ; des souvenirs enchantés qu’elle a laissés dans ma mémoire…
UNE PLUIE DE DIAMANTS
La maraude en bicyclette fait parfois découvrir le langage des fleurs, des ciels, des averses subites, des oiseaux qui chantent. Je ne parviendrais jamais à faire le tour du monde, mais je découvre peu à peu le rêve dont notre monde est la projection imparfaite, celui qui sommeille en nous comme un ours hibernant.
Me voici de retour dans mon abri de jardin. Tout à l’heure, alors que le rideau de la pluie venait de se refermer, un merle se mit à chanter dans la ramure du grand arbre voisin. Tandis que le rideau de pluie se refermait, son chant ouvrit un rideau de musique qui me remplit de nostalgie. Dans la langue des gens de ce pays, le merle se dit «solsort», le «noir soleil»… Est-ce «le soleil noir de la mélancolie» qui brille sur le luth de Gérard de Nerval ? Ou simplement le trou du feuillage du grand arbre solitaire où Monsieur le merle vient de se poser ? Au bord de ce puits de feuillage, l’oiseau fait résonner les cordes de l’Orphée solaire. Moi, je ne fais que lui prêter le violon caché de mon poème. Et son chant bleui de torsades aiguise les dernières pointes de cristal de la pluie qui vient de s’arrêter. Ô comme les feuilles vitrées du cœur reflètent les plus hautes rivières du ciel !
Le chant du merle est-il une invite à explorer notre intériorité obscure comme son nom local le suggère ? Je l’ignore.
En tout cas, les gouttes de pluie scintillantes de cette fin d’orage, mêlées au chant du merle, exprimaient si bien ce «génie de diamant qui me murmure un nom semblable à la fraîcheur» que j’ai soudain compris Aragon ! Le monde qui nous entoure n’est qu’une immense trame métaphorique. Le sentiment rode dans ce monde, un sentiment de manque et de manque d’amour. Quand l’amour d’une femme, muse, égérie ou amante, parvient à toucher le cœur de l’homme, alors tout ce qui nous entoure se met soudain à parler…
Robert Brasillach nous a ouvert les portes de ce langage amoureux naissant dans l’enfance ; avec «Les deux Étendards», Lucien Rebatet écrit le grand roman d’amour adulte de l’époque moderne ; Aragon fait résonner dans les rues de Paris l’écho éclairé de la quête amoureuse. À deux pas de l’Opéra Garnier, Aragon essaie ses clefs dans les serrures poétiques de ces lieux. Son errance amoureuse est servie par un style incomparable ; en lisant ses textes, nous sommes immédiatement invités à entrer dans la cour intérieure de Paris où résonnent les pas de l’être aimé.
L’amour en tant que métaphore transcende le temps et l’espace. Il traverse toutes les variations spatio-temporelles pour rejoindre le tambour résonnant – et raisonnant – du cœur pour rejaillir en fréquences verbales. Sa clarté est telle qu’elle éclaire le poète amoureux comme une lampe dans la nuit.
« Je voyage pour vérifier mes rêves » disait Gérard de Nerval. Nous nous déplaçons dans l’espace à bicyclette, mais les paysages et les rencontres sont vus à travers la même fenêtre, celle de l’âme amoureuse. C’est sans doute pourquoi la rencontre avec une muse est si bouleversante ! Un changement d’octave se produit dans nos vies. Une nouvelle perception des choses apparaît. Une pluie de douceur semble tomber dans la terre du cœur. Du coup, la vie nouvelle ouvre des serrures, des articulations avec l’invisible dont on ignorait jusque là l’existence. C’est aussi cette «heure étoilée» qui s’est ouverte dans les années trente avec la montée du Fascisme, d’abord dans les tréfonds des peuples d’Europe, de leur génie et instinct respectifs.
Ces régimes ont généré un système de valeurs à la fois archaïque et moderne que notre époque de termites de faux plafonds ne peut que difficilement comprendre. Ces hommes-là, qui brûlaient de foi et d’amour, n’avaient que faire des petits calculs d’intérêts particuliers qui occupent nos élites actuelles aux regards de cafard. Comment un termite de faux plafond peut-il comprendre le vol majestueux d’un faucon ? Sa finalité est de grignoter méthodiquement les poutres porteuses de la civilisation, l’ordre naturel et la tradition ; celle du faucon est de transfigurer la vie terrestre en vie céleste !
L’octave qui les sépare est irréductible. Il n’y a pas de lien entre un insecte qui ronge les poutres d’un faux plafond et un géant qui regarde au-delà des montagnes.
LA PLAGE DU «GÉANT»
Je quittais un moment mon abri pour rejoindre la plage d’après la pluie. Une plage presque immaculée découverte à travers les arbres, blanche de sable comme une page éditée aux éditions du ciel et de la mer. La mer, avec ses longues traînées noire et grise de mascara ressemblait au visage d’une femme baignée de larmes. Des heures durant, je marche à l’intérieur de ce regard à la fois triste et beau de l’onde bouleversée par l’orage ; on dirait que mes jambes entraînent avec elles de longs voiles mouillés des ondines du rivage. Pour dire « marcher dans l’eau » ou plutôt « barboter » comme le font les enfants qui ramassent des coquillages ou s’amusent avec le sable, les Scandinaves utilisent le verbe «Soppe», un verbe qui n’a pas d’équivalent exact en français.
Les roches affleurantes dans le sable scintillent de mille feux, ceux des vagues de la mer, du souvenir de la pluie de midi, de ceux de l’enfance reflétée par le soleil couchant. Demain, je les recouvrirai de dessins avec ma craie de trottoir. J’écrirai des mots en français que personne ne comprendra ou les recouvrirai de dessins d’enfant. Mais pour l’heure, je m’amuse à faire des piles de galets qui tiennent en équilibre comme on le fait au bout d’un pèlerinage.
Il se fait tard. On dirait que les ombres cachées sous les roches attendaient ce moment pour recouvrir le sable. C’est le soir qui déverse son vin sombre dans l’onde. Une brise légère chargée d’embruns rafraîchit mon visage. Je remonte les arpèges du talus qui sépare la plage de la terre ferme. En remontant, je remarque que le bandeau de terre brune du rivage, perclus de trous d’oiseaux, ressemble étrangement à une flûte traversière. Les oiseaux qui nichent sur la côte attrapent toutes sortes d’insectes volants avec une agilité incroyable. Les gens les appellent des « landsvaler ». Ce sont des hirondelles de mer. Je n’avais jamais vu pareils oiseaux qui creusent des petits trous dans le rivage comme les serruriers creusent des trous dans les portes des maisons.
À mesure que je m’éloigne du rivage, le bruit des vagues ne devient bientôt plus qu’une rumeur. Je me retourne pour observer l’horizon peuplé d’îles lointaines et me dis qu’elles ne sont, elles aussi, qu’un rêve dessiné à la craie par des enfants.
Le chemin qui serpente au-dessus du hameau est escorté par un brouillon de plantes diverses, ronces fournies, sombres orties parsemées de millepertuis, petites plantes à fleurs d’un bleu profond que l’on appelle ici des «Slangehoved» ou «têtes de serpents», mais aussi ombellifères aux larges feuilles vertes où tournent de grosses fleurs rougeâtres nommées «Rodhestehov» ou « sabots rouges de cheval»…
Les papillons gravitent autour des rares fleurs tels des étincelles. Ils terminent l’œuvre de la nature en apportant les dernières touches de peinture au grand brouillon des hautes herbes ; ce sont des monarques oranges à pois noirs qui, après d’hésitantes maraudes, ouvrent à présent les paupières des buissons.
Je me mets maintenant à escarper les sentiers bleus pour rejoindre mon château de fortune, cet abri de jardin dont j’avais laissé en partant la porte grande ouverte. Pour ce faire, il me faut encore monter des degrés de chemin jusqu’au plus haut point de vue de la péninsule où se produit, alors, le miracle du voyage lent. En arrière, je vois s’éloigner mon sentier qui, en contre-bas, semble s’abreuver comme une bête à l’eau de la mer ; au devant, c’est le sémaphore qui, à l’extrême pointe de la péninsule, tourne son miroir comme s’il cherchait un disparu dans l’écume blanche des vagues. En marchant, les lignes du paysage bougent comme si mes pas déroulaient la bobine de fil de l’horizon. Une sorte d’Ariane guidait mes pas et déroulait le paysage à la fois ; une Ariane parisienne.
Soudain, un chevreuil gicle à mes pieds ! Je le vois filer dans les blés verts comme une comète dans le firmament. Mon cœur bat la chamade.
« Ce que je voudrais, c’est trouver la clé unique qui ouvre toutes les serrures de ce paysage » – me disais-je à l’instant – les odeurs mêlées qui montent de la terre, les noms des fleurs et des insectes, les bougies allumées des rares passants, les façades craquelées des vieilles maisons à colombages et à toitures de chaume, et aussi l’épave de galion qui, dit-on, jonche au fond des sables dorés, quelque part autour de ce bras de terre.
Ma prière est exaucée ! Soudain, au croisement de deux sentiers, je crois reconnaître, posé dans un pli du talus, l’héraldique même du paysage : un chardon violet dressé au milieu des blés verts ! Heureux de ma découverte, j’ouvre mon carnet de voyage et me mets à dessiner mon blason. Je l’imagine aussitôt porté par la fille de mes poèmes. Dans mon rêve éveillé, elle se retourne au milieu d’une foule en tenant mon blason dans les bras tel un signe de reconnaissance en me fixant de ses yeux verts ; j’ai alors juste le temps de lui remettre un recueil de poèmes avant qu’elle ne soit emportée par le courant de la foule. Je ne sais alors si mes souvenirs des rues de Paris s’invitent dans le rythme des vagues, ou si tout au contraire, c’est la mer avec ses vagues qui me rappelle le mouvement incessant des rues toutes remplies d’elle…
Enfin, j’arrive à mon refuge alors que les premières étoiles commencent à picorer le ciel. Je referme la vieille porte de l’abri de jardin qui me chante une nouvelle fois son refrain. La porte refermée fait taire tout à coup les vents extérieurs. On perçoit cependant la rumeur des feuillages qui, au dessus de la toiture, continuent de se balancer tendrement dans le grand rêve du soir.
Soudain, je remarque sur le bureau de bois tout recouvert de poussière, situé au milieu de la pièce, une gravure que je n’avais pas remarquée jusque-là. Je passe mon doigt dans les rainures du bois et distingue aussitôt trois lettres : L, F et D ; une sorte de signature creusée au couteau. Si la lettre D avait été un C, alors, c’est sûr ! Cela aurait été la preuve que Louis-Ferdinand Céline avait résidé ici ! J’aurais alors découvert la maison du célèbre écrivain !
Un C à la place d’un D pour que la combinaison ouvre soudain le ciel ! Une fois de plus, Louis Aragon avait raison : « Il y a dans le trouble des lieux de semblables serrures qui ferment mal sur l’infini !»
D’UNE MASURE L’AUTRE
Il avait été clair, depuis ma prime jeunesse, que le temps et l’espace, ces deux dimensions du grand théâtre cosmique, avaient été allouées très fugacement à l’observateur dans un but bien précis, y faire quelques découvertes essentielles. Peut être une, deux, ou trois dans une vie d’homme. L’observateur devait pour cela se convaincre que le monde n’est qu’un hologramme. Le monde qui l’entoure est tissé pour correspondre aux formes questionneuses de l’individu. Il réalise ensuite que le corps, les cinq sens tissés dans la trame sans couture de l’univers, ne durent que le temps d’un CDD sur terre.
Céline a passé son CDD à scruter les ondes du langage. «C’est des filigranes, la vie ; ce qui est écrit net, c’est pas grand chose. C’est la transparence qui compte, la dentelle du temps » aimait-il à déclamer aux journalistes.
L’observateur prenait aussi conscience que, petites ou grandes, les découvertes métaphorisent toujours quelque chose des plans supérieurs du ciel, font écho, voire tempêtent avec eux. Tout dépend du degré d’amour qui est dans notre cœur.
Il m’est arrivé de voir le temps et l’espace comme la charnière double d’un coffre à trésor, car ce que l’on découvre dans ce bas-monde lorsqu’on s’y penche avec assez d’acuité, peut ressembler parfois à un diamant à facettes, brillant dans son écrin. Alors, les rideaux rouges du rêve s’entrouvrent sur un monde qui est à la fois semblable et différent.
Ce voyage-ci nous a conduits à retrouver la maison d’exil de Louis- Ferdinand Céline et de Lucette Almenzor au Danemark, pièce encore assez peu connue du grand théâtre célinien. Une fois rentré en France, les rapides de ma pensée charrièrent d’autres branchages de souvenirs et d’images. Les soirs bleus d’été, j’imaginais, comme si je les avais croisés hier, Céline et l’avocat Mikkelson devant la maison de vacances ; le chat Bebert qui jouait avec les bobines de laine de Lucette ; cette guerre franco-allemande que Céline voulut à tout prix éviter à ses compatriotes.
Je n’oublie pas le petit Olé, huit ans à l’époque des faits, jouant avec « le Géant ». Je n’oublie pas, non plus, les autres dimensions du réel jamais directement visibles et pourtant tissées dans le réseau subtil des apparences : le monde visible comme métaphore de l’invisible, le voyage comme quête vitale, la maison en tant que mystère à la fois ouvert et fermé du tout cosmique et les rencontres comme autant d’étapes nécessaires qui nous rapprochent du centre du labyrinthe. Une incroyable chaîne de circonstances nous avait conduits, moi et Annette, mon hôte danoise, devant cette masure inhabitée, « Fanehuset ».
Ses vitres ressemblaient à des yeux de poisson révulsés. Elles brillaient à peine dans le feu de cette fin d’après-midi d’été si paisible. Une fine couche de poussière les recouvrait, donnant à ce que l’on voyait à travers, la patine même des souvenirs. Cet intérieur me semblait comme suspendu dans le temps, ces meubles en bois ripoliné avec un blanc d’hôpital, cette petite table d’appoint, et ces ustensiles de cuisine. Je me souviens notamment d’une cuillère en bois posée dans un récipient qui donnait l’impression que quelqu’un venait d’y boire une soupe !
L’intérieur était aussi exigu qu’une cabine de cosmonaute ; je le voyais par la vitre de la fenêtre avec l’œil de l’augure scrutant dans le visible, les signatures de l’invisible.
La mer toute proche chuchotait à nos oreilles des chants sibyllins. C’est là, dans l’eau claire de la Baltique que Lucette aimait à se baigner, dit-on, chaque jour, été comme hiver. J’y vois peut être le secret de sa longévité exceptionnelle. Cent sept ans. Le dernier cadeau qu’elle reçut fut peut- être cette pierre extraite de sa maison d’exil du Danemark.
J’appelais Annette qui était restée en arrière, à vrai dire assez peu intéressée par mon aventure célinienne. Nous fîmes le tour de cette masure, passâmes sous les petits chênes, guère plus hauts que des parasols qui l’entouraient. Il y avait toujours ce chant marin à onde courte, celui du jeu des vagues d’eau et d’écume que nos yeux devinaient à travers les feuillages.
Que la maison était jolie ! Habillée de rouge, avec ses rubans de poutres noires, à narguer ainsi les siècles. Une vraie demoiselle de bal dont la sente qui conduisait à la grève toute proche se confondait, le soir, avec une traîne étoilée.
Annette remarqua une fissure dans le soubassement de la face arrière de la maison. Une fissure peu profonde mais qui, telle une mine, délivra
facilement quelques éclats de briques rouges. L’un de ces morceaux avait la taille d’un gros diamant. Je l’extrayais sans difficulté de l’antre mural. Nos poches, lourdes de pierreries, nous faisaient ressembler à deux gavroches en culottes courtes.
À ce moment là, j’ignorais qu’une autre main que la mienne allait empoigner le précieux viatique qui roulait dans ma poche. La main qui avait tant de fois récuré cette maison à la brosse, la main d’une femme qui avait subie tant de fois les remontrances de son ostrogoth de mari.
J’allais transmettre ce souvenir par un jeu de relais de hasard, une partie de puzzle où la pierre allait jouer un peu le rôle de la pièce manquante. Ce relais aura lieu dans une heure à peine. Nous sommes en effet quelques mois plus tard, dans un salon littéraire à Paris. Curieusement, mon petit essai sur Céline ne semble pas susciter de grandes suspicions. Je m’étais habitué à l’idée que dans un pays dirigé par des élites international-capitalistes, tout ce qui pouvait rappeler le contraire de cette idéologie mortifère soit impitoyablement châtié et réprimé. Il faut que le camp de concentration nazi serve à occulter le camp de consommation libéral, la dictature de la marchandise, dans laquelle nous essayons vaguement de survivre. Et pour cela, le système est prêt à tout, y compris à tirer sur la dépouille d’un écrivain mort depuis plus d’un demi-siècle.
Anne de Guérande, accompagnée de son mari, viennent de passer devant mon stand. Je leur offre un de ces petits galets plats ramassés sur le sol danois. Je me demande bien dans quelles mains ce viatique va-t-il passer ? Sur quelle table va-t-il être posé ? Dans quel jardin va-t-il atterrir ?
Une autre personne passe devant mon stand, l’œil vif et discret. Sur ma table, le dernier exemplaire de « La Masure des Sables ». L’ homme le feuillette, sans l’acquérir. Il est de Meudon, petite ville située dans le Sud de Paris, non loin du salon où je me trouve. Il s’appelle Alain.
-« À dix-huit heures, je passe vous chercher en auto. Je vous conduit à Meudon ! Oui, à Meudon » .
-« Quoi ? Vraiment ! Vous me conduisez à Meudon, devant la maison de Céline ? »
Alain portait une chemise militaire ornée d’une épaulette tricolore et un sens de l’honneur non moins militaire. À 18 heures tapantes comme l’honneur, il était là, fidèle à la parole donnée !
-« Vous êtes prêt ?
-« Oui, mon capitaine ! » J’enfilais mon livret et les petits galets dans mon sac-à-dos et, tout en suivant mon guide, nous jetions un rapide coup d’œil aux autres stands en cours de démontage.
En automobile, les rues de Meudon déroulèrent des façades vitrées d’un style néoclassique. Une gare de train, des massifs de fleurs, une grande rue qui montait : bientôt apparurent les fenêtres souriantes de la demeure de Céline et Lucette ! Le grand portail de fer apparut lui aussi dans la pénombre ; puis, la fameuse boite aux lettres «Destouche» dont le lettrage était intact malgré six décennies de soleil et de neige érosifs ; une cour pavée de grandes dalles ; un massif d’herbe et, tout au fond, la bâtisse de pierre, grande et majestueuse. Je me souviens du grand escalier à moustache, des grandes fenêtres dont une (celle de droite) était éclairée par une lampe de chevet. Dans le halo jaune de la fenêtre, on devinait une silhouette.
Il se faisait tard et un air frisquet m’invita à remonter les manches de mon gilet. Je lançais avec mes deux bras de grands gestes circulaires à travers les grilles du portail. Avec mes mains, c’est un peu du ressac de la mer Baltique qui allait rejoindre Lucette.
Un homme descendit promptement. Cependant, au lieu d’ouvrir le portail, il s’arrêta à bonne distance. Peut-être à deux ou trois mètres du portail. Sceptique plus qu’inquiet de ma présence, il me regarda fixement. À travers le portail, je glissais le morceau de brique rouge entouré, telle une relique, par un ruban doré. Surpris, le gardien me regarda un instant puis, m’assura qu’il allait le transmettre sans attendre à Lucette qui veillait au premier étage.
Elle n’attendait plus rien, à son âge, sinon la nuit paisible qui elle aussi l’attendait pour son dernier voyage.
Lucette s’est éteinte quelques semaines après cette incroyable jeu de relais temporel. Le morceau de brique que l’infirmier lui fit passer ce soir-là fut peut être l’ultime présent qu’elle reçut. Je ne vis pas Lucette mais la lumière de sa lampe de chevet ; là-haut, au second étage de la grande maison de Meudon. Il n’y a pas de souvenir plus vif dans mon esprit, la lumière tamisée d’une lampe qui rimait avec le couchant d’une vie, en attendant de renaître aux aurores.
REMERCIEMENTS :
A l’admirable peuple danois, mes frères d’âme, à ma chère hôte danoise Annette Hauteville. Enfin, à Olé Seyffart, ce message personnel :
Jeg vil gerne takke Ole Seyffart Sørensen for hans entusiastiske bidrag. Da jeg så hans øjne, blå som det Baltiske hav, var det som om tidens tåger lettede. Hans hukommelses blomster begyndte at udfolde sig. Bare ved at lytte til ham, var det som om Céline befandt sig i rummet ved siden af i arkivet, med fødderne hvilende på vindueskarmen, mens en kat kom til syne og forsvandt mellem mine ben.





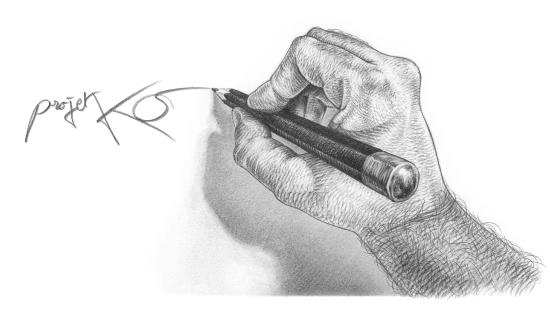


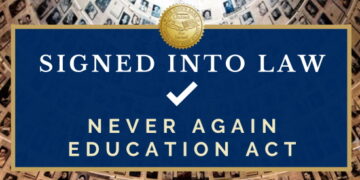














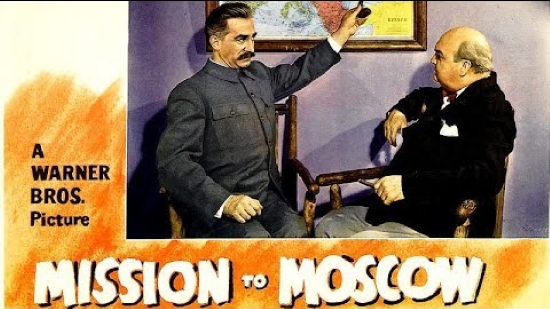



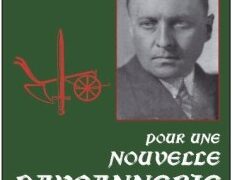


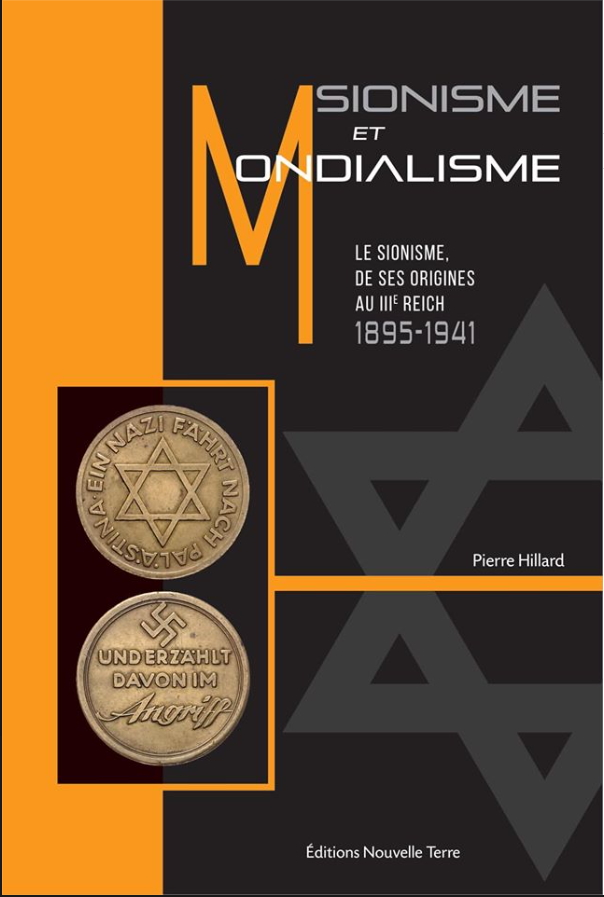
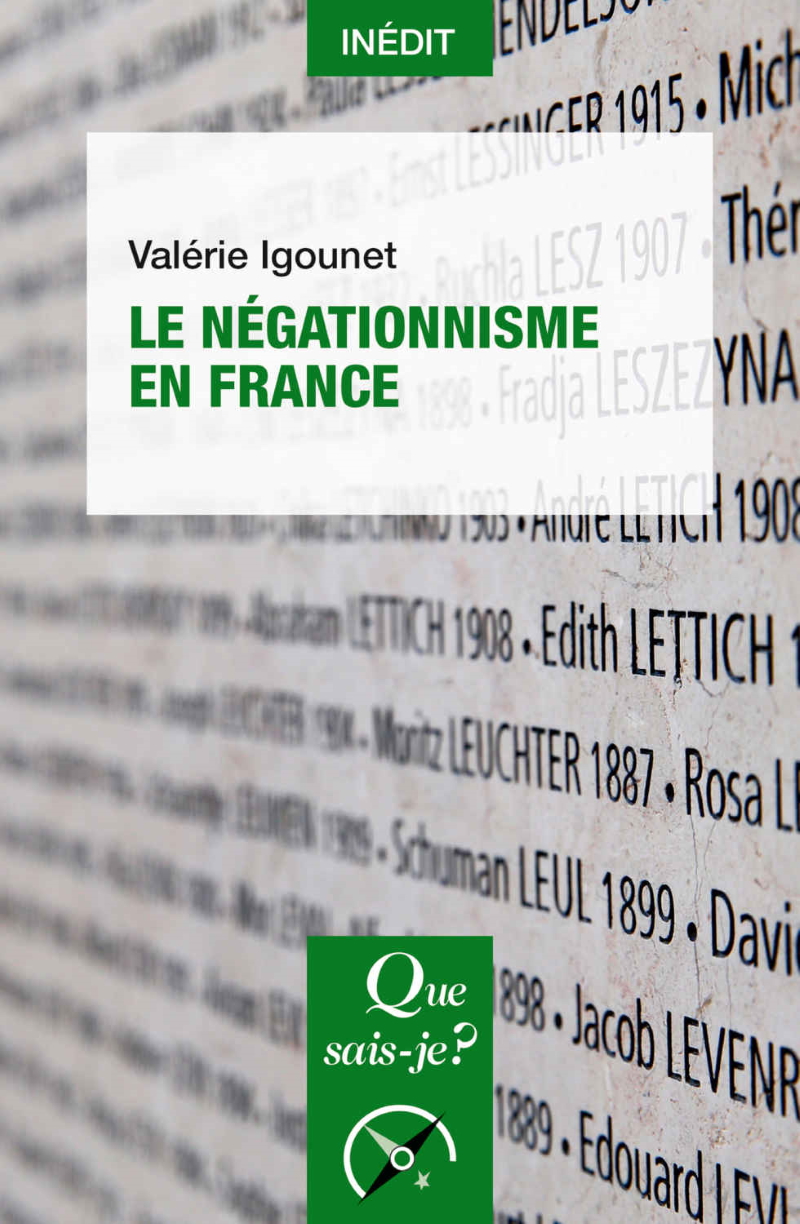



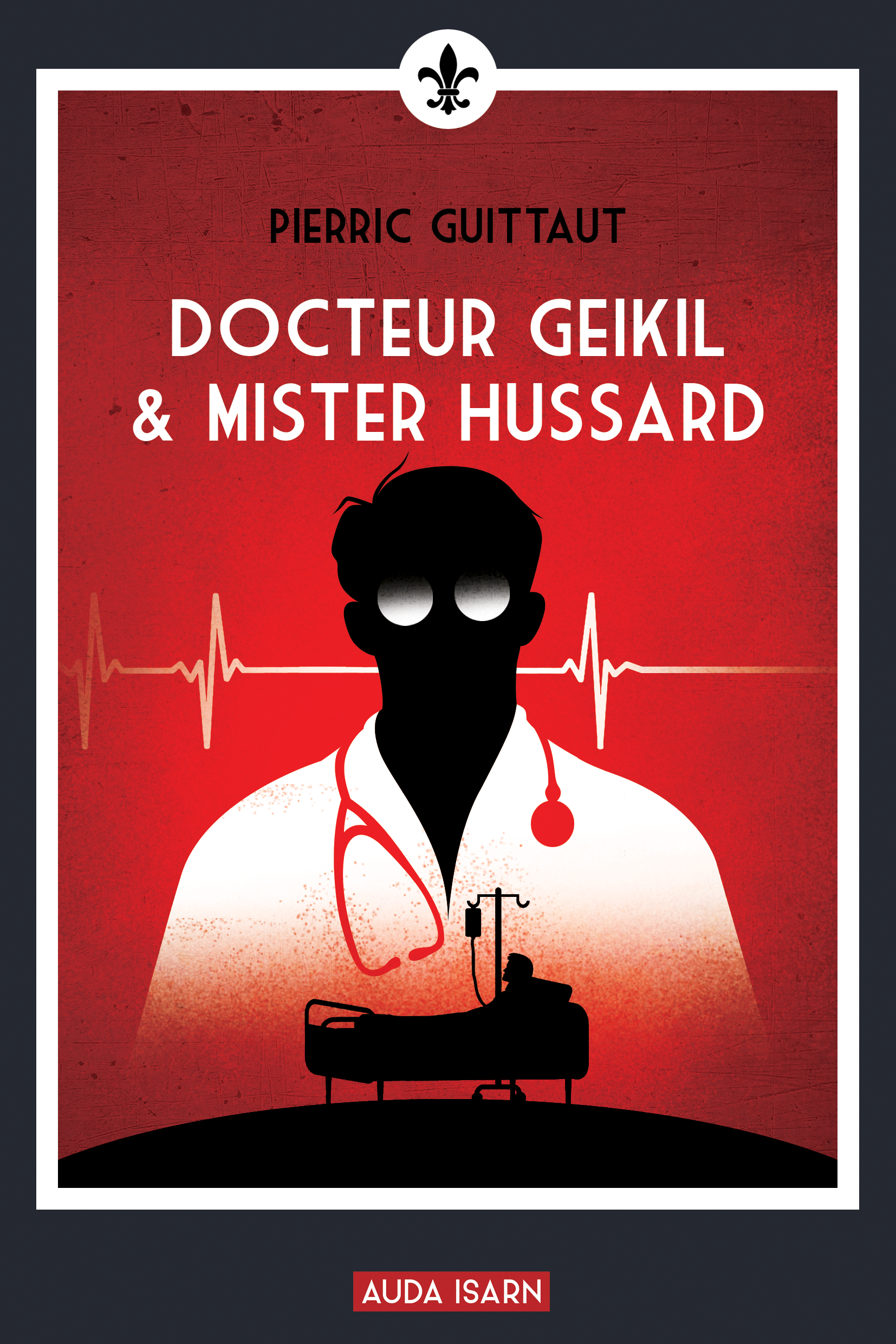









 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV