- Accueil
- Actualité
- Nationalisme
- Culture
Trending Tags
- Édition
- Agenda
Trending Tags
 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV- Boutique Jeune NationNouveau !
- Accueil
- Actualité
- Nationalisme
- Culture
Trending Tags
- Édition
- Agenda
Trending Tags
 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV- Boutique Jeune NationNouveau !
11 novembre 1918 : L’armistice
Pourquoi ce 11e jour du 11e mois de l’année a-t-il été choisi ? Question bizarre, direz-vous, mais qui l’est moins si l’on connaît le soin du frère- maréchal Joffre (1852-1931) de retarder l’heure initialement prévue par les négociateurs français et allemands et de la fixer à 11 h. Trois fois 11 font 33 ! Ce chiffre avait-il un sens pour certaine fraternité cosmopolite révérant le 33e degré du rite écossais ? Assurément !
Chaque famille a ses soldats, morts ou « gueules cassées », comme on les appelait. Mon père, fait prisonnier (et très bien traité) pendant l’offensive d’Erich Ludendorff (1865-1937) qui porta les troupes impériales près de Paris au printemps 1918, était de la classe 16 ; un oncle maternel, Aristide, dont la souche paternelle paysanne venait selon un mot rapporté de mon grand-père gersois, défunt en 1931, « de l’Europe de l’Est, avec Napoléon » pour mater probablement l’insurrection nationale espagnole, tomba à Verdun, son corps volatilisé par un obus atteignant l’ambulance.
Mon regretté professeur de philosophie, qui fut aussi au lycée parisien Henri IV celui d’un courageux maître de littérature mort le dimanche 21 octobre 2018, le remarquable – et très opposé à Cohn Bendit et à l’anarchisme de 68, estimant même qu’avec Mitterand et le socialisme, « c’était la fin de la culture » – Henri Dreyfuss Le Foyer (1897-1969), me donna la clef de cette date commémorée bientôt : de retour du front à Paris, permissionnaire, dit-il, il accompagnait, en cet hiver 1917, son oncle franc-maçon notoire et sénateur en vue avec Clémenceau, au domicile familial, dans le Premier Arrondissement, rue de Mondovi, à l’opposé de la Chambre des députés, à l’angle de la rue de Rivoli.
L’oncle évoquait avec sympathie les offres de paix du nouvel Empereur et roi de Hongrie Charles, lesquelles succédaient à celles du Kaiser allemand, et ses arguments pour les accepter semblaient ébranler le frère Clémenceau. Ce dernier, de poser alors son pied sur le bord du trottoir de la rue citée, près des Tuileries, de hocher la tête et de lancer : « Vous avez peut-être raison, mais après tout, moi, je m’en fous, je joue la carte américaine ! ».
C’est ainsi que la guerre se prolongea un an et demi, que le Congrès des Maçonneries des pays belligérants et alliés tenu, en ce qui concerne la seconde séance décidant de la création de la Société des Nations, du 20 au 30 juin 1917, sous la présidence du général d’artillerie et polytechnicien Paul Peigné (1841-1919) grand maître de la Grande Loge de France (GDLF), dessina la carte d’après guerre.

Il faut pour que tous les morts de la première grande guerre reposent en paix, désigner les coupables et les profiteurs ou bénéficiaires de ce que l’illustre Lyautey déclara, avec bon sens, une guerre civile européenne, un suicide du continent.
En France, la Corse et la Bretagne payèrent un lourd tribut, leurs hommes chrétiens étant volontiers exposés par nos Anticléricaux !
L’Evangile dit bien que l’on reconnaît l’arbre à ses fruits ! Quels furent les fruits de pareil conflit ?
La saignée, avant tout, de la paysannerie que montrent nos monuments, une Paix à Versailles, injuste, qui enfanta une autre guerre, en semant, entre autres, les graines du conflit palestinien, et notre propre horizon laisse, aux yeux des hommes d’expérience, présager un nouvel orage, celui que, pour les dévots catholiques, le 19 septembre 1846, au lieu alpin de la Salette où en 1917 (en pleine dictature maçonnique portugaise qui décida d’entrer en guerre) de Fatima, sans omettre de citer le protestant Boer d’Afrique du Sud, le perspicace et germanophile Nikolaas Van Rensburg (1864-1926), l’on décrit comme l’épreuve de la fin des temps.
Peut-on parler d’une suspension des armes, ce 11 novembre ? Naturellement. Osera-t-on en revanche, prétendre qu’icelle ait conduit à la conclusion d’une véritable ou honnête Paix, à un repos de l’ordre ? Ce serait téméraire et mieux même, insensé.
Ne regardons pas ce 11 novembre comme une porte se refermant sur un massacre, mais bien celle maintenue ouverte d’un Enfer débuté par les coups de feu du frère assassin Gavrilo Prinzip qui fut, du reste, jugé par un tribunal musulman bosniaque, et non condamné à la peine capitale à cause de son jeune âge (19 ans) mais mort d’une typhoïde en prison à Theresienstadt, le 28 avril 1918…
Et, à cet égard, l’évanouissement de l’Europe pourrait être la conclusion voulue par les démons inspirant les sectaires.
Pierre Dortiguier
Commentaires 5
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Articles populaires
-
24 août 1944 : Honneur aux miliciens du Grand-Bornand
0 partages -
Dominique Many harcèle un magistrat de Dijon coupable de ne pas aimer les délinquants étrangers
0 partages -
L’homme qui vomissait sur le drapeau français, l’immonde Juif Jean Zay, entrera au Panthéon
0 partages -
Compte-rendu de l’hommage 2017 au Maréchal Pétain sur l’Ile d’Yeu
0 partages -
29-30 juin 1962 : Franco au secours des pieds-noirs oranais
0 partages





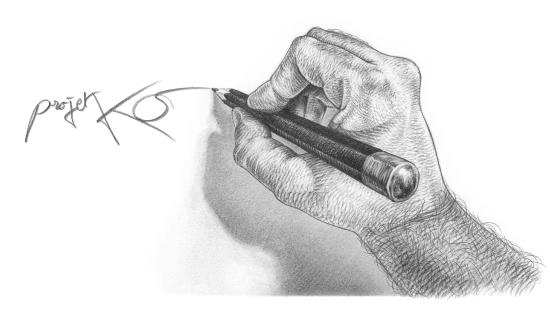


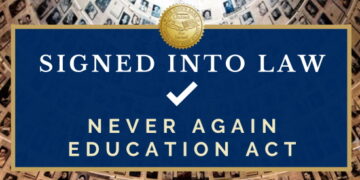














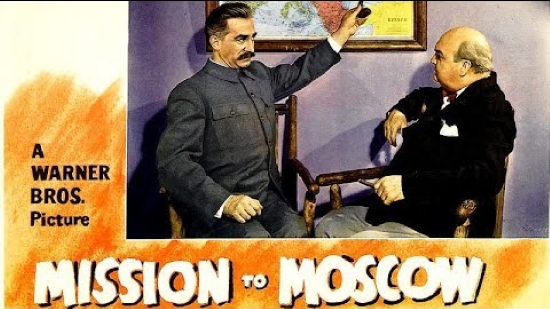



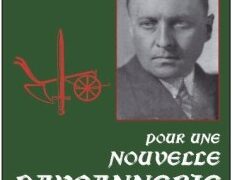


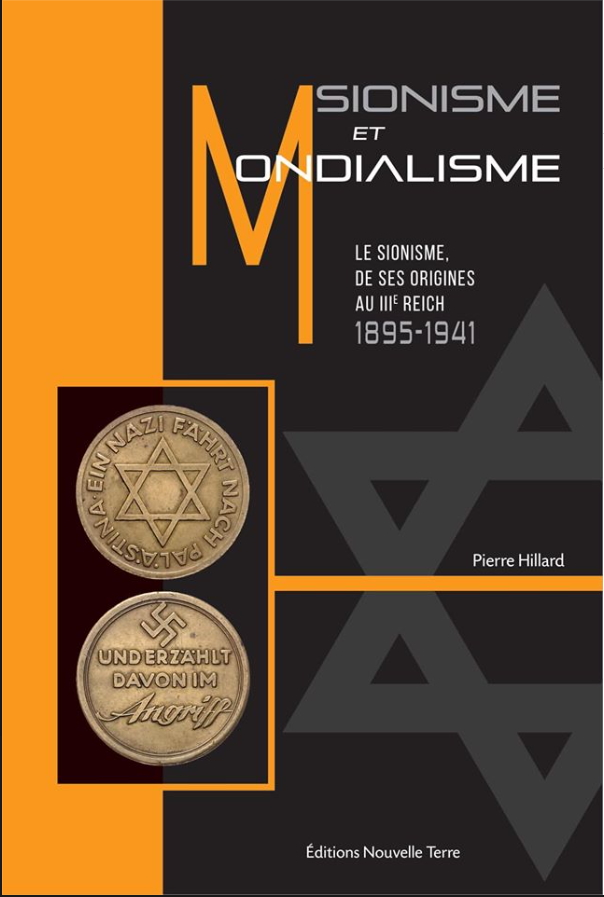
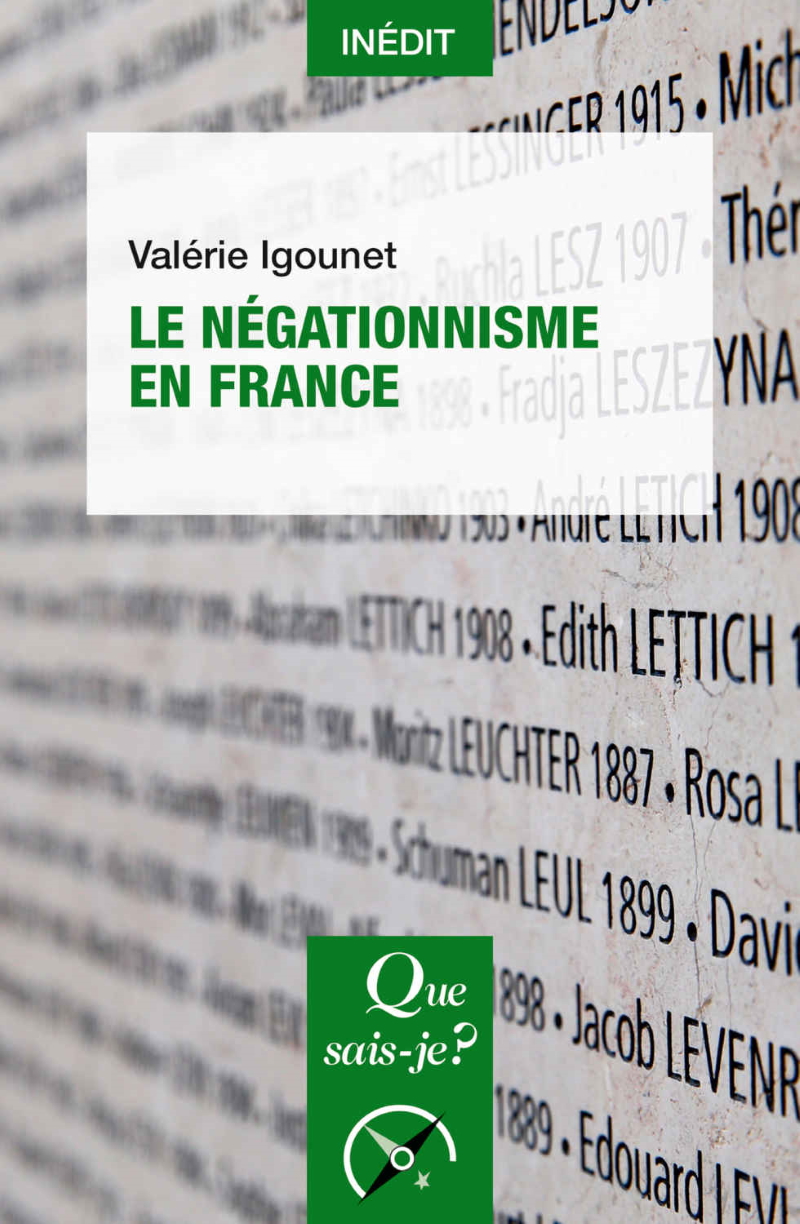



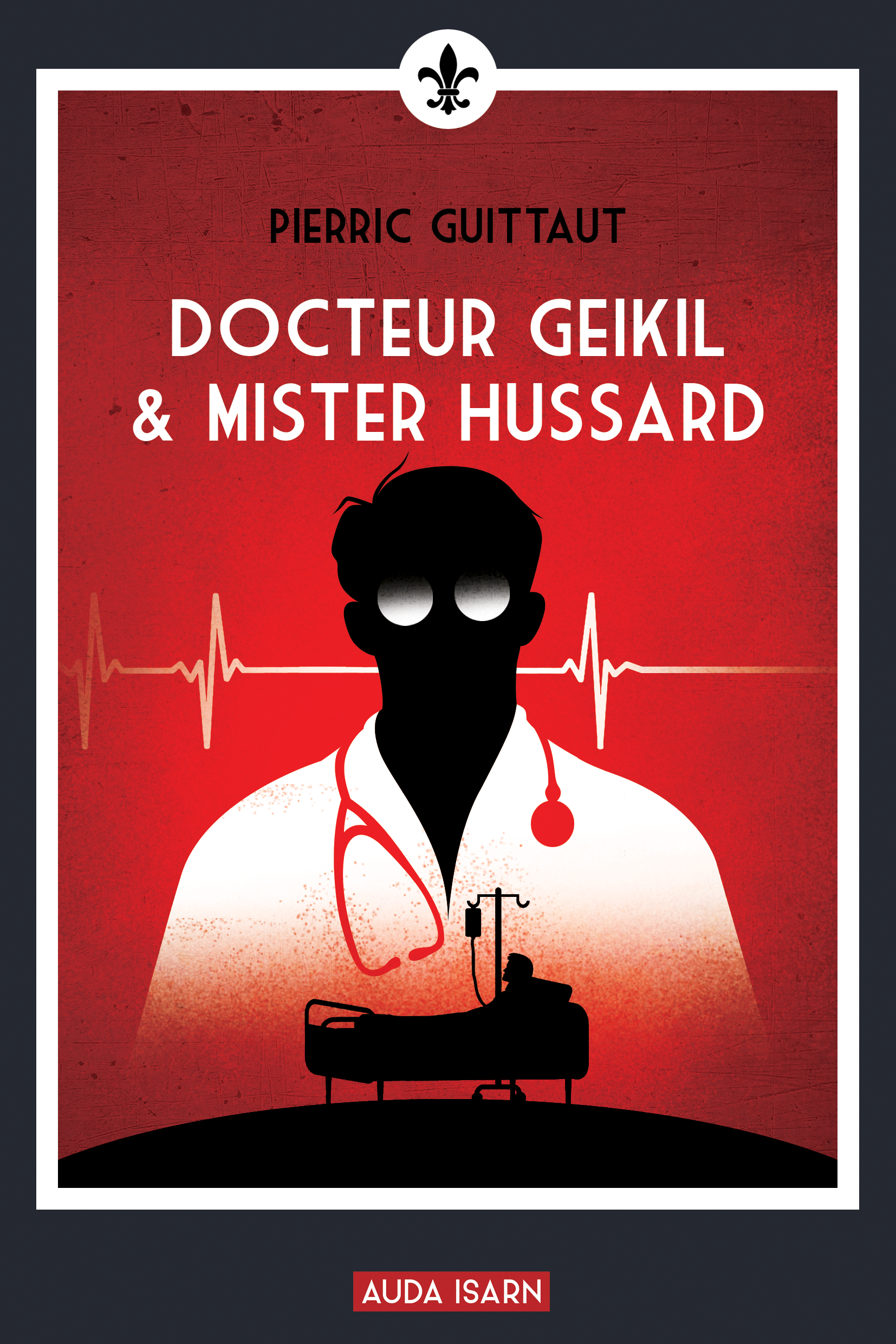



















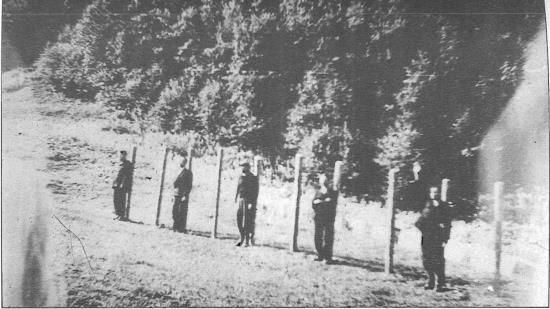
Bravo Monsieur Dortiguier, cela va alimenter quelques conversations ce midi 3 * 11 = 33 . On note aussi votre allusion discrète à la ville se Shepperton.
Les Gueules cassées sont une appellation réservée à ceux qui furent blessés à la face.
Il a a les Ailes Brisées, Les Blessés du Poumon, Les Blessés Multiples ou Impotents de Guerre, Les Aveugles de Guerre, les Blessés de la Tête, etc.
Il est vrai que peu de personnes actuellement sont au fait de cela. Quand est-il de ceux qui savent que la majorité des Lois sociales sont issues de ce conflit. Bref …
Bonjour,
En cette période de centenaire de l’armistice, l’encens va brûler « à flot » pour Georges Clémenceau.
Père la Victoire ? Il fut plutôt le père de la seconde guerre mondiale en se rangeant aux côtés des Anglo-saxons
qui prétendaient sauver l’Allemagne, son unité et son armée. pour empêcher la France d’obtenir une victoire éclatante sous peu.
Clemenceau, alors président du conseil (le vrai chef de l’état à l’époque), fut comme anesthésié pendant toute la période
où le président américain conclut SEUL l’armistice avec l’Allemagne.
Sur les 318 pages de son livre « Grandeurs et misères d’une victoire », il n’en consacre que 11, de peu d’intérêt, à l’armistice.
Toutefois, il laisse poindre comme un aveu quand il écrit: « Monsieur Poincaré développe contre moi son opposition à l’armistice
avec une extrême violence. »
Si on avait, à l’époque, écouté POINCARE, soutenu par les présidents de la chambre et du sénat, ainsi que les commandants en chef
français, PETAIN et américain, PERSHING, l’Allemagne aurait été contrainte à la CAPITULATION et l’on n’aurait jamais entendu
parler d’Hitler et de seconde guerre mondiale, prévue, dès 1918, par les militaires et quelques politiques lucides.
Quand à Foch, il prétendait devoir accepter l’armistice immédiatement « par humanité »… lui, pour qui le « matériel humain » ne comptait pas, lorsqu’il commandait la bataille de la Somme,
.
Voir encore, en annexe, le refus de Clemenceau de faire signer l’armistice sur le territoire allemand.
Bonne journée.
Th. Maquet
Rethondes, 9 novembre 1918.
« Excellence, « Les dernières paroles que vous prononçâtes lorsque nous nous quittâmes à Spa, furent les suivantes : « Allez avec Dieu, et essayez à obtenir le plus que vous pourrez pour notre Patrie. » « Ainsi que vous l’allez voir, j’ai fait de mon mieux…
« Mais, auparavant, laissez-moi vous dire que ce voyage fut pour moi un véritable calvaire, et que quoi qu’il en puisse résulter, il demeurera le souvenir le plus douloureux et le plus amer de ma vie politique.
« Notre voyage, Excellence, fut d’une lenteur désespérante, à cause des masses de troupes allemandes qui refluaient vers l’arrière.
« A la tombée de la nuit, vers six heures, nous arrivâmes à Chimay où le général allemand, gouverneur de la place, me fit dire que je ne pouvais continuer ma route ; car, pour mieux assurer la retraite de notre armée, le Haut Commandement avait fait abattre et jeter en travers de celle que je devais suivre, tous les arbres qui la bordaient.
« De plus, la route était d’autant moins sûre qu’elle était minée…
« Je n’en insistai pas moins pour poursuivre mon voyage et, après m’être mis en communication téléphonique avec l’État-Major le plus proche, qui se trouvait à Trelon, j’obtins enfin cette autorisation.
« Quand, vers sept heures et demie, j’arrivai dans cette dernière localité, le général commandant l’État-Major en question m’informa que tous les préparatifs avaient été faits du côté allemand, pour me faciliter le passage du front.
« Et, tandis que les pionniers achevaient d’enlever les mines sur la route, il m’annonça que, quoiqu’elles continuassent à se battre avec un courage admirable, les deux divisions qu’il commandait ne comptaient plus, l’une que 349 hommes valides, l’autre, 439 hommes en état de se battre.
« Cette révélation m’ancra plus avant dans cette idée qu’il fallait, coûte que coûte, conclure l’armistice.
« A neuf heures vingt, nous franchîmes le front allemand…
« J’avais emmené avec moi un trompette, un homme de cher moi, un Souabe qui, constamment, lançait de brefs appels et, sur l’avant de la voiture que j’occupais avec le comte Oberndorff, j’avais fait arborer un drapeau blanc.
« A cent cinquante mètres environ du front allemand, les premiers soldats français apparurent.
« Deux officiers français nous conduisirent aussitôt à La Capelle, localité voisine où, soldats et habitants, se montrèrent calmes et réservés à notre égard.
« Les rues portaient encore des indications en allemand. Sur un immense bâtiment, que décorait un drapeau français, on lisait en lettres énormes : Kaiserliche-Kreiss-Kommandantur.
« Les Français n’étant entrés en ville que l’après-midi même, La Capelle était entièrement pavoisée.
« On me conduisit aussitôt dans une villa, — la villa Francfort, — située à l’autre bout de La Capelle. Nous y trouvâmes les trois parlementaires allemands qui avaient annoncé notre arrivée.
« Les hostilités furent immédiatement suspendues de part et d’autre jusqu’à minuit.
« Par ordre supérieur, les autos allemandes dans lesquelles nous avions voyagé, furent consignées jusqu’à notre retour à La Capelle, et on mit à notre disposition des autos françaises.
« Chaque plénipotentiaire allemand eut la sienne et, dans chacune d’elles, prit place un officier français.
« Nous quittâmes la villa vers dix heures et demie et nous partîmes à la lueur des fusées, après avoir été photographiés.
« Notre voyage se poursuivit à une allure des plus lentes, les routes étant dans un état lamentable, et l’officier qui m’accompagnait, — un prince de la branche française des Bourbons, s’il refusa de nie dire en quel endroit nous nous rendions, ne m’en informa pas moins que cet endroit n’était pas éloigné de plus de cinquante kilomètres.
« Pas plus que lors de notre passage au front français, on ne nous banda les yeux.
« Nous traversâmes Guise, où les destructions étaient nombreuses et les ponts fortement endommagés et, vers une heure du matin, nous arrivâmes à Saint-Quentin. L’auto stoppa près d’une ferme, fort éprouvée par le bombardement et dans les ruines de laquelle était installée un Etat-Major français.
« Un souper avait été préparé à notre intention. Le général Debeney, qui se trouvait là en compagnie d’un autre général, me fit remarquer, — c’était évidemment une pointe à notre adresse, — que notre souper était exactement semblable à celui qui avait été préparé pour lui, de même que pour tous ceux qui l’entouraient, qu’ils fussent généraux ou simples soldats.
« Le menu se composait d’une soupe, d’un morceau de viande salée, de petits pois et d’un peu de fromage. Pour arroser le tout, on nous servit, — ainsi que le dit le soldat qui remplissait les fonctions de maître d’hôtel, — du « pinard ».
« Après une heure d’arrêt, nous continuâmes notre voyage par Chaulny, qui était complètement détruit. La ville offrait à nos yeux une succession de ruines, au milieu desquelles plus une maison ne restait debout.
« Sous la lune, l’ensemble paraissait spectral…
« Enfin, vers quatre heures du matin, nous arrivâmes devant la gare de Tergnier, dont nous dûmes enjamber les ruines, avant que d’arriver au train spécial qui nous attendait. On nous y servit de l’excellent cognac français.
« Mais, de même que précédemment, on refusa de nous dire où nous allions.
« Nous partîmes presque aussitôt et, vers sept heures du matin, le train s’arrêta en pleine forêt.
« Je remarquai que sur une voie distante d’une centaine de mètres de celle où, nous nous trouvions, stationnait un train semblable au nôtre.
« Les fenêtres ayant été fermées pendant tout le cours du voyage, et les stores baissés, je n’avais pu me repérer. Toutefois, j’y parvins le dimanche matin, car, ayant demandé à m’entretenir avec le maréchal Foch, un employé me répondit qu’il venait de partir pour Rethondes, afin d’y assister à la Sainte-Messe, faveur qui, d’ailleurs, me fut refusée sous prétexte qu’on ne célébrait qu’une seule et unique messe à Rethondes.
« De ce dernier nom, je déduisis donc que nous nous trouvions dans la forêt de Compiègne.
« Le lendemain, vers 9 heures (heure française), je fus informé que le maréchal Foch nous recevrait à 10 heures.
« Les trois autres plénipotentiaires et moi, nous nous rendîmes en simple costume de voyage, — les officiers ayant conservé la tenue de campagne, dans le train spécial d’en face.
« Dans le wagon-salon, une grande table avait été installée, avec quatre sièges de chaque côté. Nous nous plaçâmes derrière ceux qu’on nous désigna comme étant les nôtres.
« Peu de temps après, le maréchal Foch fit son apparition…
« C’était un petit homme (sic) aux traits énergiques et qui trahissait au, premier coup d’œil l’habitude du commandement.
« Il était accompagné du chef de son Etat- Major (général Weygand) et de trois officiers de la Marine anglaise.
« Il fit un bref salut militaire et s’inclina.
« Je présentai, — en allemand, — mes collègues et remis au Maréchal mes pleins pouvoirs.
« A son tour, il nous présenta les personnes qui accompagnaient ; Sir Weymiss, Premier Lord de l’Amirauté britannique ; le général Weygand, chef de son État-Major particulier ; l’amiral anglais Hope et, comme interprètes, le Français Laperche et l’Anglais Bagod.
« Il n’y avait là, ni Américain, ni Italien, ni Belge. Nous nous trouvions donc en présence du seul Haut Commandement interallié…
« Après avoir reçu nos pleins pouvoirs, le Maréchal passa avec ses collègues dans le compartiment voisin, afin de les examiner.
« Le maréchal revint bientôt et, en français, demanda : — Qu’est-ce qui amène ici ces messieurs ? Que désirent-ils de moi ? « Je répondis aussitôt que j’attendais les propositions relatives à la conclusion à un armistice sur mer, sur terre, dans les airs et sur tous les fronts.
« Le Maréchal Foch répondit catégoriquement : — Je n’ai pas de propositions à faire ! « Je lui fis remarquer alors que nous étions venus, conformément à la dernière note du président Wilson, et j’ajoutai que je demandais communication de ces propositions.
« Le Maréchal Foch ordonna aussitôt à son chef d’État-Major de lire en français les conditions de l’armistice que vous trouverez ci-jointes.
« Le moins qu’on en puisse dire est qu’elles sont désastreuses, humiliantes et, pour la plupart, inacceptables.
« Les interprètes en firent immédiatement la traduction.
« Pendant la lecture, l’amiral sir Weymiss jouait avec son monocle et affectait une grande indifférence. Mais, il n’arrivait pas à dissimuler son émotion intérieure.
« Quant au Maréchal Foch, il était assis à sa place dans un calme de statue (sic). De temps d’autre, il tirait sa moustache d’un geste énergique.
« Pendant toute la lecture, aucune remarque ne fut faite ni d’un côté, ni de l’autre.
« Dès qu’elle eut pris fin, je demandai qu’on, me permit de me mettre en communication par radiotélégramme avec le Chancelier d’empire et le Grand Quartier Général allemand.
« Le Maréchal Foch s’opposa à ce que les conditions d’armistice fussent transmises en clair : je pouvais les transmettre à mon choix, soit par télégramme chiffré, — ce qui m’apparut impossible, étant donnée la longueur des textes, — soit par courrier spécial.
« J’adoptai immédiatement cette dernière alternative.
« Mais, je demandai que les délais accordés pour l’acceptation ou le refus des conditions de l’armistice, fussent portés de 72 à 82 heures, parce que, il était matériellement impossible à un courrier, d’atteindre Spa avant, au moins, douze heures.
« Cette proposition fut repoussée.
« Le Maréchal repoussa également la proposition que je fis d’une cessation provisoire des hostilités pendant le temps destiné à l’examen des conditions ci-jointes.
« De plus, il me déclara nettement, qu’il ne serait aucunement permis de négocier au sujet de ces conditions.
« — L’Allemagne, ajouta-t-il, doit les accepter ou les refuser. Il n’y a pas de milieu ! « On fixa alors les délais de l’ultimatum au 11 novembre à onze heures du matin (heure française).
« Après quoi, nous nous séparâmes.
« La séance avait duré trois quarts d’heure exactement…
« Je vous envoie donc, Excellence, le capitaine von Helldorff. En même temps que ce rapport, il vous remettra les conditions de l’armistice.
« Encore qu’il soit peu probable qu’on nous permette de faire des contre-propositions, je n’en vais pas moins essayer d’obtenir des adoucissements, dans le but de maintenir l’ordre en Allemagne et d’éviter la famine menaçante.
« J’essaierai également d’obtenir une prolongation des délais de livraison en ce qui concerne le matériel qu’exigent de nous les Alliés, ainsi qu’une réduction des quantités de pièces d’artillerie, de mitrailleuses, d’avions, de locomotives, de wagons et de machines industrielles ou aratoires qu’ils nous réclament.
« J’ajouterai que les conditions qu’on nous impose sont inexécutables, car, non seulement elles désarment l’Allemagne, la livrant ainsi au bolchevisme, mais aussi que, par surcroît, l’anarchie et la famine seraient les conséquences immédiates de leur acceptation par nous.
« Enfin, j’exigerai la cessation immédiate du blocus et, si possible, la libération non moins immédiate des prisonniers de guerre faits par les troupes alliées.
« De toutes façons, — et autant que cela me sera possible, — je m’efforcerai d’arracher notre Patrie à l’esclavage économique qui la menace.
« C’est avec l’espoir de mener à bien cette tâche que je suis de Votre Excellence, le très fidèle et très obéissant serviteur.
« Mathias Erzberger. »
Question badernes… Je me permets de vous suggérer de lire de Henri Fraenkel: « Joffre, l’âne qui commandait des lions » qui taille un costard sur mesure à ce frère « Trois-ponts » inepte, en retard d’une guerre, que Lanzerac (le marquis de Cazernal) avait surnommé « …comme la Lune! » (Joffre le rondelet avait coutume de s’exclamer « Attaquons! Attaquons!… »). Du même Joffre, lorsqu’on lui annonçait des « Maxim » à couvert et camouflées – servies par des mitrailleurs en „Feldgrau” – et battant de leurs tirs croisés le glacis de la zone de déploiement de l’infanterie française (pantalons et casquette garance et paletot bleu foncé entre les deux: viser entre les deux taches rouges) impavide, il répliquait: « Nos braves dénoueront la situation à l’arme blanche! ». Quant au jésuite Foch, lorsque, peu avant la guerre, il lui avait été donné d’assister à une démonstration d’aviation; il avait murmuré: « intéressant surtout pour les activités sportives… ».
Merci pour votre hommage subtil à notre grand honnête homme récemment parti plus près de la vérité.