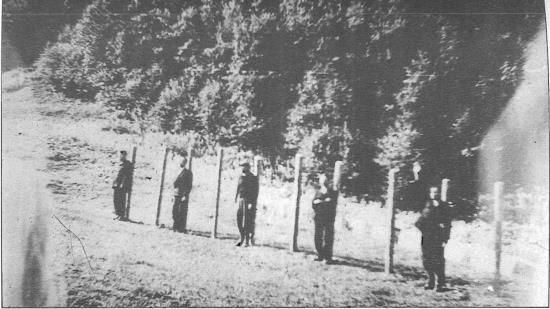Bernanos : le médium avec ou sans fluide par Robert Poulet
Nous célébrons aujourd’hui le 120e anniversaire de la naissance de Robert Poulet, l’un des plus importants critiques francophone du XXe siècle. Né le 4 septembre 1893 à Liège, il a 21 ans lorsque commence la Grande Guerre. Il abandonne ses études d’ingénieur des Mines, se porte volontaire et combat dans les corps francs. Tenté par l’agriculture, le cinéma, il finit par s’imposer en littérature, et c’est l’écrivain reconnu qui accueille l’arrivée des troupes allemandes en 1940.
Robert Poulet s’engage totalement dans la grande révolution européenne. Il paiera son engagement par une condamnation à mort qui finira par être commué en une sentence d’exil après de longues années de prison. C’est en France qu’il poursuit sa carrière, notamment comme critique littéraire à Rivarol. Il est mort le 6 octobre 1989, laissant une abondante œuvre littéraire, romanesque, poétique, théâtrale, critique et pamphlétaire.
Voici un texte extrait des Cahiers de l’Herne consacré à Georges Bernanos.
Bernanos : le médium avec ou sans fluide par Robert Poulet
Pour aller au centre de Bernanos, il faut d’abord écarter un certain nombre de faux-semblants.
Avouons-le donc sans barguigner : cet homme de génie n’était pas un vrai romancier, ni un essayiste solide, ni un pamphlétaire efficace. Dans tous les genres qu’il a abordés, on le vit gauche comme l’albatros de Baudelaire chaque fois qu’il ne put déployer ses « ailes de géant » ; lesquelles, d’autres fois, l’emportèrent malgré lui dans les directions les plus inattendues. Ses personnages de Sous le soleil de Satan et du Journal d’un curé de campagne ne vivent pas par eux-mêmes ; ce sont des fantômes dans lesquels il s’incarne, et que les puissances de sa respiration suffisent à remplir prodigieusement – avec toujours les mêmes angoisses, les mêmes souffrances, de possédé en plein exorcisme. Les aventures auxquelles s’abandonnent ces êtres à la fois artificiels et palpitants n’ont pas plus de commencement, de milieu et de fin que les couloirs des limbes. Un Dante qui aurait perdu son guide et qui se serait trompé d’enfer eût vu le monde des hommes sous cet aspect uniformément sulfureux, où ne naît point une action romanesque, à proprement parler. Rien que des crises et des extases.
Puis le meneur de jeu, qui ne s’écarte jamais de la scène, ne nous permet point de comprendre l’affaire à notre façon ; si nous passons outre, il se jette sur nous, il nous impose le combat de Daniel avec l’ange, où nous sommes battus d’avance. À l’arrière-plan se déploie quelque chose d’effrayant ou de déchirant, où nous reconnaissons avec stupeur les sereines croyances que l’Église a tirées de l’Évangile. Où loger la paix du cœur, dans cette vision que brandit devant nous un convulsionnaire, et où toutes les suavités invisibles dont nous avons l’esprit pétri et le cœur attendri prennent des proportions monstrueuses, quoique d’une inégalable richesse morale ?
Ne parlons pas des autres romans de Bernanos, échecs majestueux et consternants, qui ont laissé au milieu du siècle des amas d’informe sublimité qui se nomment La joie, L’imposture, Monsieur Ouine…
D’autre part, si La Grande peur des bien-pensants et Les grands cimetières sous la lune doivent être classés parmi les pamphlets, nul ne peut dire ce qu’ils veulent prouver, ni à qui ; diatribes tournoyantes qui bientôt se confondent avec la protestation générale de l’humain contre les hontes de sa condition. Et de même les écrits de 1940-48, où la colère et la douleur tournent en rond, vomissant sur toutes les causes et sur toutes les idées les flots d’une éloquence ivre d’elle-même. Peu d’écrivains furent ainsi aveuglés par la flamme des mots qu’ils avaient le don de porter à l’incandescence. Rappelons-nous que l’auteur de Mouchette se passionnait pour la politique, et que personne n’a jamais pu dire exactement, point par point, quelles étaient ses convictions à ce sujet.
Il était armé d’une espèce d’intelligence qui brouillait immédiatement tout ce qu’elle concevait, et d’une espèce de sensibilité qui tôt ou tard le dressait avec fureur contre tout ce qu’il aimait. Si bien qu’affolant autrui et s’affolant lui-même, sans changer jamais d’opinion, il put lutter dans les rangs de l’Action française et mourir dans les bras d’Esprit, qui en est le contraire ; maurrassien révolté, anti-démocrate forcené, adversaire virulent du « catholicisme de gauche », qui n’eut pourtant d’autres ressources que de prendre pour héritier Albert Béguin… Il n’y a presque aucun maître à penser, entre 1920 et 1950, qu’il n’ait successivement assuré de son enthousiasme et accablé de reproches sanglants, ou l’inverse. Quels tourbillons de fumée, autour de cette âme de fer !
Logiquement, on ne peut rien conclure de l’immense effort auquel ce chrétien, ce patriote, ce soldat, ce prophète, s’astreignit durant un quart de siècle, pour sauver la société civile comme la société religieuse. Tout cela se perdit dans le tonnerre et dans les éclairs de son inspiration. Surtout parce que les réalités, dès qu’il les nommait seulement, s’abstrayaient sous sa plume, s’évaporaient en entités qui lui faisaient le même effet qu’à Don Quichotte les moulins.
Quel sens précis, par exemple, faut-il donner à cet « honneur » dont l’écrivain politique Bernanos fait un si impressionnant usage, sans qu’on puisse savoir au juste s’il s’agit de l’estime donnée à la vertu, du sentiment qui fait qu’on veut conserver la considération de soi-même, de la qualité qui porte à faire des actions nobles et courageuses, de la vertu, de la probité, ou de quelque autre objet ? Et dans quel sens précis peut-on parler de l’honneur d’une nation, expression dont il abuse ?… Pour ne rien céler, l’exaltation bernanosienne touche fréquemment à la logomachie, au verbalisme le plus inconsistant, justement parce qu’un tel homme ne peut jamais redescendre au niveau de la simple raison, où il se banalise. Quand il y est contraint un moment, le moins qu’il puisse faire, c’est de ricaner avec hauteur et impatience, comme un prince captif.
Une analyse attentive de ses ouvrages laisse tout de suite soupçonner qu’ils naquirent tous d’une amplification effrénée et aberrante. Il y a des auteurs qui imaginent une chose et qui la font ; il y en a qui partent d’un point et qui arrivent à un autre, parfois aussi éloigné du premier que l’est, d’un simple hommage à Drumont, la mise en accusation de toute la civilisation bourgeoise, sur le mode sybillin et apocalyptique. Les deux histoires de Mouchette, ce sont de modestes feux de cheminée qui finissent en éruptions volcaniques et en effondrements d’Atlantides. Visiblement, le romancier ou le pamphlétaire, attaquant un sujet, ne savait jamais où son démon intime le conduirait. Ce fut, avec toute sa fulguration de fond et de forme, un des génies les plus intuitifs qu’on ait jamais vus. Mais intuitif comme un médium ; et l’on n’ignore pas que tous les médiums doivent se faire, à certains moments, prestidigitateurs.
De là le départ qui s’impose, entre le Bernanos en transe et celui qui ne l’est pas. Car, chez lui, tout est question de fluide. Le ton qu’il prend, aussi bien dans la narration que dans le discours direct, est le ton d’un personnage soulevé au-dessus de lui-même, habité par des forces inconnues, chargé, par on ne sait quel démiurge, de dévoiler au monde les sombres mystères qui se déroulent dans quelques âmes prédestinées, ou de jeter une lumière de malédiction sur les événements du siècle et sur leurs promoteurs.
Il y a là quelque chose d’assez extravagant, qui passe les plus ambitieuses ambitions du romantisme et qui ne se justifie que par l’autorité avec laquelle le mage-homme-de-lettres exerce cet étrange emploi. En conséquence, la vibration extraordinaire qui ne cesse d’agiter et d’enfler son langage eût supposé une sincérité totale, non seulement à l’égard du sentiment ou de la pensée qu’il exprime, mais encore envers tous ses moyens d’expression.
Il faut bien dire qu’une telle disposition n’apparaît pas tout le temps, et qu’il arrive à Georges Bernanos de « faire comme si » quelque dieu l’habitait, avec les mêmes emportements sonores, le même lyrisme tantôt mystique tantôt mordant, le même roulement épique de la phrase, qui arrache au vocabulaire des images semblables à des étincelles ; avec le même « enthousiasme » de tragique grec, ou de solitaire épelant des signes dans les astres. Pour admirer et pour aimer avec bonne conscience un tel écrivain – l’un des trois ou quatre qui aient, depuis cinquante ans, apporté un accent nouveau dans la littérature française – il faut avoir le courage de reconnaître que souvent sa musique sonne faux, justement parce qu’elle se tient sans cesse sur les notes hautes.
Embarras qui rappelle, encore une fois, celui des médiums abandonnés momentanément par leur pouvoir, et contraints dès lors de se métamorphoser en illusionnistes. Autrement dit, en tricheurs plus ou moins adroits. De cette manière, Bernanos triche quelquefois, substituant dans sa prose un sublime voulu et forcé au sublime véritable, qui lui est familier et dont il ne peut se passer pour alimenter l’oracle ininterrompu que son œuvre constitue.
Sachons ne pas confondre chez lui les moments d’intense vibration spontanée, qui sont incomparables, par l’irradiation spirituelle qui se dégage de ces éclats apparemment incontrôlés, avec les moments d’emphase et de boursouflure, où il tente, avec une visible inquiétude, de se maintenir à ce paroxysme, climat nécessaire de son talent.
Ne regrettons pas que les splendeurs du verbe, que les chaleurs de l’émotion, soient payées d’un tel prix, dans les livres qui ne convenaient absolument pas – non pas même dans les passages de pseudo-bonhomie – aux déambulations de la muse pédestre. Aucune comparaison n’est possible entre le lyrisme extérieur et décoratif d’un d’Annunzio et le lyrisme intérieur de Bernanos, souvent déclamatoire pourtant, et creux à la façon d’un arc-de-triomphe reposant sur ses piliers. Nous savons qu’un tel poète de l’incantation hasardeuse n’a rien de l’imposteur, puisque la température à laquelle il porte son discours est réellement celle de ses sentiments et de ses pensées, et puisqu’il est normal que les uns et les autres ne répondent pas toujours à cet appel.
L’étonnant, c’est que la conjonction se produise aux moments qu’il faut, et qu’aucun écrit de Bernanos ne soit tout à fait dépourvu du fluide qu’il se met toujours en état de recevoir et de diffuser.
La forme à laquelle il recourt, par un mouvement naturel, n’est pas autre chose que la rhétorique traditionnelle. Bien que les procédés en soient distendus, échauffés par la fièvre qui les alimente, ils n’en gardent pas moins le plus souvent l’aspect paradoxal d’un raisonnement, d’une construction logique, même dans la conduite narrative des romans.
C’est là le fond classique de ce romantique exaspéré, qui aurait probablement sombré dans « l’insignifiance de l’exagération », où se sont engloutis naguère les Vacquerie, les Péladan, les Cladel, sans cet équilibre sous-jacent, base d’une frénésie mentale et sentimentale qui garde son style, sinon sa mesure, et qui fait penser aux derviches hurleurs d’Asie Mineure, qu’on voit se convulser dans les ruines d’une cité romaine, au nom d’une dévotion supérieure qui n’a que les apparences de l’égarement.





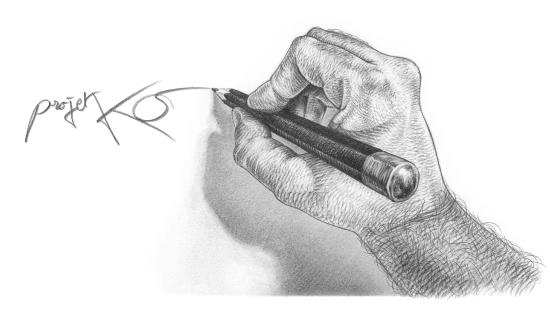


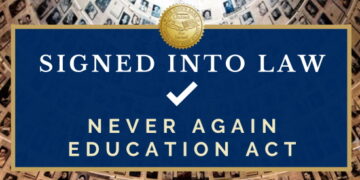














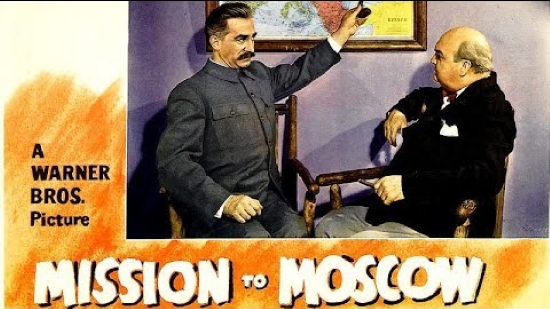



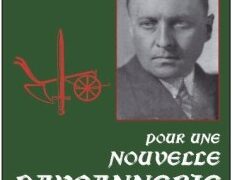


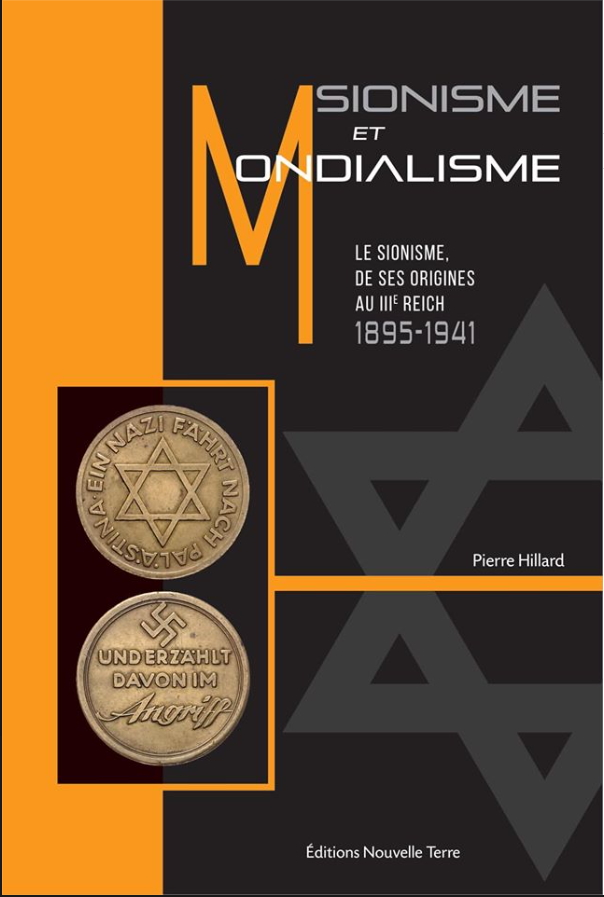
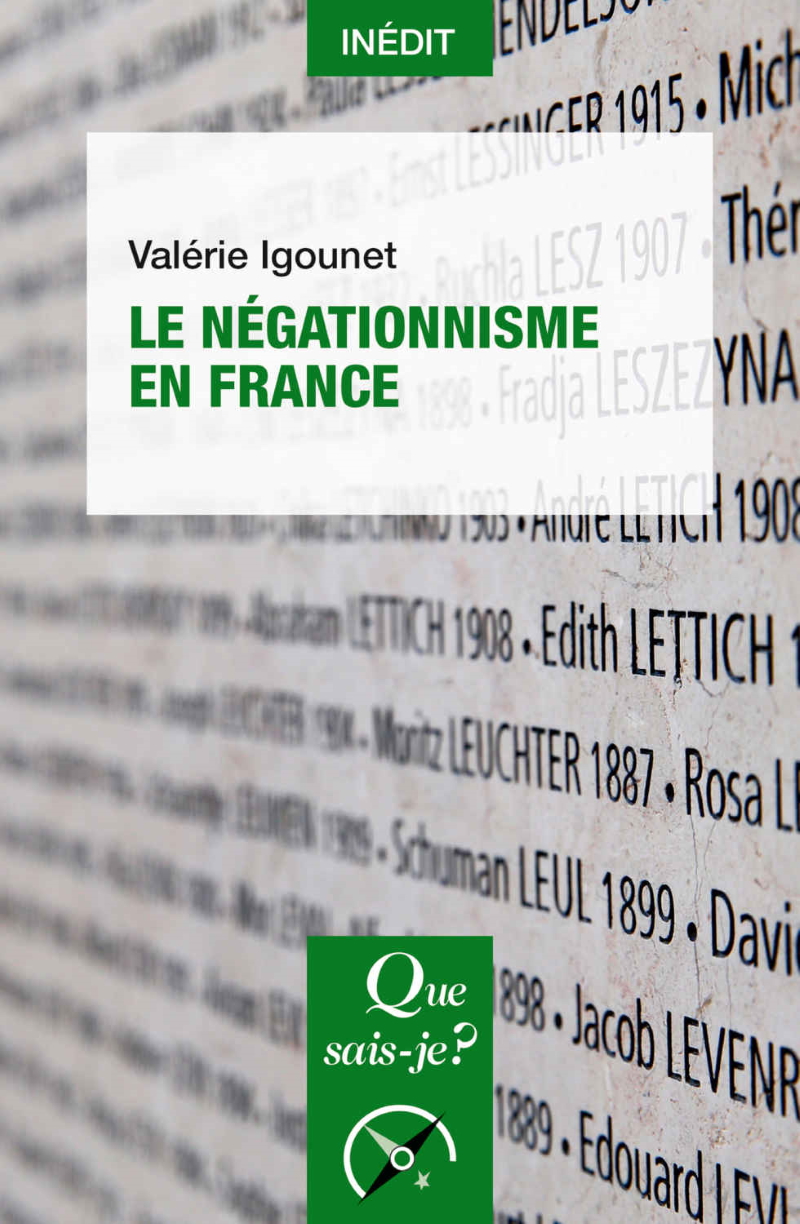



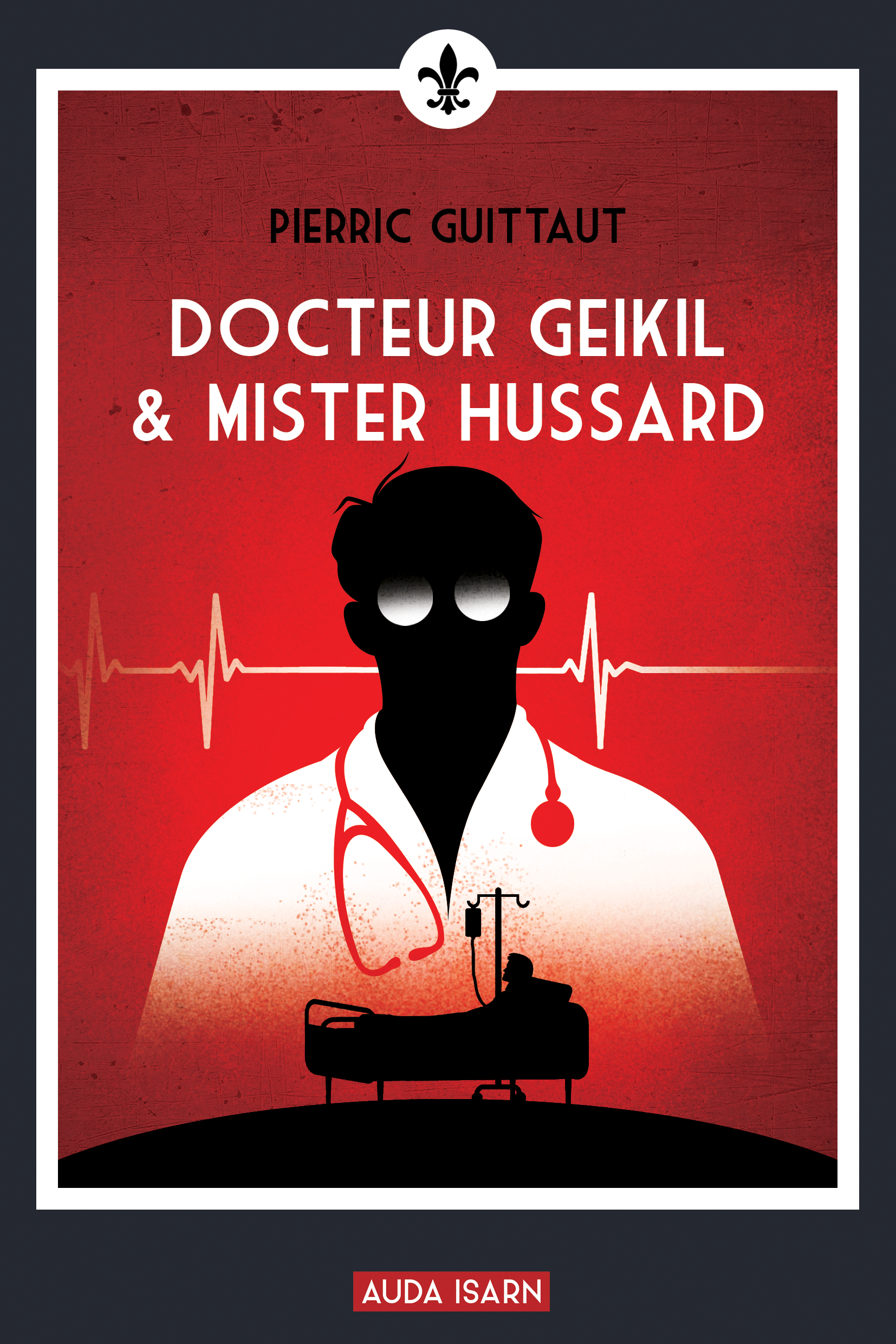









 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV