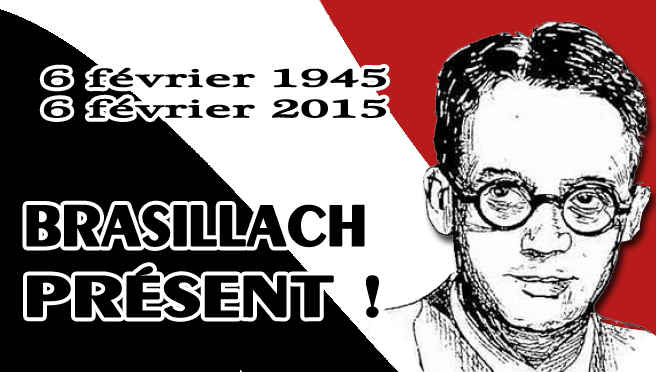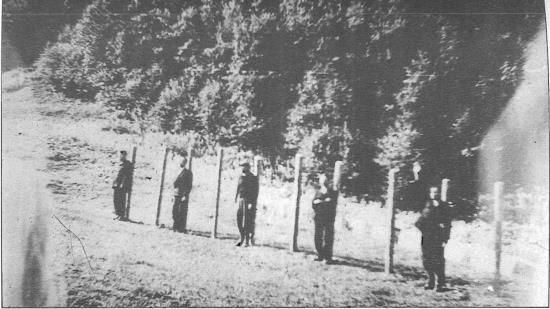Devant les sections d’assaut du national-capitalisme (par R. Brasillach)
Ce qui a fait le plus de mal, depuis un siècle, à la cause nationaliste (comme d’ailleurs à la cause religieuse), c’est l’alliance indiscutable qu’elle a presque toujours maintenue avec les puissances de l’argent. Aucune campagne des hommes de gauche n’a été plus justifiée que la campagne des « marchands de canons ». Aucune attitude anarchiste n’a été plus louable que l’hostilité à l’égard des « mainteneurs du moral de l’arrière », des bourreurs de crâne patriotiques, et des mensonges des guerriers en pantoufle. Mais alors même que la bourgeoisie — cela s’est vu — mettait ses actes en accord avec ses paroles, et sacrifiait les meilleurs de ses fils comme en 1914, la vivacité éclatante de l’union entre la patrie et l’argent rendait aux yeux des masses ouvrières l’héroïsme lui-même suspect, et faisait nécessairement de sa cause une cause ennemie. On n’a pas à juger pour l’instant de la part d’injustice que suppose une telle attitude. Elle est un fait. La réconciliation du socialisme et de la nation est la grande tâche de la Révolution du XXe siècle, tâche qui a été manquée, ici et là, malgré le génie des initiateurs, et tout particulièrement dans les pays latins. Mais cette réconciliation est à entreprendre en reprenant tout à la base. Les collaborationnistes français avaient cru pouvoir la réussir grâce à l’exemple allemand. Mais ils se sont rapidement fait enlever cette magnifique position, et leurs adversaires ont ainsi discrédité le collaborationnisme, qui apparut aux ouvriers comme un nouveau « truc » pour camoufler le capitalisme de combat. C’était bien loin, pourtant, de la vérité.
Ceux qui la prêchent montrent la plupart du temps le bout de l’oreille. Patrons anxieux de maintenir un ordre qui leur est profitable (fût-ce au prix de menus sacrifices), politiciens qui veulent la paix pour eux, ont prôné l’amitié des classes entre elles, sur un ton passablement cafard, qui ne change rien aux réalités. Ainsi ont-ils réussi d’ailleurs à jeter la suspicion sur les réussites matérielles, parfois fort louables, d’hommes énergiques et ayant le sens de leurs responsabilités de chefs. Mais, avec une adresse qui apparente la bourgeoisie à l’ancien radicalisme, ils ont cru pouvoir saisir, dans le monde moderne, les occasions apparentes offertes par les régimes neufs pour identifier leur cause à celle de la Révolution du XXe siècle. C’est là l’équivoque qu’il faut éclairer un peu, sans grand espoir, et contre laquelle il faut énergiquement protester.
Il est de fait que le fascisme italien a semblé à beaucoup, voici quinze ou vingt ans, être comme une sorte d’assurance un peu rude contre les subversions marxistes : l’histoire vient de nous apprendre que c’est malheureusement ainsi que l’Italie elle-même, ou plutôt ses classes dirigeantes, sa bourgeoisie, son aristocratie, son roi, son Église, l’avaient bien compris. D’où, vers les pâles imitations françaises qu’on a pu faire du fascisme, la ruée des bourgeois. Quelques-uns y furent courageux, je ne veux point le nier. La plupart ne cherchaient que des sections d’assaut et de protection à bon marché, le meilleur marché possible d’ailleurs, car la bourgeoisie française n’attache pas ses gladiateurs avec des saucisses. Et, bien entendu, plus un parti, plus un mouvement, était bourgeois, incapable et modéré, plus il avait d’adhérents parmi les conservateurs : ainsi Gil Robles en Espagne, La Rocque en France. Mais, dans les autres ligues elles-mêmes, il est sûr que les bourgeois ont vu le moyen, avec quelques subventions, de se protéger : ce fut le cas, tout aussi bien, de l’AF que du Faisceau, de la Solidarité, ou, plus tard, du PPF auquel s’intéressait M. Pucheu. Les ligues ou mouvements, leurs militants surtout, parfois leurs chefs, n’avaient pas toujours la responsabilité directe de cette déviation, mais la bourgeoisie savait s’en servir, c’est un fait. Comme elle se servait d’ailleurs, sur un autre plan, du radicalisme parlementaire. Et c’est ainsi qu’on en vint à identifier, dans les masses ouvrières, le « fascisme » avec la « réaction ». L’apparence donnait raison aux masses.
La mystification, avouons-le, n’est pas encore complètement dissipée. On est toujours très chatouilleux sur l’authenticité de tel ou tel fascisme dans les hôtels particuliers d’Auteuil ou dans les luxueuses maisons de campagne à la mode américaine. Mais on sait bien qu’il s’agit là d’une aimable plaisanterie, et que la conservation des privilèges de l’argent reste le premier devoir, et la seule besogne sérieuse. De temps à autre, on se permet d’ailleurs quelque diversion, quelque attaque verbale contre cet argent, on chante, en redressant le col, quelque chanson révolutionnaire, on tient des propos pour faire frémir les bourgeoises. Mais les bourgeoises aiment frémir, chacun sait ça. Quand on redevient sérieux, on convient qu’un patron est un patron, que le fric c’est le fric, et que les jetons de présence sont les seuls insignes avouables du national-capitalisme.
Nous n’aurons pas la faiblesse de nous en étonner. La conjuration est d’ailleurs organisée d’une manière parfaite, avec tout ce qui est nécessaire comme rabatteurs, agents de publicité, chantres, bedeaux et même suisses. Le vocabulaire moderne, rendons-lui cette justice, est facilement assimilable, même pour l’intelligence moyenne des fruits secs de la bourgeoisie. On peut aisément faire, sans quitter son chez-soi, une grande consommation d’héroïsme, de sens de la grandeur, de monde nouveau à construire et de Révolution en marche. Les anthologies de « bourrage de crâne » de toutes les guerres, celle de 1914 et celle de 1939, nous ont abondamment fourni de textes déshonorants sur nos petits soldats, l’ignominie de l’adversaire, et la France immortelle. Ils étaient composés, comme on le sait, par des académiciens, des généraux en retraite, des correspondants de guerre, des inspecteurs généraux, spécialistes des « livres roses pour la jeunesse », des dames d’œuvres, et toute la tribu des bien-pensants. Les choses ne changeront pas de sitôt, avec parfois des améliorations. Nos Déroulède1 et nos Lavedan2 n’ont même plus toujours l’excuse de l’âge, et l’on en voit qui ont à peine barbe au menton et qui pincent allègrement la lyre héroïque retrouvée au grenier. Tout comme jadis, la bourgeoisie sait exhorter les autres à partir pour le travail sacré, pour la défense de l’Empire, pour le sacrifice suprême, pour la civilisation en péril. Pourvu que le chéri ne parte pas, que le fils ne parte pas, que le gendre ne parte pas, tout sera pour le mieux. On ferait à nouveau de belles anthologies avec les héroïsmes bourgeois sur le papier.
Comment veut-on, tant que cela durera, que la réconciliation du national et du social puisse se faire ? Elle était déjà malaisée, car la justice n’est pas le propre des hommes, aux temps où la bourgeoisie prenait sa part des sacrifices : essayez par exemple de faire entendre aux ouvriers qu’ils furent souvent les relatifs privilégiés de la guerre de 1914, que les paysans, artisans et bourgeois furent sacrifiés, qu’il y eut proportionnellement plus d’officiers de réserve tués que de soldats ! Ces vérités élémentaires n’ont jamais eu beaucoup de crédit. Mais aujourd’hui où ouvriers, fonctionnaires, artisans composent à coup sûr la classe déshéritée de la nation devant le bloc heureux des riches bourgeois et des paysans, comment veut-on qu’on prête raisonnablement l’oreille à ceux qui défendent par la parole les situations acquises ? Ils peuvent employer tous les mots nouveaux, on sait très bien qu’ils ne sont que les adeptes de la seule vraie religion, du seul vrai parti, de la seule vraie politique : le capitalisme. « Nous qui sommes nationaux-socialistes… », disent-ils dans les thés du XVIe arrondissement, et les belles dames à turban s’inclinent avec ravissement, chatouillées au bon endroit par un vocabulaire aussi hardi. Mais au fond d’eux-mêmes, eux qui ont déjà souillé l’idée de patrie par leur vieille vérole de l’or, ils tremblent, parce qu’ils souillent l’idée du socialisme, et parce que si le quart des mesures prises contre leurs pareils en Allemagne était appliqué ils miauleraient comme chats échaudés.
Non, nous n’avons pas de rapports avec ces gens-là. S’ils vivaient dans une autre planète, dans les ghettos d’Auteuil ou de Passy, nous pourrions hausser les épaules devant leur offensante existence, et nous en accommoder. Mais, comme la faim fait sortir le loup du bois, l’argent fait sortir les capitalistes du bois de Boulogne. L’argent, ou la défense de l’argent. Ils montent alors en épingle leurs petits malheurs, s’ils ont la chance d’en avoir connu, ou ceux de leurs amis, et ils commencent à racoler de bons bougres, parfois incompréhensifs. Au nom de la Révolution nouvelle, ils se feraient volontiers sergents recruteurs, car il n’y a point de besogne basse pour qui défend son argent. Et ils proclament qu’ils « vont au peuple ».
Nous n’avons pas, nous, à aller au peuple, puisque nous sommes du peuple — sans démagogie, sans « cœur sur la main ». Nous en sommes tout naturellement par nos soucis, par nos désirs, par nos dégoûts, surtout par nos dégoûts. Nous nous refusons à pousser les jeunes gens à des entreprises que nous nous garderions bien de commencer pour notre propre compte. Nous n’avons pas de capitaux à défendre. Nous voulons nous contenter de dire ce que nous croyons la vérité, sans y ajouter un gramme de plus. Les chorales héroïques, la presse à sensation à la mode de l’avant-guerre, les photographies d’assassinés et les interviews des victimes, l’orchestration savante des rodomontades, ce n’est pas notre fort. Il y a assez de biens à défendre dans notre rude temps : la réalité nationale, le socialisme à venir, la réconciliation franco-allemande. Ils nous suffisent. Mais il faut pour cela dénouer les liens qui ont attaché depuis tant de décades l’ordre et l’argent. On n’accoutumera pas le peuple français à un ordre nouveau sans rompre le culte de l’or. Il faut que la jeunesse se méfie des maîtres d’hôtel en livrée bourgeoise qui viennent l’inciter à partager les repas de veillées d’armes du national-capitalisme toujours en éveil.
____________________________________
NB : Cet article a été publié par Robert Brasillach durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale.
1 Paul Déroulède, écrivain patriote (1846-1914), il fut l’un des « apôtres de la revanche » contre l’Allemagne.
2 Henri Léon Émile Lavedan, journaliste et dramaturge patriote et antisémite, académicien (1859-1940).





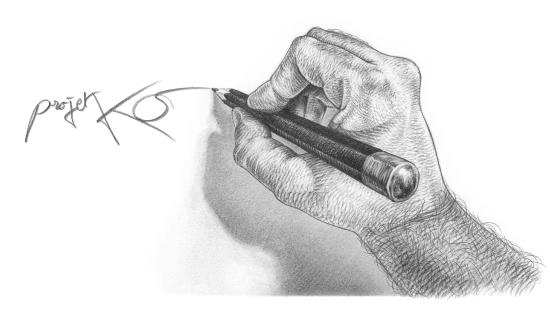


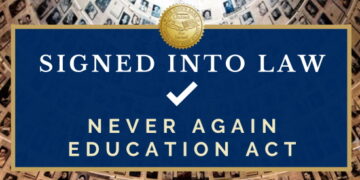














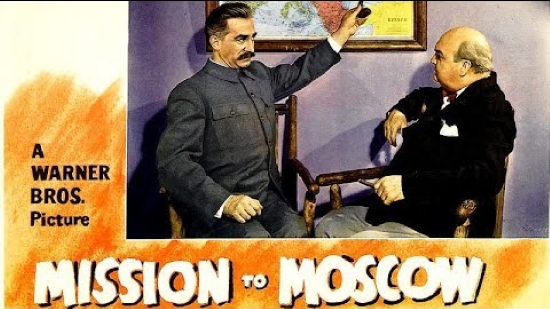



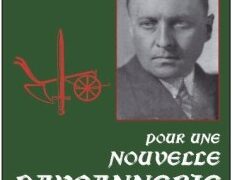


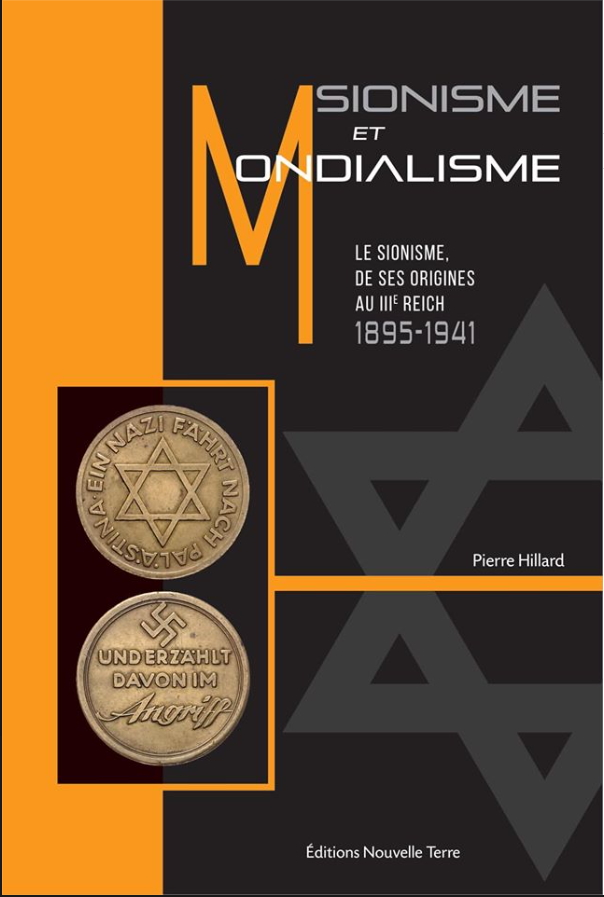
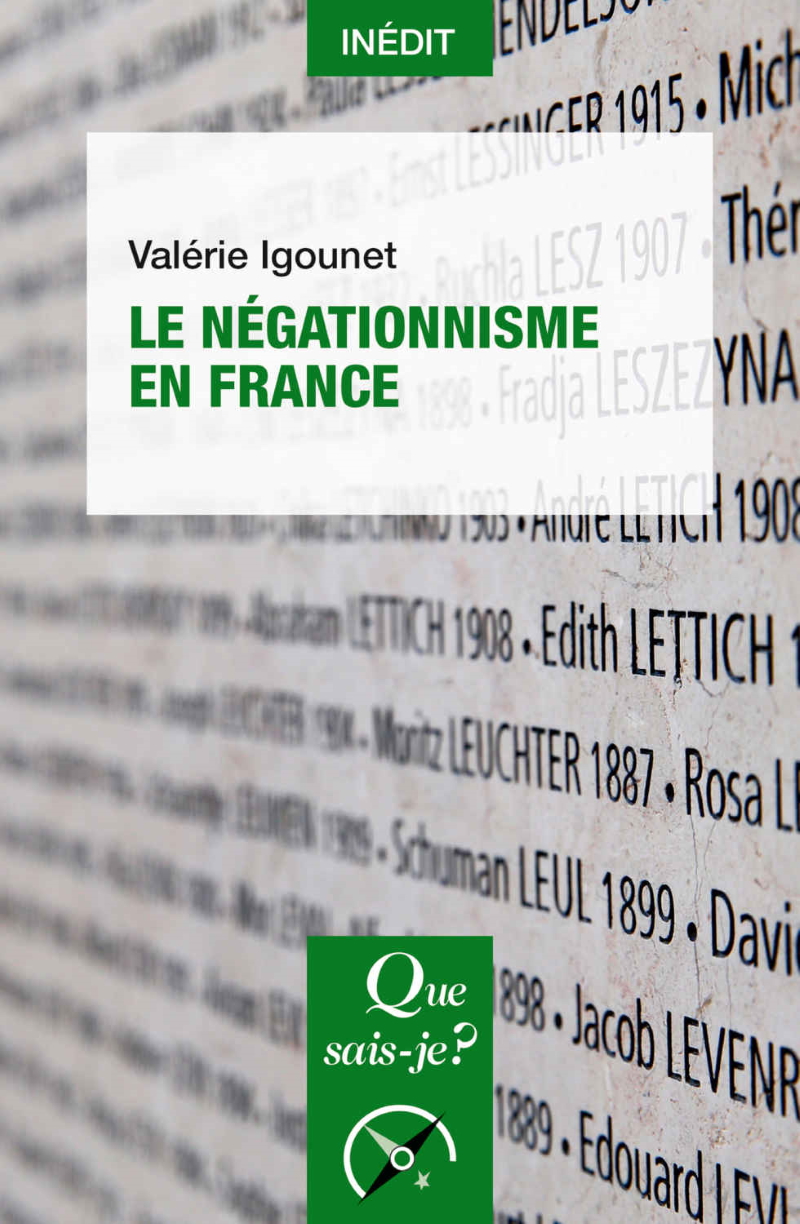



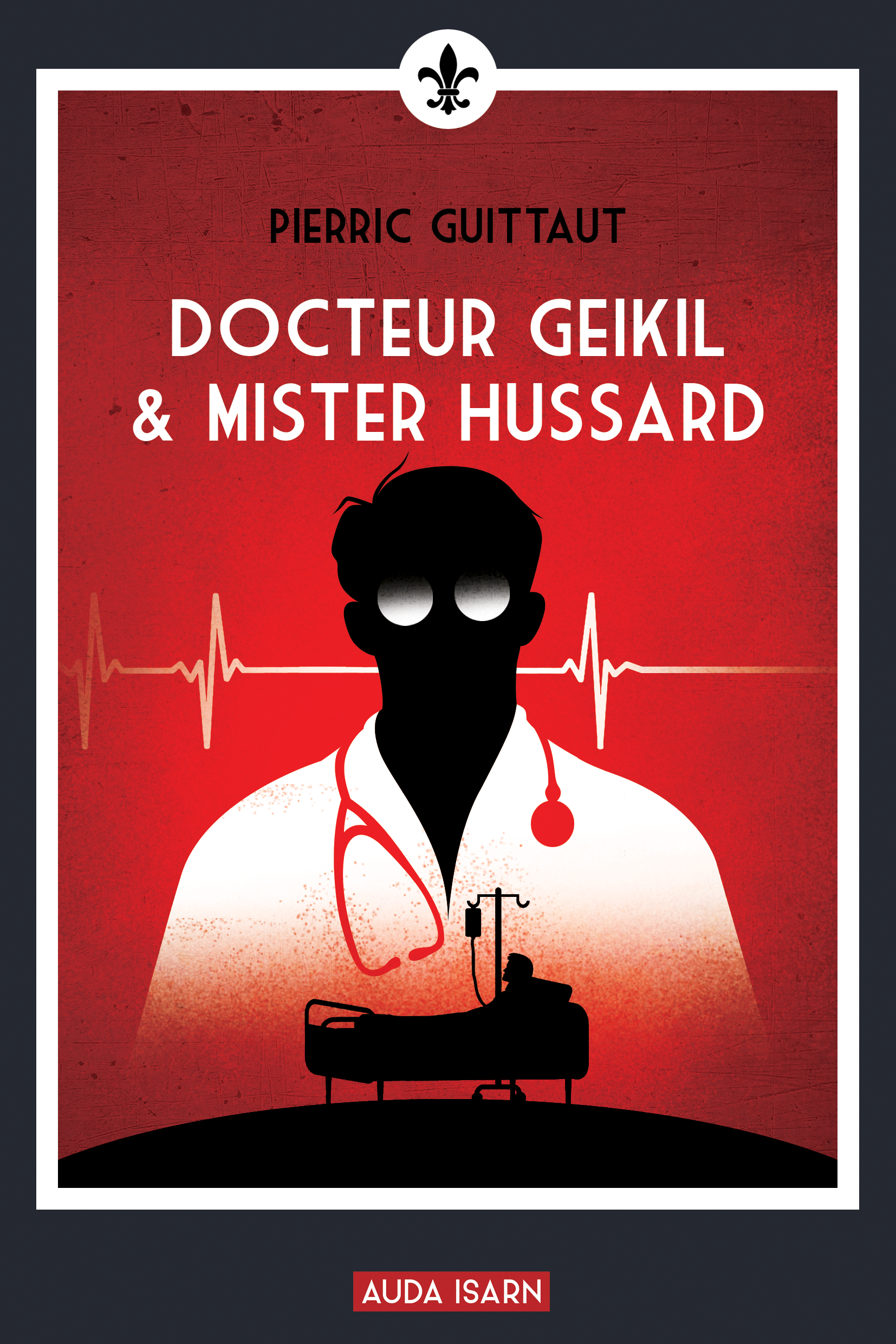









 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV






![[Archives] Un mal de notre fin de siècle : l’aliénation par les loisirs](https://www2.jeune-nation.com/wp-content/uploads/2014/09/nsr_fascisme_communisme_capitalisme.png)