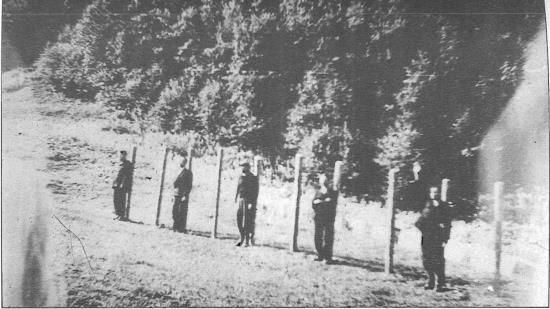29 octobre 1933 : Fondation de la « Falange de las Jons »
Après une présentation rapide des origines de la fondation de la « Falange de las Jons », on pourra lire le discours phare que prononça José Antonio Primo de Rivera au Théâtre de la Comédie à Madrid le 29 octobre 1933.

La Phalange espagnole des Jons prend ses racines en 1931, quand le philosophe de Zamora, Ramiro Ledesma Ramos et l’avocat de Valladolid, Onesimo Redondo Ortega, fondent les Jons en s’unissant au groupe que formait le journal « La conquête de l’Etat », fondé par Ledesma avec les Assemblées castillanes d’action hispaniques que dirigeait Redondo. Ces Jons, assemblées d’offensives national-syndicalistes, étaient des groupes formés par des travailleurs, des étudiants, des paysans, des intellectuels conjuguant un syndicalisme révolutionnaire, un grand amour pour l’Espagne et un grand respect envers la religion.
Deux ans après la création des Jons, le 29 octobre 1933, on célébra dans le Théâtre de la comédie de Madrid un « acte d’affirmation espagnole » qui sans qu’on le lui propose devint en réalité l’acte fondateur de la Falange espagnole, organisation dirigée par l’avocat José Antonio Primo de Rivera.
Au vu de l’affinité politique qui existait entre les membres des Jons et les falangistes, le 15 février 1934, fut signé l’accord de fusion entre les Jons d’Onesimo Redondo et Ramiro Ledesma Ramos et la Falange espagnole de José Antonio Primo de Rivera donnant lieu à la naissance de la Falange espagnole des Jons.
Cet accord fit son entrée quelques jours plus tard, le 4 mars, dans le Théâtre Calderón de Valladolid, lors d’une réunion que le PSOE tenta de boycotter, le député socialiste Remigio Cabello dirigeant une féroce attaque armée à la sortie et qui se termina par l’assassinat de l’étudiant en médecine Angel Abella de la main de plusieurs militants du PSOE.
La nouvelle organisation politique, Falange de las Jons, se caractérisera vite par la défense des intérêts des travailleurs au travers des CONS (Confédération ouvrière nationale-syndicaliste) avec une importance spéciale dans le secteur de l’hôtellerie, du taxi et du spectacle.
Comme petit frère, le puissant SEU, Syndicat Espagnol Universitaire devint le principal organe de défense étudiante devant les exactions du Front populaire à l’université, et donna au national-syndicalisme quelques uns de ses premiers martyrs, comme l’étudiant Matias Montero assassiné le 9 février 1935 par le militant du PSOE Tello Cortajada.

Discours fondateur de la Falange de las JONS
(Teatro de la Comedia, Madrid, 29 de octubre de 1933)
Raison et volonté
Pas de préambule de remerciements; simplement « merci » comme il convient à la concision militaire de notre style.
Quand en mars 1762, un homme funeste, J-J Rousseau, fit paraître Le Contrat social, la vérité Politique cessa d’être une vérité permanente. Avant, en des temps plus reculés, les Etats étaient des exécuteurs de missions historiques dont la devise était « Justice et vérité ». J-J Rousseau vint nous dire que la Justice et la Vérité n’étaient pas des axiomes de la pensée mais des décisions provisoires de la volonté.
J-J Rousseau supposait que l’ensemble des individus formant un peuple, créait une personnalité supérieure d’une essence différente de celle de chacun des individus, personnalité infaillible, capable de définir en chaque instant le juste et l’injuste, le bien et le mal. Et comme cette volonté collective, cette volonté souveraine, s’exprime seulement par un suffrage – opinion du plus grand nombre qui triomphe d’une minorité dans la recherche d’une autorité supérieure – il en résultait que le suffrage, cette farce qui consiste à jeter des bulletins dans une urne de verre, avait le pouvoir de décider à tout instant si Dieu existait ou n’existait pas, si la Vérité était la Vérité ou ne l’était pas, si la Patrie devait demeurer ou se désagréger.
L’Etat libéral
Du fait que l’Etat libéral était esclave de cette doctrine, il s’organisa non en exécuteur des destins de la Patrie, mais en spectateur de luttes électorales. Pour l’Etat libéral, il importait seulement qu’il y eût un nombre déterminé de citoyens autour des tables de vote, que les élections fussent commencées a huit heures exactement et terminées à quatre heures, que les urnes ne fussent pas brisées, alors que le bris d’une urne est le plus noble destin que l’on puisse lui réserver. Ensuite, il ne songeait plus qu’à respecter tranquillement la décision du vote, comme si pour lui, Etat, la nature de cette décision n’avait aucune importance. C’est-à-dire que les gouvernants libéraux ne croyaient même pas en leur propre mission. Ils ne croyaient pas qu’ils eussent un devoir important à remplir, ils étaient persuadés que tout citoyen, de pensée politique contraire à la leur, pouvait attaquer l’Etat à tort ou à raison et que ce citoyen avait des droits égaux à ceux qu’avaient les gardiens de l’Etat pour le défendre.
De là naquit le régime démocratique qui est avant tout le système le plus onéreux du fait de la dispersion des énergies. Un homme doué pour l’art de gouverner, qui peut être la plus noble des fonctions humaines, devait consacrer les 80, 90, 95 % de son énergie à répondre à des dossiers de réclamations, à faire de la propagande électorale, à somnoler dans les Assemblées, à flatter ses électeurs, car c’est d’eux-mêmes qu’il allait recevoir le pouvoir, à subir les humiliations et les vexations de ceux qui étaient appelés précisément à se soumettre à cette fonction quasi divine de gouvernement; et, si après tout ce temps perdu, il restait à l’homme public quelques heures matinales ou quelques instants dérobés à un repos agité, c’est alors seulement qu’il pouvait s’adonner aux questions substantielles de Gouvernement.
Vint ensuite la disparition d’un idéal unique parmi le peuple, parce que le système fonctionnant sur la loi du plus grand nombre, celui qui aspirait au pouvoir devait obtenir la majorité des suffrages. Il devait arracher coûte que coûte les voix aux autres partis, et dans ce but, il n’hésitait pas à calomnier ses adversaires, à les accabler sous les pires injures, à dissimuler sciemment la vérité à employer toutes sortes de moyens déloyaux. Bien que «Fratenité» soit un des postulats inscrit au frontispice de la Charte libérale, jamais il n’y eut de collectivités où les hommes s’injuriant, ennemis les uns des autres, se sentirent moins frères que dans la vie turbulente et pénible de l’Etat libéral.
Enfin, l’Etat libéral nous apporta l’esclavage économique, car il dit aux ouvriers avec une tragique ironie : « Vous êtes libres de travailler comme vous l’entendez; personne ne peut vous contraindre à accepter telle condition plus qu’une autre… mais, comprenons-nous bien, comme nous sommes les riches, nous vous offrons les conditions qui nous conviennent ; vous autres, citoyens libres. si elles ne vous plaisent pas, vous n’êtes pas obligés de les accepter; mais, citoyens pauvres, si vous n’acceptez pas les conditions que nous vous imposons, vous êtes condamnés à mourir de faim avec toute la dignité libérale». Ainsi il vous a été donné de remarquer dans les pays dotés des Parlements les plus brillants, des institutions démocratiques les plus achevées, que, dès que vous vous éloignez de quelques centaines de mètres des quartiers luxueux vous rencontriez aussitôt des masures infectes, où vivent entassés les ouvriers et leur famille, dans des conditions presque inhumaines. Vous rencontriez également des ouvriers agricoles qui, toute la journée sous un soleil de feu, ployaient l’échine vers la terre et ne gagnaient, grâce au libre jeu de l’économie libérale, que soixante à soixante-dix journées de trois pesetas par an.
Le socialisme
C’est pourquoi naquit le socialisme; il fut une chose juste (nous ne reculons pas devant la vérité). Les ouvriers durent se défendre contre un régime, qui tout en leur donnant des droits, ne se préoccupait pas de leur accorder une vie normale.
Mais ce socialisme, qui était une réaction légitime contre l’esclavage libéral, va s’égarer premièrement dans une conception purement matérielle de la vie et de l’histoire, secondement dans un sentiment de représailles et enfin dans la proclamation du dogme de la lutte des classes.
Le socialisme, surtout celui élaboré par ses premiers apôtres, qui impassibles dans le silence de leur cabinet, ont conquis la foi des pauvres ouvriers, a été démasqué par Alphonso Garcia Valdecasas. Le socialisme ainsi compris ne voit dans la vie des peuples, qu’un jeu de ressorts économiques; la spiritualité est supprimée, la Religion est l’opium du peuple, la Patrie est un mythe pour exploiter les malheureux. Voilà le socialisme. Il n’y a plus que production et organisation économique. Aussi l’ouvrier doit-il pressurer son âme pour y faire disparaître toute trace de spiritualité.
Le socialisme n’aspire pas à rétablir une justice sociale abolie par le régime libéral, il cherche à user de représailles, il aspire à fonder une injustice dépassant dans le sens opposé l’injustice créée par le régime libéral.
Enfin le socialisme proclame le dogme monstrueux de la lutte des classes; il proclame que les luttes de classes sont indispensables, qu’elles sont naturelles et que rien ne peut les apaiser. Et. le socialisme, juste critique de l’économie libérale, nous apporte par une autre voie, la même désagrégation, la même haine, le même oubli de tout lien de fraternité et de solidarité entre les hommes.
« Dieu ! Quel bon vassal s’il avait un bon seigneur »
Aussi, il en résulte que nous, les hommes de notre génération, quand nous ouvrons les yeux, nous ne voyons qu’un monde ruiné moralement, un monde divisé en tout; et pour ce qui nous touche de plus près, nous voyons une Espagne ruinée moralement, une Espagne divisée par la haine. Voilà pourquoi nous pleurions dans le fond de notre coeur, quand nous voyions le peuple de cette merveilleuse Espagne, où nous découvrions sous l’habit le plus humble, des êtres d’une élégance rustique, incapables de gestes excessifs comme de discours oiseux, qui vivent sur une terre aride, de sécheresse apparente, mais qui nous étonne par la fécondité avec laquelle elle produit ses céréales et élance ses pampres triomphants. Quand nous parcourions ces terres et prenions contact avec ces hommes, nous savions qu’ils étaient torturés par des tyrans locaux, oubliés de tous les groupes politiques, divisés et empoisonnés par des discours retors, il nous revenait à l’esprit que nous étions devant les mêmes hommes qui disaient du Cid, errant dans les champs de Castille, exilé de Burgos : « Dieu, quel bon vassal, s’il avait un bon Seigneur. »
C’est le but que nous recherchons; ce seigneur légitime de l’Espagne; un maître comme celui de Saint François de Borja, qui ne meure pas pour nous. C’est pourquoi nous choisirons un chef qui ne soit pas l’esclave des intérêts d’un groupe ou d’une classe sociale.
Ni droite, ni gauche
Ce mouvement présent n’est pas un parti, mais plutôt un anti-parti, un mouvement, nous le proclamons, qui n’est ni de droite, ni de gauche. La droite, au fond, aspire à maintenir une organisation économique qui s’est montrée incapable et la gauche a anéantir une organisation économique, détruisant dans ce bouleversement les réalisations bonnes qui auraient pu être maintenues. D’un côté comme de l’autre, ces idées sont appuyées par des considérations spirituelles. Tous ceux qui nous écoutent de bonne foi savent que ces considérations spirituelles ont leur place dans notre mouvement, mais que pour rien au monde, nous ne lierons notre destinée à un groupe politique ou une classe sociale se rangeant sous la dénomination arbitraire de droite ou de gauche.
La Patrie est un tout comprenant tous les individus de quelque classe sociale que ce soit. La patrie est une synthèse transcendantale, une synthèse indissoluble devant atteindre des buts qui lui sont propres. Nous, que cherchons-nous ? Que le mouvement présent et le Gouvernement qu’il créera soit un instrument ayant une autorité agissante au service de cette unité constante, de cette unité irrévocable qui s’appelle «La Patrie».
Notre programme : du jugement
Par ce mot, nous définissons entièrement le mobile de nos actes futurs et de notre action présente, car nous ne formerions qu’un parti de plus si nous apportions un programme de solutions concrètes. Les programmes ont l’avantage de ne jamais être réalisés. Par contre, si notre jugement est constamment libre, face aux événements et à la vie, il nous suggérera des solutions aux cas concrets, comme l’amour nous indique quand nous devons montrer de la fermeté ou de la tendresse sans que le véritable amour ait besoin de posséder un programme dosant les disputes et les effusions.
Voilà ce qu’exige notre conception de la Patrie et de l’Etat qui la sert.
Que toutes les contrées d’Espagne, aussi diverses soient-elles, se sentent liées en une destinée irrémédiablement unique.
Que les partis politiques disparaissent, personne en naissant n’est inscrit à un parti politique, par contre, nous naissons tous membres d’une même famille, nous sommes tous habitants d’une commune, nous déployons tous notre activité dans un travail déterminé. Si notre famille notre commune et notre corporation sont les sphères naturelles dans lesquelles nous vivons, quelle nécessité y a-t-il à créer cet organisme intermédiaire et malsain, le parti politique, si ce n’est de nous unir en groupements artificiels qui nous arrachent à nos authentiques réalités.
Nous voulons moins de verbiage libéral et plus de respect de la liberté individuelle, car on ne respecte réellement la liberté de l’homme que lorsqu’elle est estimée comme nous l’estimons, c’est-à-dire la détentrice de biens éternels, l’enveloppe corporelle d’une âme capable de se sauver ou de se damner. C’est seulement lorsque l’on envisage l’homme sous cet aspect que l’on peut affirmer que l’on respecte vraiment la liberté, surtout si cette liberté marche de pair, comme nous le prétendons, avec un régime autoritaire de hiérarchie et d’ordre.
Nous voulons que tout le monde se sente membre d’une société sincère et entière, où les fonctions sont nombreuses : soit dans le travail manuel, soit dans le travail intellectuel, soit dans l’enseignement des usages et des subtilités de la vie. Mais dans la société comme nous la comprenons, disons-le dès maintenant, il ne peut y avoir de parasites ni de paresseux.
Nous ne voulons pas que dans une maison d’affamés l’on accorde des droits individuels qui ne pourront jamais se réaliser, mais que l’on donne à tout homme, à tout membre de la communauté politique par le seul fait qu’il en fasse parti le moyen de gagner par son travail, une vie humaine, juste et digne.
Nous voulons que le sentiment religieux, base des plus belles pages de notre histoire, soit respecté et protégé comme il le mérite, sans que pour cela l’Etat s’immiscie dans une fonction qui n’entre pas dans ses attributions, ni – comme il le faisait souvent en vue d’autres intérêts que ceux de la véritable religion — qu’il partage des fonctions qui lui sont propres.
Nous voulons que l’Espagne recouvre résolument le sentiment général de sa culture et de son histoire.
Et nous voulons pour terminer, si nous ne pouvons obtenir autrement que par la violence ce que nous demandons, que nous ne nous arrêtions pas devant la violence. Car, qui a dit, – en parlant de « tout plutôt que la violence », – que la suprême manifestation de la valeur morale est la douceur et que lorsque l’on outrage nos sentiments, avant de réagir, nous devons nous obliger à être aimable, aurait très bien dit, si le plus puissant argument était en paroles.
Voilà notre conception de l’Etat futur et nous devons travailler avec ardeur à son édification.
Manière de vivre
Notre mouvement ne serait pas entièrement compris si l’on croyait qu’il n’est seulement qu’une façon de penser; ce n’est pas une manière de penser, mais une façon de vivre. Nous ne devons pas seulement nous proposer l’édification d’une politique, nous devons adopter dans toutes les manifestations de notre existence, dans chacun de nos gestes, une attitude profondément et entièrement humaine. Cette attitude, c’est l’esprit de sacrifice et, de service, le sentiment spirituel et militaire de la vie. Ainsi donc que personne ne croît que nous venons faire des recrues afin de nous permettre d’offrir des prébendes; que personne ne croît que nous nous groupons pour défendre des privilèges, Je voudrais que ce microphone devant moi porta mes paroles jusqu’au dernier coin des foyers ouvriers pour leur dire : oui nous portons des cravates; oui, vous pouvez dire de nous que nous sommes des señoritos. Mais justement nous apportons un esprit de lutte précisément, pour ce qui ne nous intéresse pas en tant que señoritos; nous entrons dans la lutte pour que beaucoup de notre classe s’imposent des sacrifices durs et pénibles, et, nous entrons dans la lutte pour qu’un Etat totalitaire puisse répandre ses bienfaits aussi bien sur les puissants que sur les humbles. Tels, nous sommes, ainsi que furent toujours les señoritos, d’Espagne. Ils parvinrent à la hiérarchie des seigneurs véritables parce que dans les terres lointaines comme sur le sol de notre Patrie, ils surent faire face à la mort, s’adonner aux tâches les plus rudes pour ce qui, du seul fait qu’ils étaient señoritos, aurait pu ne pas leur importer.
L’arme au bras, sous les étoiles
Je crois que le drapeau est brandi. Nous allons le défendre joyeusement, poétiquement. Certains estiment que pour s’opposer à la marche d’une révolution, il faut, pour grouper les volontés contraires, proposer des solutions mitigées et dissimuler dans sa propagande, tout ce qui pourrait éveiller un enthousiasme, éviter toute position énergique et absolue. Quelle erreur ! Les peuples n’ont jamais été plus remués que par les poètes et malheur à celui qui ne saura opposer une poésie créatrice à une poésie dévastatrice.
Pour notre idéal, soulevons ces aspirations de l’Espagne, sacrifions-nous, renonçons-nous, et nous triompherons, le triomphe (en toute franchise) nous ne pourrons l’obtenir aux prochaines élections. Aux prochaines élections votez pour celui qui vous paraîtra le moins mauvais. Notre Espagne ne sortira pas de ces élections. Notre place n’est pas là dans cette atmosphère trouble, lourde, comme celle d’un bordel, d’une taverne après une nuit crapuleuse Je crois que je suis candidat, mais sans foi, ni respect; je l’affirme dès maintenant, au risque de détourner de moi les électeurs. Cela m’est égal. Nous n’allons pas disputer aux familiers les restes de ces banquets pourris; notre place est au dehors, bien que provisoirement nous puissions y assister. Notre place est à l’air libre, sous la nuit claire, l’arme au bras, sous les étoiles. Que les autres continuent leur festin. Nous resterons dehors, sentinelles fermes et vigilantes, pressentant l’aurore dans l’allégresse de nos cœurs.
José Antonio Primo de Rivera





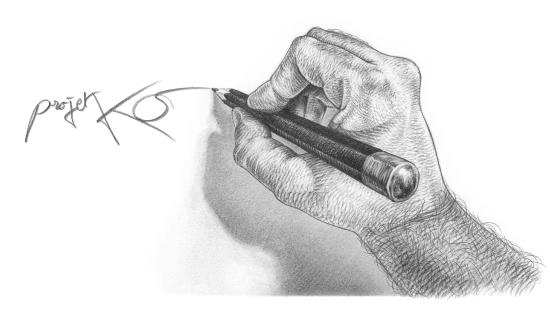


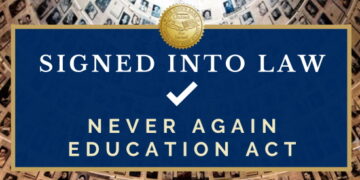














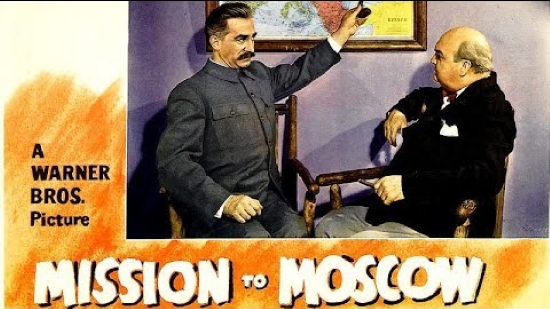



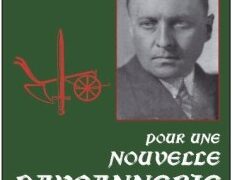


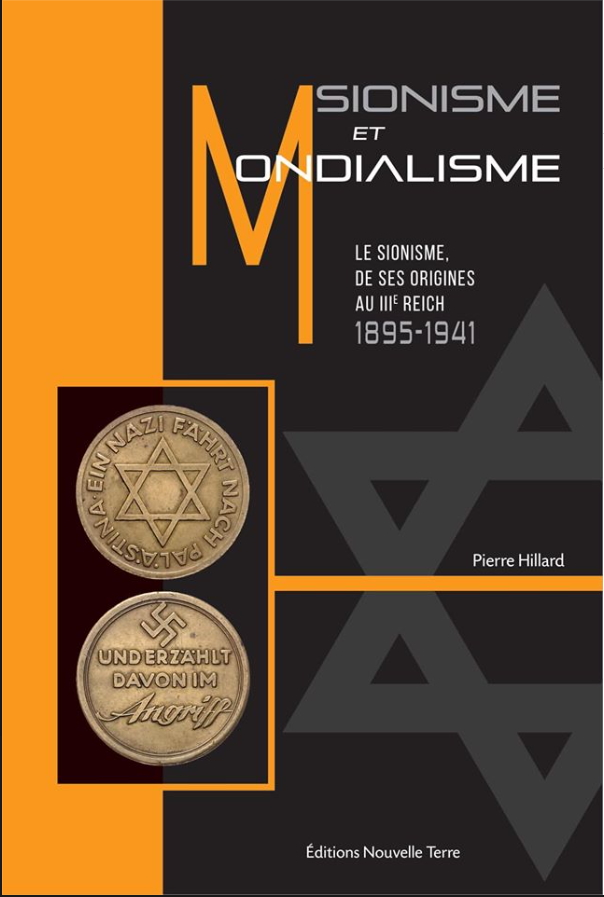
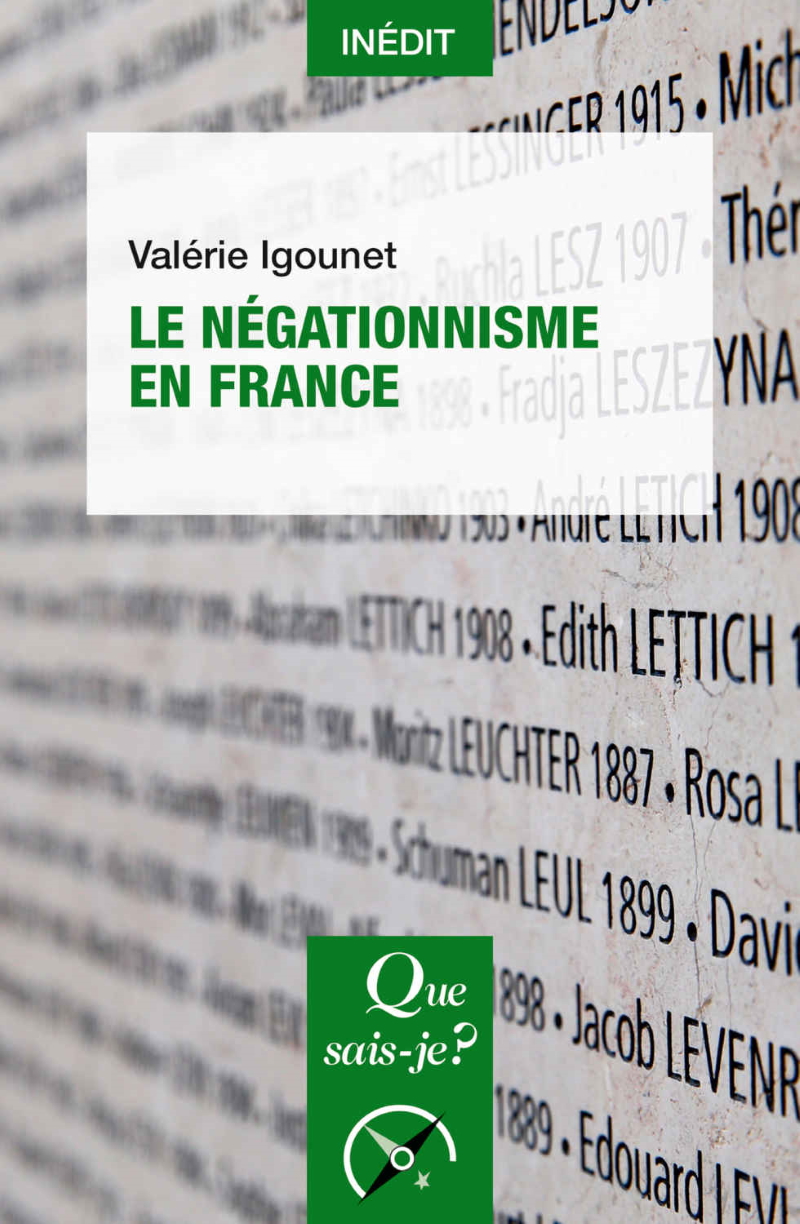



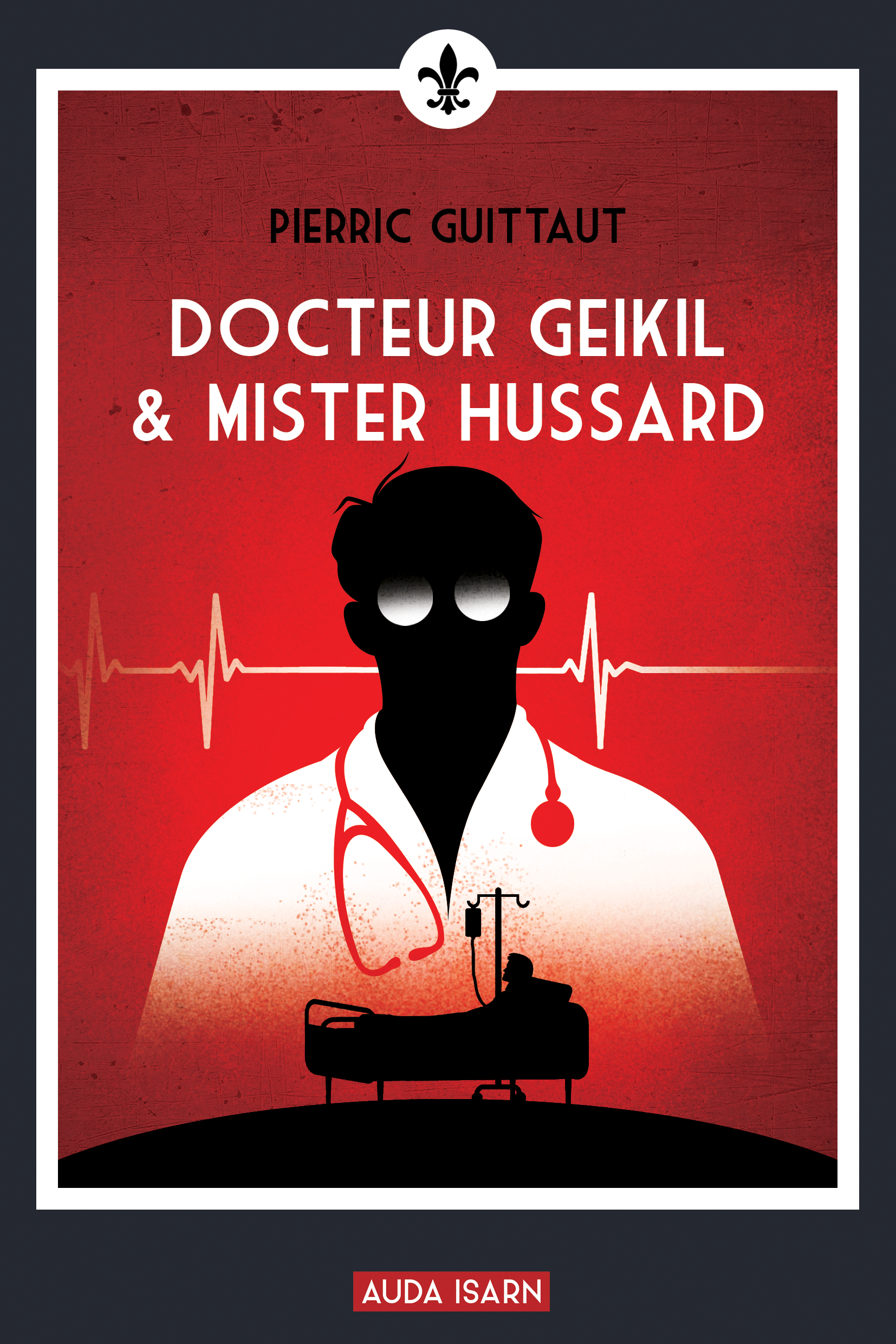









 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV