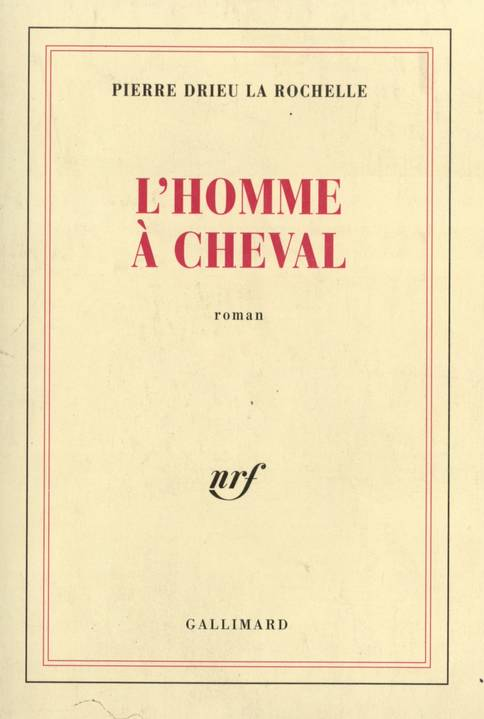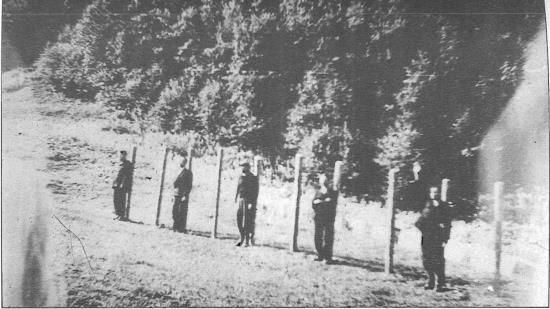L’homme à cheval de Drieu (par Robert Brasillach)
Cette chronique littéraire de Robert Brasillach a été publiée le 19 avril 1943 dans Le Petit Parisien.
… ce récit – qui renferme de nombreuses inexactitudes – semble avoir été écrit par quelqu’un qui n’a jamais mis les pieds en Bolivie, qui tout au plus en a rêvé.
Qu’on ne trouve pas ces lignes trop acerbes : c’est par elles que se termine le livre de Drieu la Rochelle, lequel se passe, en effet, dans une Bolivie quasi imaginaire, au dernier tiers de l’autre siècle, et ordonne en quatre épisodes nonchalants et amers quelques orchestrations sur le pouvoir, les femmes, la sensualité, l’Empire, la race et les dieux. La Bolivie y sert de cadre un peu comme le Pérou sert de cadre au Mérimée du Carone, et c’est bien à Mérimée, à sa sécheresse, à sa passion élégante, que font souvent penser ces lignes, mais à un Mérimée plus souvent proche de Stendhal que l’authentique. Stendhal, Mérimée, parfois le Gobineau des nouvelles, hâtons-nous de rassembler ces figures votives autour du nouveau Drieu pour le situer.
C’est un livre qu’on aimera. Pour l’écrire, Drieu semble descendre des luttes politiques et des débats contemporains où il excelle. Mais de quoi parle-t-il d’autre, au fond, que ce dont nous parlons tous les jours ? La guerre… ? Il n’a cessé de la décrire, de la chanter. Les femmes… ? Son héros en est couvert comme celui d’un des premiers romans de l’auteur. Et le problème du prince, il est au centre de cette méditation romanesque comme il est au centre d’une des rares œuvres dramatiques de notre écrivain, celle qui se nomme Le Chef. Est-ce un roman ? Moins accompli alors que Rêveuse Bourgeoisie, qui est un livre admirablement désespéré, chant funèbre sur une classe sociale disparue, plein de figures inoubliables, et de marches sordides haussées au rang d’un monde de symboles. Moins directement suggestif que les meilleures parties de Gilles (la première et la dernière), description si aiguë d’un état d’âme fasciste que la censure d’Édouard Daladier le mutila étrangement. Il s’agit ici plutôt d’une suite de quatre nouvelles, qui nous décrivent la vie d’un dictateur imaginaire d’Amérique du Sud, don Jaime Torrijos, en présence de la conquête du pouvoir, des femmes, de la révolte et des rêves de l’avenir.
La meilleure de ces nouvelles est la première. Le récitant, guitariste laid et perspicace, accompagne don Jaime, mais il est séduit par don Benito, le dictateur alors au pouvoir, homme silencieux, énigmatique, dont la voix est belle et l’humanité ardente. Il aidera pourtant à le tuer, car il faut bien que don Jaime devienne à son tour le « Protecteur ». Il y a ensuite des conspirations, où l’on risque de se perdre un peu, une révolte d’indiens, alors que don Jaime aurait pourtant voulu gouverner avec l’appui des Indiens, mais la vie des chefs est faite d’incompréhension, un complot de cavaliers galants à la mode de la Renaissance, qui nous vaut une étonnante scène de duel dans une salle nocturne, pour les beaux yeux d’une femme. Il y a, à la fin, une méditation au bord du lac Titicaca, où s’évoquent les grands souvenirs de l’empire des Incas, et où le Protecteur, qui vient de perdre une guerre, sait que jamais il ne rétablira l’immense unité indienne.
Peut-être aurait-il fallu que ces images picaresques et philosophiques fussent soutenues par une intrigue plus unitaire et plus marquée. Elles se dissolvent un peu, surtout à la fin, dans des soliloques où ne manque point le vague, et les personnages semi-caricaturaux qui représentent les forces occultes, maçonnerie ou jésuites, ne rendent pas toujours plus aisés à saisir les déroulements obscurs de ces aventures incertaines et les motifs d’action des personnages. Ils sont silencieux, ils sont passionnés et feutrés, ils sont à la fois Espagnols et Indiens, et tout cela (je laisse à de plus compétents le soin d’en juger au fond) me paraît terriblement vrai. Sur un fond désolé, analogue aux pierreuses plaines castillanes – mais à quatre mille mètres d’altitude, dans les capitales les plus hautes du monde – apparaissent des figures extrêmes de la démesure, comme au temps des dieux mangeurs d’hommes et des architectures tropicales. Cette ordonnance est bien savoureuse.
Ce qui la rend plus savoureuse encore, il faut le dire tout de suite, c’est le style. La littérature de l’armistice nous a valu un nombre consternant de romans ou d’essais écrits par des analphabètes soudain possédés d’on ne sait quel démon. On a précipité sur le papier, denrée rarissime, des élucubrations ahurissantes, auprès desquelles les romans à dix sous des anciennes collections populaires semblent des merveilles de goût et de psychologie. Des retraités alcooliques ont consigné leurs réflexions sur la crise de moralité qui n’était au vrai, pour eux, qu’une crise de l’apéritif. Des jeunes gens un peu montés en graine ont mis en scène leurs émois dans une langue directement empruntée aux prospectus de produits pharmaceutiques. Et soudain, dans un navrant désert, un livre, un vrai livre… Un style où se mêlent l’élégance, la passion, l’allure, et une certaine sécheresse fiévreuse où Drieu la Rochelle me semble avoir tout à fait exorcisé les musiques romantiques qui laissent encore chez lui comme des souvenirs de Barrés. Ici, c’est le XVIIIe siècle qui semble régner, mais le XVIIIe siècle tel que l’a compris, encore une fois, Stendhal, celui où le vêtement de la parole semble se mouler le plus précisément possible sur le corps des réalités. Par instants, ce roman abandonne même les terres proprement romanesques : il s’en va à pleines voiles vers le conte, vers le conte un peu symbolique, comme au temps où Marmontel évoquait d’autres Incas. Mais toujours il reste chargé de maléfices nocturnes, de nos lourdes songeries sur la dictature et sur la guerre, dont nous retrouvons ici les accents transposés sur un autre registre. C’est ainsi que nous passons constamment de l’orchestration ancienne aux thèmes d’aujourd’hui, et le produit est assez rare et assez précieux pour que nous puissions le saluer comme un fruit d’extrême civilisation.
C’est aussi un fruit de la civilisation que de pouvoir écrire un pareil livre. Drieu la Rochelle est aussi loin que possible d’un mondain, d’un clerc de la tour d’ivoire. Curieux de son époque, il a pris position avec la plus extrême netteté, et depuis longtemps déjà. C’est bien avant la guerre, sa Chronique politique récemment parue nous le rappelle, qu’il posait le dilemme « Mourir en démocrates ou survivre en fascistes ». Il osait appeler le fascisme par son nom, en un temps où ce n’était pas la mode. On sait aujourd’hui dans quel sens il continue son action. Mais cette action ne l’empêche point de se livrer au jeu subtil et fort qu’est L’Homme à Cheval, si délicatement relié, certes, à nos problèmes, et pourtant au-dessus de leur dépouille et de leur apparence, comme la tragédie classique est au-dessus des passions humaines dont elle se nourrit. Elle ne l’empêche point de prendre plaisir à l’ironie qui accompagne l’aventure de don Jaime contée par un guitariste bolivien et plus de plaisir encore à la beauté des mots et à la ligne pure d’un chant. Et c’est elle, en définitive, qui donne à l’arrière-plan de cette tragi-comédie en costumes désuets les couleurs un peu désespérées, un peu amères, viriles, sarcastiques et poignantes, de la condition humaine.
« … les hommes d’action ne sont importants que lorsqu’ils sont suffisamment hommes de pensée, et les hommes de pensée ne valent qu’à cause de l’embryon d’homme d’action qu’ils portent en eux » (p.191).
« Si l’Église défend les grands, la maçonnerie défend la bourgeoisie. […] La maçonnerie partage avec l’Église les responsabilités et les hypocrisies de la propriété » (p.194).
« … cette vie de la vie qu’on appelle l’honneur » (p. 207).
« Je n’ai jamais vu la dignité de l’homme que dans la sincérité de ses passions » (p. 210).
« Sa patrie est amère a celui qui a rêvé l’empire. Que nous est une patrie si elle n’est pas promesse d’empire ? » (p. 236).





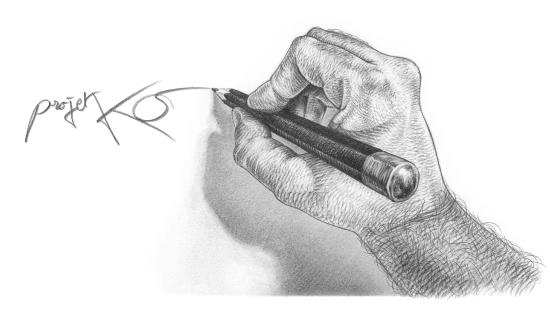


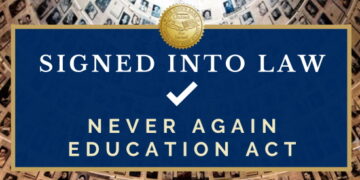














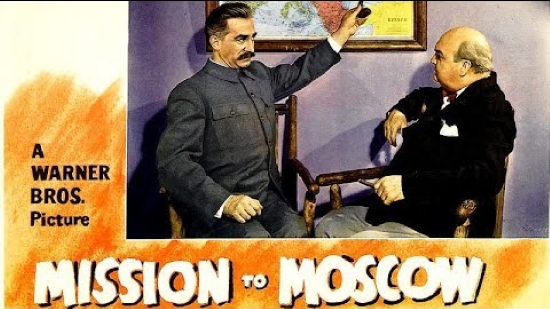



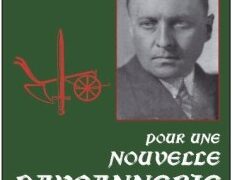


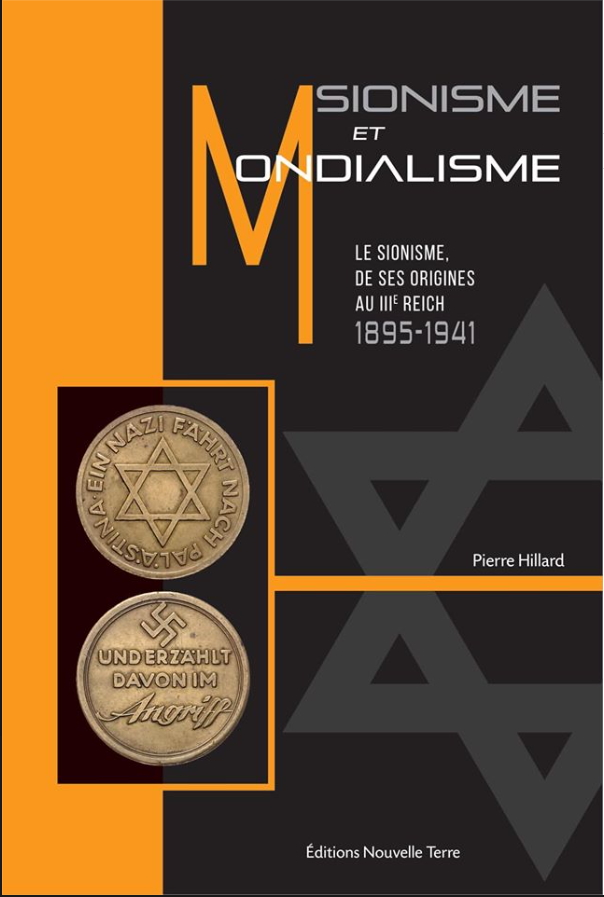
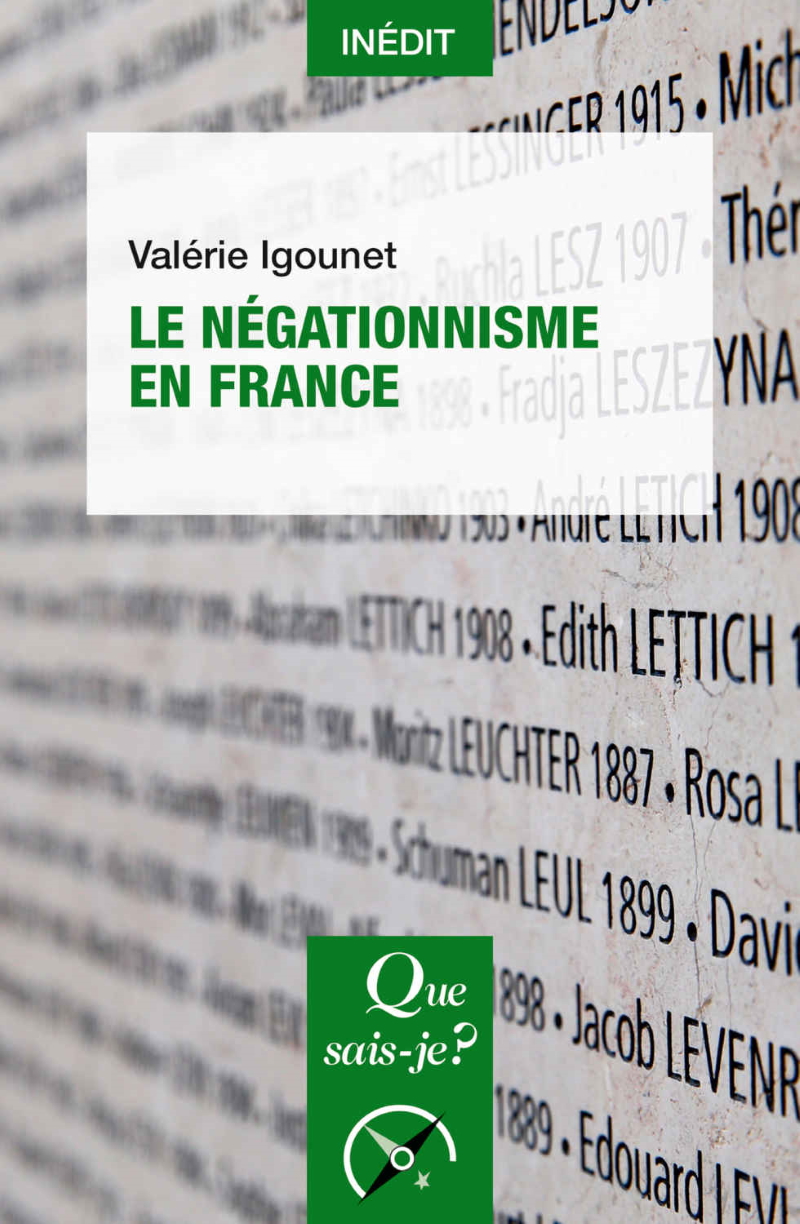



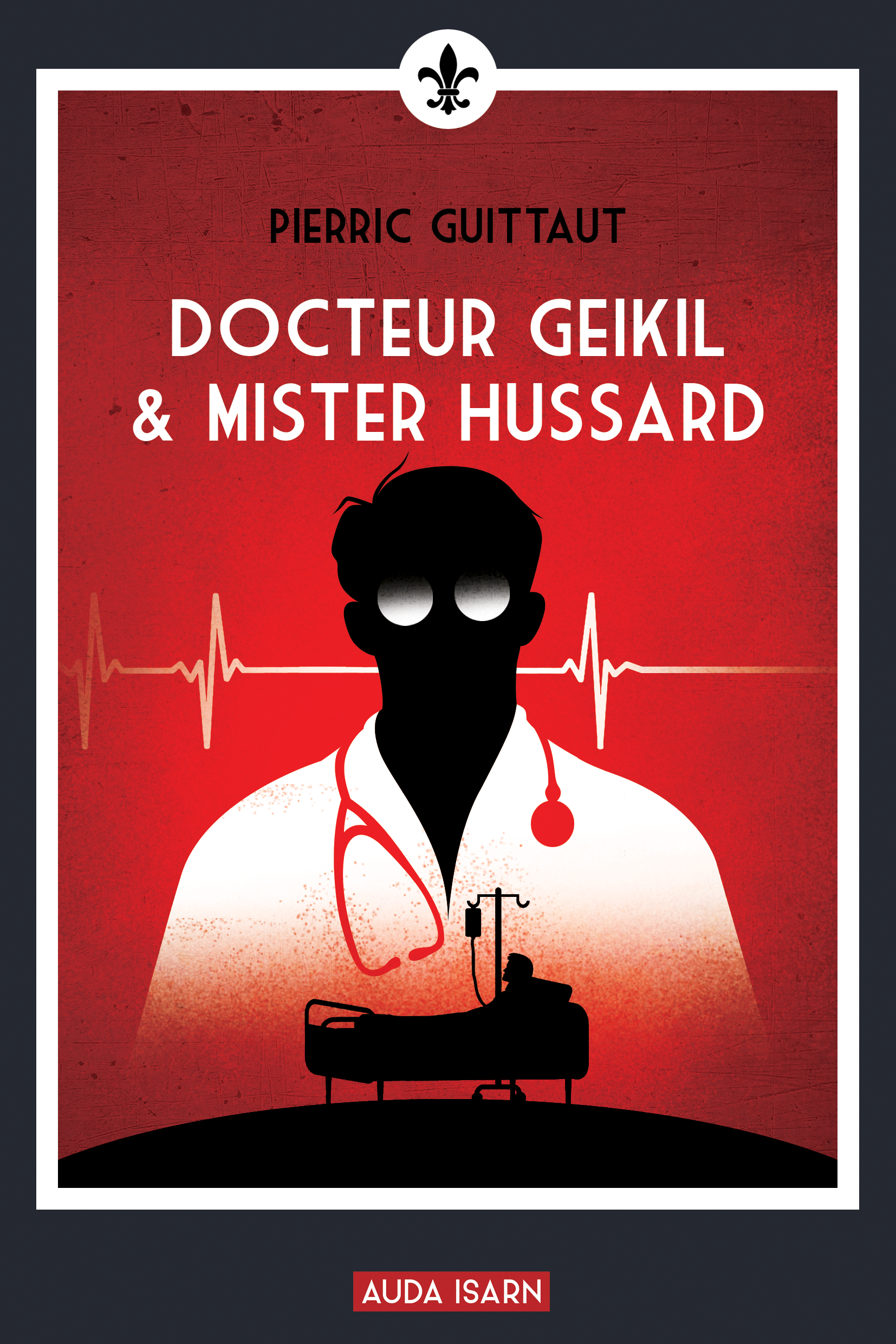









 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV