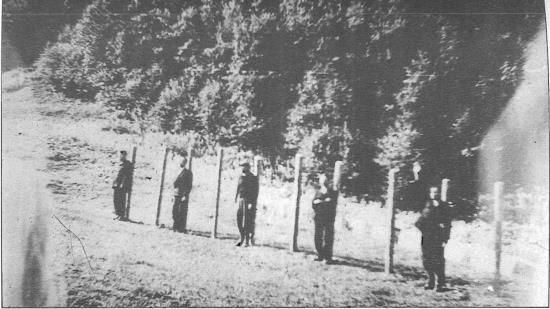Des petites patries à la France (Pierre Lasserre)
Ce texte est extrait de l’ouvrage de Pierre Lasserre, Frédéric Mistral : poète, moraliste, citoyen, publié en 1918. Journaliste et essayiste béarnais, Pierre Lasserre fréquenta longtemps l’Action française et Maurras, tout en s’intéressant aux travaux du syndicaliste révolutionnaire Georges Sorel.
Pour que j’aime la France, moi, enfant du Midi, moi Provençal, Languedocien, Gascon ou Béarnais, il faut que je la connaisse. Il faut que je sache en quoi elle me touche, en quoi elle touche ce qui me touche. Toute connaissance est artificielle, verbale, on peut dire irréelle, qui ne part pas de quelque expérience familière et sensible à celui qui la reçoit, qui n’est pas rapportée à une telle expérience. Or, ce qui est sensible pour moi, c’est que je suis né dans un certain pays, grand ou petit, du Midi français. Un certain milieu provincial, plein de caractères qui le distinguent des autres milieux provinciaux français, surtout d’outre-Garonne et d’outre-Loire, a enveloppé mes jeunes années et m’a communiqué ce premier fond d’impressions et d’habitudes ineffaçables qui demeureront toujours comme la substance de mon être moral, à moins que je ne me renie moi-même. Voilà ma patrie immédiate et naturelle. Elle peut n’avoir pas soixante kilomètres de long ni soixante de large. Je l’aime. Pour ne pas l’aimer, il faudrait que je n’eusse pas aimé mon père et ma mère. Mais la grande France, dont la capitale est si loin, en quoi est-elle ma mère ? En quoi ma patrie naturelle, celle qu’ont découverte sans enseignement les premières intuitions de mon cœur et de mes yeux, s’y rattache-t-elle assez intimement pour que remonte jusqu’à elle ma filiation ?
Par le raisonnement, je comprends qu’elle a besoin d’appartenir à un grand corps politique qui la protège et fonde sa sécurité. Cependant, cette vue de raison, cet argument d’utilité ne suffiraient pas pour entraîner ma totale affection, pour me faire répandre sur tout le corps de la France le sentiment de ferveur et de piété passionnée que j’ai pour ma terre natale. Il faut que je me représente comment leurs deux vies se sont associées, pénétrées, au point que chacune d’elles, séparée de l’autre, ne serait plus elle-même et aurait perdu une partie du souffle qui la soutient. Et je ne pourrais me représenter cela ni en sentir le prix sacré, si ne m’étaient également présents à l’esprit et au cœur les deux termes entre lesquels une telle union s’est produite, les deux patries qui se sont fondues de façon à n’en faire plus qu’une, indivisible à la fois et merveilleusement diverse. Je dois être instruit, non seulement sur la France en général, mais sur mon pays propre, avoir un vif sentiment, une riche notion de ses traits distinctifs, de sa vie particulière, de son être historique. C’est de cette notion que je passerai aisément à celle de la France, dans laquelle je risquerais de me trouver un peu perdu, si elle m’était présentée sans aucun intermédiaire.
Il ne faut pas confondre un enfant de l’Île-de-France avec un enfant du Midi. Le premier peut accéder de plain-pied à l’idée de la France, parce qu’il est né au centre même d’où est parti le grand mouvement circulaire qui a créé notre nation. Lui parler de la France, c’est lui parler de ses horizons les plus prochains. La France est, en quelque sorte, sa province. Mais, pour un Provençal ou un Béarnais, la France est un horizon supérieur vers lequel il doit être élevé par une gradation. Une idée de la France où ne figurent pas à leur place les choses, les gens, les souvenirs et l’atmosphère de chez lui, le dépaysera un peu, je le crains, et le dévouement auquel il se saura obligé vis-à-vis d’elle aura le caractère d’un commandement moral venu de trop loin, de trop haut et trop dépourvu de chaleur pour inspirer cet entrain et cette allégresse qui sont la note unique et nécessaire du véritable patriotisme français. Il faut que la France soit provençale pour le Provençal, béarnaise pour le Béarnais, comme elle sera bourguignonne pour le Bourguignon, en étant toujours la France.
Nous n’avons pas, nous Méridionaux, été agrégés à la France à titre d’individus épars et qui n’auraient pas eu de patrie. Ce sont nos vieilles patries qui se sont incorporées à la France et en sont devenues des provinces, par des pactes que la nécessité ou des circonstances heureuses ont fait naître et qu’a scellés l’amour. Ce sont des actes publics et solennels de nos provinces, Provence, Languedoc, Béarn, qui nous ont faits Français tous ensemble. C’est parce que nous sommes Provençaux, Languedociens ou Béarnais, que nous sommes Français. C’est en nous sentant profondément de notre terroir que nous nous sentirons Français, pas de nom seulement, mais d’âme et en réalité.
La doctrine révolutionnaire, poussée à ses extrêmes conséquences, veut que la France n’ait commencé d’exister en droit que le jour de la fête de la Fédération, quand les Français, passant les uns avec les autres une sorte de contrat social à la Rousseau, se jurèrent de former à jamais une nation unique. Mais cette belle fête ne peut être raisonnablement comprise que comme la consécration de ce qui était, non comme la création d’un être national nouveau. Pour que des peuples se « fédèrent » (le mot est d’ailleurs impropre ici), il faut qu’ils aient des raisons d’expérience qui les y déterminent. Ces raisons, pour les peuples qui composent la France, c’était la longue et belle histoire qu’ils avaient vécue ensemble, l’histoire qui avait formé d’éléments si variés le corps politique de la France et sa personnalité morale. Quand le Pyrénéen disait au Flamand : « Je te donne mes montagnes » et le Flamand au Pyrénéen : « Je te donne mes plaines », il eût été monstrueux d’entendre que montagnes et plaines allaient être désormais être mêlées et confondues ensemble, pour ne plus former qu’un chaos sans figure, où rien ne serait plus distingué que par des circonscriptions administratives. Non ! vivifier l’idée de la France, c’est vivifier l’idée de tous les pays de la France et particulièrement, au cœur de chaque Français, l’idée de son pays natal. Que Mistral ait dit qu’en réveillant le Midi chez les Méridionaux, il y réveillait la France, c’est là, de toutes ses sentences, la plus salutaire et la plus profonde.





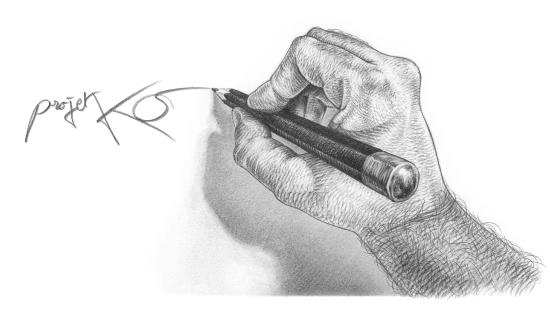


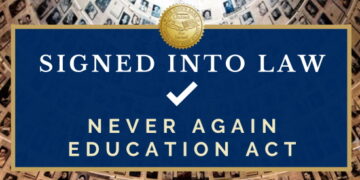














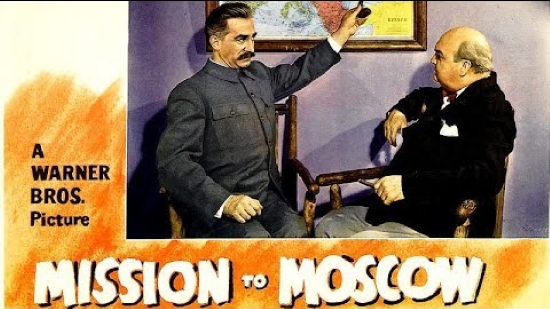



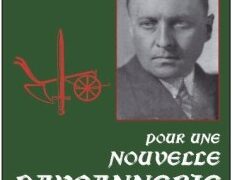


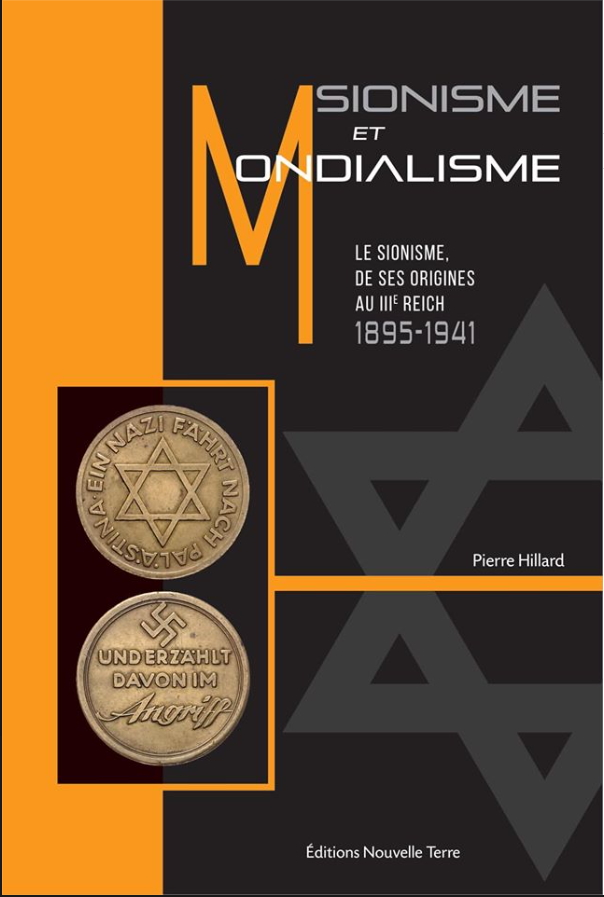
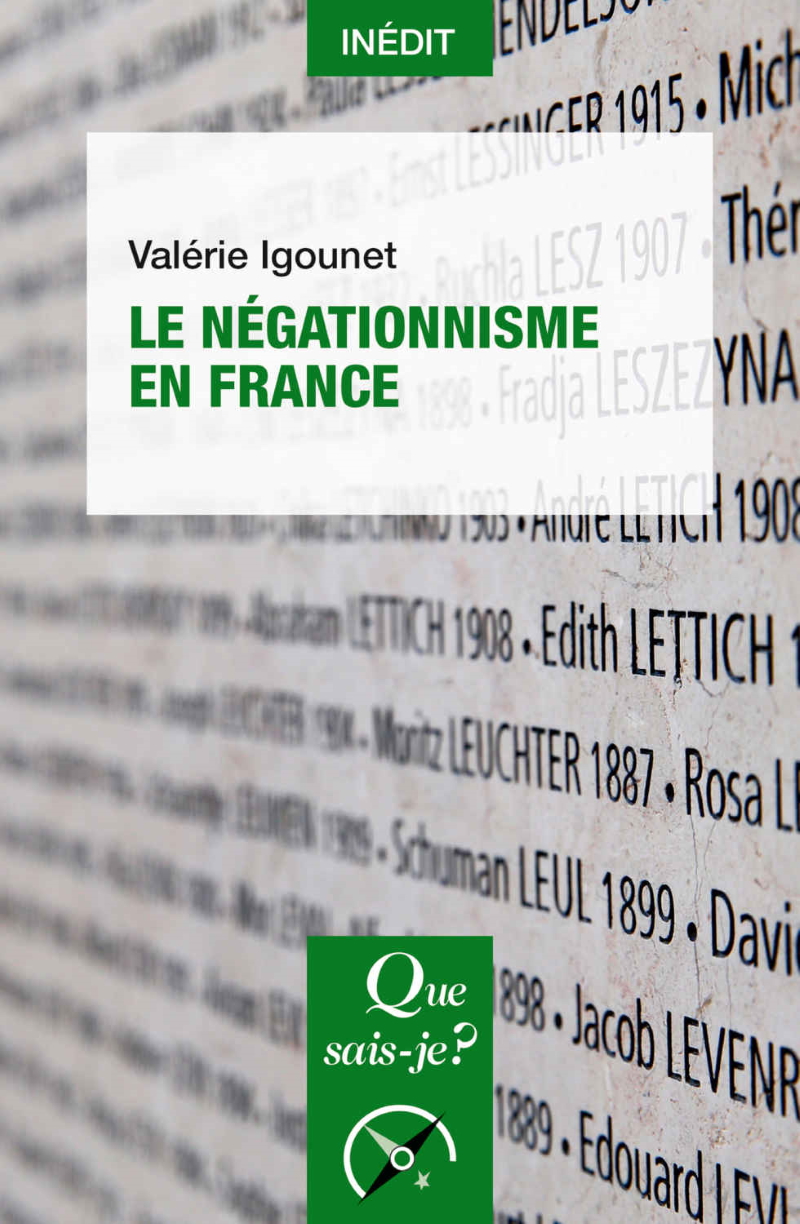



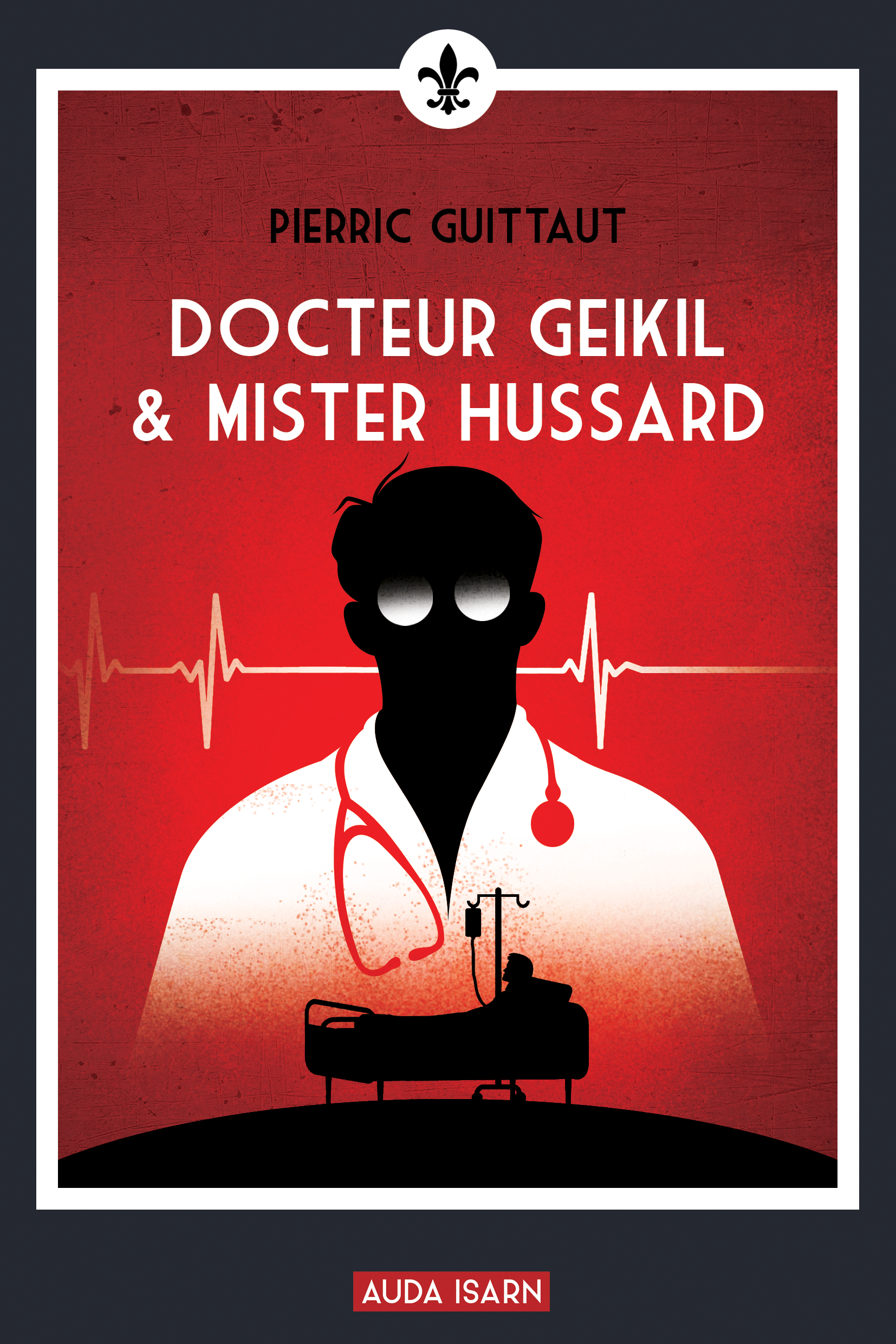









 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV