Otto Ernst Remer : Mon Rôle à Berlin le 20 juillet 1944
 Mon affectation au régiment de la garde de la division grossdeutschland à Berlin était en quelque sorte une permission – mon premier congé du front – qui faisait suite à mes diverses blessures, une reconnaissance aussi pour mes décorations glanées au combat comme la croix de chevalier avec feuilles de chêne ou l’agrafe d’argent pour combats rapprochés (48 jours au total). Par la suite j’ai de nouveau été blessé. En tout, j’aurais dirigé le régiment de la garde quatre mois, après quoi, je me suis senti tenu de rejoindre mes camarades au front.
Mon affectation au régiment de la garde de la division grossdeutschland à Berlin était en quelque sorte une permission – mon premier congé du front – qui faisait suite à mes diverses blessures, une reconnaissance aussi pour mes décorations glanées au combat comme la croix de chevalier avec feuilles de chêne ou l’agrafe d’argent pour combats rapprochés (48 jours au total). Par la suite j’ai de nouveau été blessé. En tout, j’aurais dirigé le régiment de la garde quatre mois, après quoi, je me suis senti tenu de rejoindre mes camarades au front.
Ma mission à la tête du régiment de garde de la division grossdeutschland dont j’ai pris le commandement fin mai 1944 consistait, en dehors des prestations purement protocolaires, à assurer la protection du gouvernement du Reich et de sa capitale. Comme il y avait plus d’un million de travailleurs étrangers à Berlin ou à proximité, on ne pouvait pas écarter l’éventualité de troubles intérieurs. Aux environs de midi, le 20 juillet 1944, le premier-lieutenant, le Dr. Hans Hagen, gravement blessé au front, achevait sa conférence d’histoire devant un parterre d’officiers et d’officiers de réserve du régiment. Il avait été rattaché à mon régiment à titre purement administratif et en aucun cas, contrairement à ce qu’on a pu l’affirmer çà et là, en tant qu’officier politique national-socialiste. J’étais seul responsable du régiment, aussi bien politiquement que militairement.
Je l’avais invité à déjeuner à mes quartiers à Rathenow en compagnie de mon aide-de-camp, le premier-lieutenant Siebert. Siebert, avait perdu un œil au combat. C’était un pasteur de l’Église confessionnelle [une branche de l’Église protestante allemande qui s’était opposée à Hitler]. Même si j’avais moi-même quitté l’Église, Il officiait à l’église de la garnison avec ma permission expresse, chaque dimanche. Entre nous, la liberté personnelle était la règle. Siebert avait aussi été membre des SA et du Parti national-socialiste, c’était au temps de la période héroïque de l’arrivée au pouvoir d’Hitler, mais il avait démissionné de ces deux organisations après qu’un responsable local du parti s’était permis des remarques infamantes sur les ancêtres du Christ : cette démission non plus ne me dérangeait pas. Le lieutenant Siebert n’a en rien eu à souffrir de ces démissions.
En ces temps-là, ce genre de choses ne posait pas de problème. Dans le cas de Siebert, avant que je ne le prenne comme aide-de-camp pour sa personnalité, il m’avait même avoué qu’alors qu’il était encore SA, il avait fait irruption dans un bureau de la Gestapo pour récupérer des documents qui incriminaient un de ses collègues de l’Église confessionnelle. À mes yeux, sa franchise était une preuve supplémentaire de la confiance qu’on pouvait lui faire. C’était comme ça dans ce troisième Reich tellement diabolisé de nos jours. Pas plus dans mon régiment que dans l’ensemble du corps des officiers, ne régnait cette étroitesse d’esprit butée, encore moins cette terreur envers les opinions dissidentes, qu’on prête volontiers aujourd’hui à l’Allemagne nationale-socialiste. Je n’ai pas non plus entendu dire que le pasteur Siebert se considérait alors comme un « résistant » ni qu’il ait prétendu l’être par la suite.
Au début de l’après-midi du 20 juillet 1944, mon régiment, comme toutes les unités de l’armée de réserve, a été placé en état d’alerte par le nom de code « Walkyrie ». Ce code était à utiliser pour déclencher la mobilisation de l’armée de réserve en cas de troubles intérieurs. Tandis que mon régiment prenait automatiquement les mesures prévues, j’étais convoqué à la piscine [Schwimmhalle Finckensteinallee complexe aquatique de la Leibstandarte Adolf Hitler à Berlin]. Conformément aux ordres, je me suis aussitôt rendu en voiture à mon poste au PC de la ville de Berlin situé juste en face de la « garde perpétuelle ».
Tandis que les autres commandants d’unités patientaient dans l’antichambre, j’étais, seul, reçu par le gouverneur militaire de la ville, la major-général von Hase. Il m’a fait un topo de la situation et donné mes instructions :
« Le Führer a été victime d’un accident fatal ! Des troubles publics ont éclaté. L’armée a pris le pouvoir ! Le régiment de la garde devait mobiliser une force capable de contre-attaquer et de boucler le quartier gouvernemental en sorte que personne, pas même un général ou un ministre, ne puissent entrer ou sortir. Pour vous aider à barrer les rues et bloquer les métros, je vous adjoins le lieutenant-colonel Walters ».
Durant l’entretien, j’étais frappé de la présence d’un jeune officier d’état-major, le major Hayessen, alors qu’en revanche, un ancien officier supérieur de l’état-major, que je connaissais personnellement, se tenait à l’écart, passif et visiblement nerveux.
J’étais bien sûr sous le choc. Sans Hitler, la possibilité d’un tournant favorable de la guerre disparaissait presque complètement. Je demandais aussitôt :
« Est-ce que le Führer est vraiment mort ? S’agit-il d’un accident ou d’un assassinat ? Où avait-on constaté des désordres ? Je n’avais rien remarqué d’anormal à Berlin. Pourquoi le pouvoir exécutif passait à l’armée et pas à la Wehrmacht [ensemble des forces armées]. Qui était le successeur du Führer ? En principe, c’est Hermann Göring qui était prévu par le testament d’Hitler : est-ce qu’il a fait une déclaration ou donné des ordres ? »
Comme on ne me donnait pas d’informations précises ni de réponse claire, la situation m’apparaissait, dès le départ, trouble pour ne pas dire suspecte. Comme j’essayais de me faire une idée en jetant un œil aux papiers épars sur la table pour au moins voir qui avait signé les ordres, le major Hayessen les a ostensiblement rassemblés et fait disparaître dans un dossier. En rentrant à mon régiment, je ruminais de sombres pensées : « Hitler est mort. C’est l’anarchie, les uns et les autres vont essayer de prendre le pouvoir. » Je voyais d’ici les futures luttes pour la succession.
J’étais en tout cas résolu à ne pas me laisser manipuler en ma qualité de commandant de la seule unité d’élite présente à Berlin. Mon régiment était entièrement composé de combattants triés sur le volet qui avaient fait leurs preuves. Ils étaient tous hautement décorés pour acte de bravoure et chaque officier arborait la croix de chevalier. J’avais en mémoire les événements de 1918 : on avait alors reproché aux unités de la garde des hésitations qui avaient contribué aux succès de la révolution. Je ne tenais pas du tout à m’exposer à de semblables reproches devant l’histoire.
Une fois rentré dans mes quartiers, je réunissais mes officiers et les informais de la situation et des ordres. La prétendue mort d’Adolf Hitler a plongé les officiers et les hommes dans la consternation la plus totale. Jamais de ma vie, même plus tard au moment de la défaite finale, je n’avais été le témoin d’un tel abattement. On pourra raconter ce qu’on voudra à ce sujet, je garantis que c’est la vérité.

Je ne cachais pas à mes officiers qu’il restait bien des points à éclaircir et que j’étais résolu à ne pas me laisser exploiter ni moi ni mon unité. J’ai expressément demandé à chacun de mes officiers une confiance inconditionnelle et une obéissance absolue : comme si nous étions au front. Cette exigence assez exceptionnelle faisait suite à un appel téléphonique que j’avais reçu durant la réunion d’un général que je n’ai pas reconnu – probablement le major-général Friedrich Olbricht – du haut commandement de l’armée de réserve, qui voulait réquisitionner une compagnie de mon régiment pour une mission spéciale. J’ai rejeté cette demande en faisant valoir qu’on m’avait confié une mission clairement définie et que la dispersion de mes forces ne me paraissait pas opportune.
Après le point avec mes officiers, j’ai reçu d’autres rapports encore plus déconcertants. Le premier émanait du premier-lieutenant, le Dr. Hagen, un membre de mon état-major, qui m’informait qu’en rentrant à la caserne, il avait vu le Field Marshal Brauchitsch, en grand uniforme, conduisant sa voiture dans les rues de Berlin. C’était étrange dans la mesure où Brauchitsch était à la retraite. Vu les circonstances, son apparition en uniforme paraissait étonnante. On a su plus tard que l’officier vu par Hagen ne pouvait pas être Brauchitsch, c’était probablement l’un des conspirateurs.
Le second rapport émanait du lieutenant-colonel Wolters qui avait été rattaché à mon régiment en tant qu’officier de liaison par le commandement central. Il me disait que je ne devais pas penser qu’il était là pour surveiller mes faits et gestes. Une telle remarque était particulièrement déplacée. Non seulement elle était incongrue et agaçante, mais elle éveillait précisément la suspicion qu’elle était censée apaiser : quelqu’un s’était prévu un atout dans la manche. Comme il est apparu, c’est ma réunion avec mes officiers qui avait provoqué des réticences chez le colonel. Pour éviter toute responsabilité, il est tout bonnement rentré chez lui, un comportement impensable pour un officier en service.
J’avais des doutes sur la véracité de la présentation de la situation faite par le major général von Hase. J’entretenais aussi des doutes par rapport à une autre version de l’histoire selon laquelle Hitler avait été tué par les SS. Je décidais donc qu’il fallait que je détermine les faits par moi-même. J’ai téléphoné à tous les PC possibles. Il s’agissait ni plus ni moins que d’une classique reconnaissance, une conduite normale pour tout officier avant d’engager ses troupes. Remarquons au passage que ce genre d’interrogations et d’agissements ne cadre pas vraiment avec l’obéissance mécanique que certains se plaisent à attribuer à l’armée du troisième Reich
Entre autres, je décidais d’envoyer le premier-lieutenant, le Dr. Hagen, qui s’était vivement porté volontaire, au délégué de la Défense du Reich pour Berlin, le Dr. Joseph Goebbels. Le Dr. Hagen avait jadis travaillé pour Goebbels au ministère de la propagande. Je pensais qu’en l’envoyant auprès de Goebbels, je serais informé non seulement de la situation militaire, mais aussi de la situation politique.
Goebbels n’était pas seulement le ministre de la propagande du Reich, il était aussi le Gauleiter et le délégué de la Défense pour Berlin. Dans le cadre de ces deux dernières fonctions, il était le patron de la division « Grossdeutschland » dont les soldats venaient de toutes les provinces du Reich.
Environ une heure et demie après le début de l’alerte « Walkyrie », mon régiment alors en ordre de combat, occupait les points de passage prévus. Les unités de gardes habituelles, comme celles du monument de la guerre et du Bendlerblock, le quartier général de l’armée de réserve et du bureau de la production de guerre, restaient à leur poste. Vers 16h15, le lieutenant Arends, l’officier de service au Bendlerblock, me signale qu’on lui a ordonné de fermer toutes les entrées du bâtiment. Un certain colonel Mertz von Quirnheim, qu’Arends ne connaissait pas, lui avait confié cette mission. Arends a ensuite reçu des instructions du général Olbricht pour ouvrir le feu sur toute unité SS qui pourrait se présenter.
Après avoir personnellement inspecté les nouvelles positions de mes troupes, il devait être aux environs de 5 heures de l’après-midi, je retournais une nouvelle fois auprès du gouverneur de la ville, le général von Hase, pour rendre compte de la bonne exécution de ses ordres. Il m’a alors été demandé que j’établisse mon PC à cet endroit, au siège du gouverneur de la ville, en face du monument de la guerre. J’avais déjà établi dans les casernes de Rathenow un centre de communications, dirigé par le lieutenant Gees, ce qui me permettait de rester en contact avec mes troupes. Von Hase m’a alors donné une nouvelle mission : boucler très étroitement le pâté de maisons au nord de la gare ferroviaire d’Anhalt (il m’a montré où sur une carte).
Comme que je commençais à exécuter ses ordres, je me rendais compte que ledit pâté de maisons abritait le siège de la sécurité du Reich. Le flou trompeur de cet ordre fallacieux n’a fait que renforcer mes doutes. Pourquoi ne m’avait-on pas clairement dit de placer le siège de la sécurité du Reich sous contrôle ? Il va de soi que j’aurais également exécuté cet ordre.
Aussi, lors de ma troisième visite au général von Hase, je lui ai directement posé la question : « mon général, pourquoi est-ce que je reçois des ordres aussi énigmatiques ? Pourquoi est-ce qu’on ne m’a pas simplement demandé de faire attention au siège de la sécurité du Reich ? ». Von Hase était sur des charbons ardents, il a éludé la question. Si on se demande comment un jeune officier comme moi pouvait se permettre de telles libertés avec un général, il faut savoir que nous, les jeunes officiers, nous nous considérions comme les vrais chefs de guerre, endurcis et éprouvés au front, et nous n’avions que peu de considération pour les guerriers de bureau de l’arrière.
À cet égard, je voudrais faire une remarque tirée de ma longue expérience au front. Tout comme lors de la Première Guerre mondiale c’étaient les commandants à la tête des troupes de choc qui représentaient le cœur de la guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, c’étaient les jeunes chefs du front, ceux qui avaient forgé une indissoluble fraternité d’arme avec leurs hommes, qui représentaient le cœur de la bataille. Ces hommes n’étaient pas seulement aptes à combattre, ils voulaient se battre pour la victoire de l’Allemagne.
Au bureau de von Hase, j’ai surpris une conversation entre ce dernier et son chef d’état-major où il était question de l’arrestation de Goebbels et de ce que cette mission devait m’incomber. Comme je n’avais pas la moindre envie d’arrêter Goebbels, qu’au contraire je cherchais à le joindre, je suis intervenu dans la conversation et j’ai dit au général Hase :
« Mon général, je ne me considère pas comme la personne la plus appropriée pour cette mission. Comme vous le savez, je suis affecté à la division « Grossdeutschland » dont je porte les insignes depuis des années. Cette mission serait très peu convenable pour moi, car, comme vous le savez sans doute, le Dr. Goebbels, en sa qualité de Gauleiter de Berlin est en même temps le patron de la « Grossdeutschland ». Pas plus tard qu’il y a deux semaines, je rendais ma première visite à Goebbels en tant que nouveau commandant du régiment de la garde. Pour cette raison, je pense qu’il serait particulièrement malvenu que ce soit moi, précisément, qui soit chargé de son arrestation. »
Von Hase semble avoir eu quelque compréhension pour mes réticences. Quoi qu’il en soit, il demandait maintenant à la police militaire d’assurer l’arrestation du Dr. Goebbels, ministre du Reich.
Vers cinq heures et demie de l’après-midi, le lieutenant Hagen parvenait enfin à voir le Dr. Goebbels à sa résidence privée, 20 rue Hermann Göring, à côté de la porte de Brandebourg : il n’avait pas réussi à le rencontrer au ministère de la propagande. Le ministre n’avait pas la moindre idée de la menace qui pesait sur lui. Ce n’est que lorsque Hagen lui a montré, pour souligner la gravité de la situation, les véhicules du régiment de la garde qui patrouillaient, que Goebbels s’est alarmé. Il criait, « mais c’est effroyable, que va-t-on faire ». Ce à quoi Hagen a répondu en suggérant que « Le mieux que vous auriez à faire, serait de faire venir ici mon supérieur ». Goebbels demanda abruptement : « Est-ce qu’on peut faire confiance à votre supérieur ? » « J’en réponds sur ma vie » répliqua Hagen.
Comme j’empruntais le couloir en quittant le bureau du gouverneur de la ville, je me disais que j’allais peut-être enfin réussir à trouver mes repères suite à la visite de Hagen à Goebbels.
Hagen était rentré à la caserne, il avait donné à Gees ses instructions, puis s’est rendu en voiture à mon nouveau PC au quartier général sévèrement gardé. Craignant de se voir refuser le passage, il n’a pas cherché à entrer, il s’est contenté d’informer mon aide-de-camp, le lieutenant Siebert, et mon ordonnance, le lieutenant Buck, de la situation, leur demandant de m’en avertir sans délai. Ils m’ont rapporté ce qui suit :
« Il y a une situation entièrement nouvelle ! Il s’agit probablement d’un putsch! On ne sait rien de plus. Le délégué de la défende du Reich demande que vous veniez le plus vite possible. Si vous n’êtes pas là dans les vingt minutes, il en conclura qu’on vous en empêche par la force. Dans ce cas, il se verrait obligé d’en avertir les Waffen-SS. Pour éviter une guerre civile, il a jusqu’à maintenant ordonné à la Leibstandarte [la garde personnelle d’Hitler, la première division de la Waffen-SS] de rester où elle est. »
Quand j’ai pris connaissance de ce qui précède de la bouche de mon aide de camp, j’ai décidé de voir à nouveau le général von Hase. À ce moment-là, comme on peut le voir, je lui faisais encore confiance Je demandais au lieutenant Buck de répéter encore en sa présence le message de Goebbels. Je ne voulais pas avoir l’air d’être un comploteur. En bon officier vétéran du front, je mettais cartes sur table. D’emblée, Von Hase a rejeté ma demande de répondre à l’invitation de Goebbels pour que je puisse, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, clarifier la situation.

En quittant, sans encombre, le quartier général, je délibérais avec mon aide-de-camp, le lieutenant Siebert – aujourd’hui pasteur à Nuremberg – de la conduite à tenir. L’importance de mon rôle dans cette situation difficile et confuse que je n’avais pas créée m’apparaissait de plus en plus clairement. Je commençais à me rendre compte que d’une manière ou d’une autre, je risquais ma tête. Après avoir évalué la situation aussi attentivement que possible, je prenais la décision qu’en dépit des ordres de Hase, j’irai voir Goebbels. Mes raisons étaient les suivantes :
En premier lieu, comme au front, je ne voulais à aucun prix me départir de ma liberté d’action. Souvent la marge était étroite entre la haute distinction et la condamnation à mort par une Cour martiale.
Deuxièmement, je me sentais toujours tenu par mon serment. La nouvelle de la mort du Führer était toujours douteuse, en conséquence, je devais agir selon le serment prononcé devant le drapeau.
Troisièmement, sur le front, j’ai eu à plusieurs reprises à prendre des décisions personnelles, décisions qui ont conduit à des succès qui m’ont valu les plus hautes décorations. Bien des situations ne sont maîtrisables qu’au prix d’actions décisives. Je me sentais comme un camarade du front qui ne comprendrait pas que je reste passif par manque de courage. Je ne pouvais pas laisser les choses déboucher sur une issue désastreuse. Je pensais à 1918.
Enfin, j’étais sous la menace, puisque Goebbels avait dans l’idée d’alerter la Waffen SS, d’une guerre fratricide entre deux unités qui avaient, toutes deux, fait la preuve de leur valeur combattante. En tant que commandant de la seule unité d’élite en service à Berlin, j’étais responsable de la vie des hommes qu’on avait placés sous mon autorité. Et il n’était pas responsable de risquer leur vie dans une affaire aussi embrouillée.
Pour autant, je ne faisais pas entièrement confiance à Goebbels non plus. Comme je pensais que Hitler était mort, une lutte pour la succession me semblait possible. Je n’avais pas la moindre envie de me laisser entraîner dans des guerres diadoques. Dans la mesure où le jeu de Goebbels n’était pas clair, j’ai emmené avec moi le lieutenant Buck et un peloton de soldats. Leurs instructions étaient de venir me chercher si je ne ressortais pas de la résidence de Goebbels dans les 15 minutes.
Après avoir défait la sangle de sûreté de mon holster, je pénétrais dans le bureau du ministre. On m’y attendait avec impatience. Je demandais à Goebbels d’éclairer ma lanterne mais à son tour Goebbels m’a demandé de dire tout ce que je savais. Je m’exécutais, sauf en ce qui concernait l’intention de von Hase de l’arrêter puisque je n’étais pas sûr du rôle que jouait Goebbels dans tout ceci. Quand il m’a demandé ce que j’avais l’intention de faire, j’ai dit que je m’en tiendrai à mes ordres militaires et que j’étais déterminé à les exécuter. Même si le Führer n’était plus en vie, je me sentais tenu par mon serment et ne pourrais agir qu’en accord avec ma conscience d’officier. Goebbels m’a alors regardé avec effarement et s’est écrié : « Mais de quoi parlez-vous ? le Führer est vivant ! Je viens de lui parler au téléphone. L’attentat a échoué, vous avez été berné. »
J’étais stupéfait à mon tour. En apprenant que le Führer avait réchappé de l’attentat, j’ai ressenti un immense soulagement.
Mais j’étais encore méfiant et je demandais à Goebbels qu’il me certifie sur l’honneur que ce qu’il disait était vrai et qu’il était toujours inconditionnellement derrière le Führer. Goebbels a d’abord hésité parce qu’il ne voyait pas la raison de ma demande. Ce n’est qu’après que je lui aie répété qu’en tant qu’officier, il me fallait, pour en avoir le cœur net, sa parole d’honneur, qu’il a accepté.
Mon souhait de téléphoner au QG du Führer rejoignait le sien. En un instant, j’étais en communication avec l’antre du loup à Rastenburg en Prusse-Orientale. À ma grande surprise, Hitler lui-même a pris la communication. Goebbels lui a rapidement présenté la situation puis m’a passé l’appareil.
Adolf Hitler m’a dit à peu près ceci : « Major Remer, vous m’entendez ? Vous reconnaissez ma voix ? Vous me comprenez ? Je répondais affirmativement mais j’étais néanmoins sur mes gardes. L’idée me traversait l’esprit que quelqu’un pouvait imiter la voix du Führer. Il est vrai que j’avais eu l’occasion d’entendre le Führer de vive voix l’année précédente, lorsqu’il a ajouté les feuilles de chêne à ma croix de chevalier. J’ai pu m’entretenir une heure avec lui, seul à seul, en toute franchise, sur les grandeurs et les misères du front. Ce n’est qu’au fur et à mesure de l’appel que j’ai eu la conviction que j’étais vraiment en train de parler à Hitler. Il poursuivit :
« Comme vous pouvez le voir, je suis en vie. L’attentat a échoué. Ainsi en a décidé la providence. Une petite clique d’officiers ambitieux et déloyaux voulaient me tuer. Maintenant, nous tenons ces saboteurs du front. Nous allons mettre au pas tous ces traîtres en vitesse, au besoin par la force.
À partir de cet instant, Major Remer, je vous donne totale autorité sur Berlin. Vous êtes responsable personnellement devant moi, et moi seul, du retour à l’ordre et du rétablissement de la sécurité dans la capitale du Reich. Vous resterez sous mon autorité personnelle jusqu’à ce que le Reichsführer Himmler vienne vous relever de cette responsabilité. »
La voix du Führer était très calme, déterminée et convaincante. Je pouvais respirer, la conversation avait fait s’envoler tous mes doutes. Le serment du soldat que j’avais prêté au Führer était toujours valide et était le principe directeur de ma conduite. À présent mon seul souci était d’éliminer tous les malentendus et d’éviter d’inutiles effusions de sang en agissant rapidement et de façon décisive.
Goebbels m’a demandé de l’informer du contenu de la conversation avec Hitler et de ce que je comptais faire. Il a mis les pièces du rez-de-chaussée de sa maison à ma disposition et j’y ai installé mon nouveau poste de commandement. Il était alors six heures et demie du soir. Un quart d’heure plus tard, la première annonce de l’attentat à la bombe au QG d’Hitler était diffusée à la radio sur le réseau national.
Suite à ma visite au QG du gouverneur de la ville, j’avais une idée générale de la position des unités qui marchaient sur Berlin. Pour faire savoir à leurs commandants la situation réelle, j’ai envoyé des officiers d’état-major tous azimuts avec une question simple : « avec ou contre le Führer ? ». Succès complet, la question a fait des miracles. Je peux dire sans équivoque que tous les commandants d’unités étaient, sans exception, révulsés par ce qui s’était passé et qu’ils se sont tous sans condition, même s’ils étaient d’un rang supérieur au mien, placés sous mon commandement. Ils ont ainsi démontré que le serment du soldat les liait aussi.
Des difficultés passagères ont pu surgir ici ou là lorsqu’il n’était pas possible d’informer quelqu’un personnellement.
Dans toute cette atmosphère d’incertitude, et en raison des malentendus – certains pensaient que le régiment de la garde qui bouclait la zone prévue s’était mutiné – par deux fois mon régiment a manqué d’un cheveu se faire tirer dessus par d’autres unités. Sur ordre des conspirateurs, une brigade blindée s’était concentrée sur la Fehrbelliner Platz, mais un ordre radio du lieutenant général Guderian a permis de soustraire cette unité à leur contrôle. Cette unité a ensuite effectué des reconnaissances et a conclu par erreur que le régiment de la garde de la « Grossdeutschland » s’était rangé du côté des conspirateurs et avait arrêté Goebbels. Plusieurs blindés de la brigade avaient même commencé à se mettre en mouvement et si je n’étais pas intervenu personnellement pour dissiper la confusion, cela aurait pu conduire à un bain de sang.
La même chose s’est produite devant le Bendlerblock, le QG de l’armée de réserve, au moment où une compagnie de panzergrenadier a essayé de s’en prendre à ma garde, une garde qui était là avec l’autorisation du Führer. L’énergique intervention d’un de mes officiers a permis de clarifier les choses au dernier moment et d’empêcher que des soldats allemands ne se tirent dessus. Ici aussi, la question « pour ou contre Hitler » s’est révélée décisive. Il s’agissait du capitaine Schlee, l’un de mes chefs de compagnie que j’avais dépêché devant le Bendlerblock. À ce moment-là, je n’avais pas encore réalisé que la tête de la conspiration se trouvait justement dans le Bendlerblock. Schlee avait comme consigne de retirer la garde parce que je cherchais à éviter le plus possible que le sang ne coule. Quand il est arrivé, on lui a ordonné de se présenter au général Olbricht. Schlee avait pris la précaution de dire à la garde de venir le chercher de force dans l’éventualité où il ne serait pas de retour rapidement. Sage précaution puisqu’il a été mis aux arrêts dans l’antichambre du général par le colonel Mertz von Quirnheim, qui lui a ordonner de rester là. Mais quand Mertz est entré dans le bureau d’Olbricht, Schlee en a profité pour ressortir sans demander son reste.
Quand il est retourné à la garde, le lieutenant Arends l’a informé d’un étrange incident. Il avait entendu des cris en provenance des étages du bâtiment, puis, aussitôt, on avait jeté d’une fenêtre qui donnait sur la cour une machine à écrire et un téléphone. Schlee a alors tourné les talons et, à la tête d’une patrouille, est remonté pour voir ce qui se passait. Il a rapidement identifié la pièce d’où provenaient les bruits ; elle était fermée mais sans surveillance, et la clé était restée dans la serrure. Il y avait à l’intérieur le général von Kortzfleisch commandant le district militaire de Berlin. C’est lui qui avait passé par la fenêtre le téléphone et la machine à écrire. Le général avait été convoqué au Bendlerblock pour y recevoir ses ordres. À son arrivée, il a obstinément refusé de collaborer avec les conspirateurs. Il a été arrêté et enfermé mais laissé sans surveillance. Une fois libre, il nous a fourni les premières informations concernant la tête de la conspiration. À 7h30 du soir, nos gardes ont été retiré conformément à ce que j’avais demandé. Olbricht devait alors les remplacer par ses propres hommes. Le commandant de la nouvelle garde était le lieutenant-colonel Fritz von der Lancken. En partant, Schlee apprit par un capitaine du centre de communications du Benderblock que le Führer m’avait demandé de mater le putsch. Ils ont pu entendre ma conversation avec le Führer et ont réalisé que les télex qu’on leur demandait d’envoyer n’étaient autres que les ordres des conspirateurs. Ces hommes ont alors délibérément retardé l’envoi des messages, ou parfois, ne les ont pas envoyés du tout.
Quel plan préparé de main de maître : les conspirateurs n’avaient même pas de complice! Et les télex et les appels téléphoniques qui continuaient d’affluer du QG du Führer de sorte que l’évolution de la situation était transparente.

D’innombrables ordres ont été donnés dans la soirée de ce 20 juillet. Entre autres mesures prises, j’ai rapproché la brigade de remplacement de la «grossdeutschland » de Cottbus vers la banlieue de Berlin pour le cas où. Cette brigade, aussi, avait reçu des ordres des conspirateurs. Son chef, le colonel Schulte-Neuhaus, un authentique combattant qui avait perdu un bras et dont j’avais fait la connaissance au front est venu faire son rapport à mon PC. Je l’ai présenté à Goebbels. De mon côté, je concentrais mes propres troupes aux abords de la chancellerie et constituais une forte réserve de combat dans le jardin de la résidence de Goebbels. Goebbels m’a demandé de m’adresser aux troupes rassemblées là, ce que j’ai fait. Ils étaient tellement enragés par la trahison en cours, qu’ils auraient déchiqueté chacun des conspirateurs un par un s’ils les avaient eu sous la main.
Puis j’ai fait encercler le centre de commandement de la ville parce que j’avais l’impression qu’il s’y trouvait des personnages douteux. J’ai aussi appris qu’après mon refus d’arrêter Goebbels, on avait demandé à la police militaire de le faire. J’ai attendu en vain leur arrivée. Plus tard, j’ai entendu dire que pas une unité n’était disposée à arrêter Goebbels en sorte qu’il ne restait plus à Hase qu’à le faire lui-même. Hase se trouvait alors au PC de son adjoint chez qui il s’était rendu pour discuter des mesures à prendre avec un général que les conspirateurs avaient placé là. Ils ont discuté pendant deux heures sans parvenir à aucune décision, ce qui est typique de ces combattants de papier.
Dès que j’ai su que von Hase était rentré au centre de commandement de la ville, je l’ai appelé au téléphone pour lui demander de se présenter à mon PC, à la résidence de Goebbels, pour clarifier la situation. Il a d’abord refusé mon invitation prétextant que, puisque j’étais son subordonné, c’était à moi de me rendre chez lui. Je lui ai dit que le Führer m’avait directement placé sous ses ordres pour restaurer l’ordre et la sécurité et que Hase se retrouvait donc sous mon autorité et que s’il ne venait pas de lui-même, j’irais le chercher. Ce n’est alors que le général est arrivé. À ce stade, j’avais toujours l’impression que von Hase, qui avait souvent été mon invité au mess des officiers, qui avait souvent exprimé sa solidarité avec les soldats du front et qui n’avait jamais omis dans aucun de ses discours un « Sieg Heil ! » à l’attention de son Führer bienaimé, avait été trompé, tout comme moi, et qu’il n’était pas au courant de ce qui se passait. Je me suis donc excusé pour ma conduite singulière. À son arrivée, Hase était l’affabilité personnifiée ; il m’a même félicité pour mon indépendance, pour mon esprit de décision et pour avoir cherché à contacter Goebbels, en quoi disait-il, j’avais évité pas mal de bêtises.
Même avec Goebbels von Hase a joué les innocents et s’est conduit comme s’il n’avait pas la moindre idée d’une quelconque conspiration. On lui a demandé de rester là dans l’attente d’information et une pièce a été mise à sa disposition. Comme Hase quittait le bureau de Goebbels, il s’est produit un incident embarrassant qui m’a fait, en tant qu’officier allemand, rougir de honte. Au beau milieu de ces événements dramatiques, von Hase déclarait qu’il avait été débordé toute la journée et qu’il n’avait rien mangé. Goebbels a aussitôt proposé de faire préparer un sandwich et demandé s’il voulait aussi un verre de Moselle. Hase parti, Goebbels a ricané :
« Mon nom est Hase [lièvre] et je ne sais rien. » Voilà toute l’étoffe de nos putschistes. Avec le fer encore au feu, ils veulent qu’on leur apporte à boire et à manger et ils téléphonent à leurs mamans. À leur place, je me ferais arracher la langue plutôt que de faire de telles demandes.
Deux choses illustrent à quel point toute l’affaire était mal préparée.
Mes conversations et mes ordres transitaient par le même centre de communications que celui dont se servaient les conspirateurs pour disséminer leurs messages un peu partout. Ce centre étant au Bendlerblock, il était en principe sous leur contrôle. Les agents de transmission auraient pu retarder l’envoi de mes messages ou même les bloquer, ils auraient pu couper mes appels téléphoniques, ils n’en firent rien. J’ai même reçu un message des services de la radiodiffusion du Reich me demandant ce qui se passait. J’ai alors pu donner des ordres pour qu’en aucun cas ils ne fassent d’émission exceptionnelle. En conséquence, les comploteurs ont aussi été privé de l’usage de cet important média.
Que savons-nous de ce qui s’est passé au centre de radiodiffusion de la Masurenallee ? On avait demandé au major Jacob d’aller occuper le centre mais, de façon surprenante, sans lui demander de diffuser une quelconque annonce ni de fermer la station. Il a essayé de téléphoner aux conspirateurs pour rendre compte de son occupation des locaux de la radio et pour demander des instructions, mais sans succès. Ces problèmes de communication étaient courants. Sur le front, la procédure en pareil cas était d’établir une communication radio ou d’avoir recours à une estafette. Le major Jacob avait en outre un téléscripteur à sa disposition mais il n’a utilisé aucun de ces moyens. Stauffenberg, l’officier d’état-major à l’origine du putsch, ne s’était pas préoccupé de ce genre de petits détails et n’avait pas prévu de moto pour le courrier.
Rudolf-Günther Wagner, l’homme qui devait diffuser la proclamation des conspirateurs, expliqua plus tard que :
« Je savais depuis des lustres que je devais diffuser la proclamation le jour du putsch. J’ai fiévreusement attendu la venue du lieutenant qui devait l’apporter. Mais hélas, en vain, au lieu de cela, j’ai entendu les haut-parleurs de Goebbels annoncer que l’attentat avait échoué. »
Comme on le sait maintenant, le général Lindemann, qui avait le texte de la proclamation, était introuvable. Le général Beck n’était pas disposé à intervenir. Il a ordonné à Hans-Bernd Gisevius, un conspirateur de l’Abwehr, d’apporter la proclamation. Mais Giesevius devait d’abord refaire une nouvelle version de la déclaration avec Stauffenberg, Hoepner, Yorck, Schwerin, et Schulenburg qui lui hurlaient des suggestions. Dans ce fiasco également, Stauffenberg, le « cerveau » de la conspiration, porte une lourde responsabilité. Pour maintenir une station de radio en état de marche, il faut un personnel compétent et de confiance. Une équipe avait bien été prévue au centre de commandement de la ville, mais elle est restée là passivement à attendre jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée par l’action de la contre-insurrection. Hans Kasper, qui faisait partie de l’opération Jacob, a par la suite eu ce commentaire :
« C’est alors que le 20 juillet a échoué. Du point de vue d’un éditorialiste de radio c’était tragique. Tragique parce qu’au vue de la façon qu’on avait eu de gérer les choses, il était évident que la révolte avait eu très peu de chances de réussir. »
Dans l’intervalle, le lieutenant Schlee m’avait tenu informé de ce qui se passait au Bendlerblock. Je ne connaissais pas le fond de l’histoire : que le lieutenant général Fromm, commandant en chef de l’armée de réserve s’était retiré du complot et avait été arrêté par les conspirateurs. Schlee a ensuite reçu l’ordre, notre garde ayant été relevé, de cerner le Bendlerblock sans chercher à entrer dans le bâtiment. Vers 7 heures environ, j’avais le sentiment d’avoir bien en main la situation à Berlin. La tension a commencé à se calmer.
À propos de l’auteur : Né en 1912, Otto Ernst Remer s’est enrôlé dans l’armée allemande en 1930. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a servi en tant qu’officier du front en Pologne, dans les Balkans et dans la campagne contre l’Union Soviétique. Il a été blessé à huit reprises, son courage et ses capacités lui ont valu entre autres la croix allemande d’or et la croix de fer. En mai 1940, il a reçu le commandement du régiment de garde de la « grossdeutschland » à Berlin.
Remer a joué un rôle-clé dans la répression de la tentative d’assassinat d’Hitler et de prise de pouvoir de Claus von Stauffenberg et de ses complices du 20 juillet 1944. Ce jour-là, l’un des conspirateurs, Pau von Hase, avait donné l’ordre à Remer et à ses troupes de cerner les bâtiments gouvernementaux dans le centre de Berlin et d’arrêter Goebbels. Mais Goebbels a mis Remer directement en liaison avec Hitler qui lui a ordonné au téléphone d’arrêter les conspirateurs à Berlin et d’étouffer la tentative de coup d’État. Remer l’a fait rapidement et sans effusion de sang.
Promu colonel, il a pris part en décembre 1944 à la contre-offensive des Ardennes. Il a été fait major-général le 30 janvier 1945. Dans les dernières semaines de la guerre, il a commandé une division blindée en Poméranie. Après la guerre, il a participé à la création du Parti Socialiste du Reich (SRP), qui a été interdit. Après qu’une Cour l’ait condamné à de la prison pour « négation de l’Holocauste » il a émigré en Espagne où il est mort en exil en octobre 1997.
Cet essai est tiré du Journal of Historical Review, printemps 1988 (Vol. 8, No. 1), pages 41-53. Il s’agit de la traduction en anglais par Mark Weber d’un chapitre des mémoires de Erns Remer, Verschwörung und Verrat um Hitler (« Conspiration et trahison autour d’Hitler »). On trouvera dans le même numéro de la revue de l’iHR une note sur ces mémoires. Cet essai vient en parallèle de l’allocution de Remer à la huitième conférence de l’iHR (1987).
Traduction en français de la version anglaise : Francis Goumain





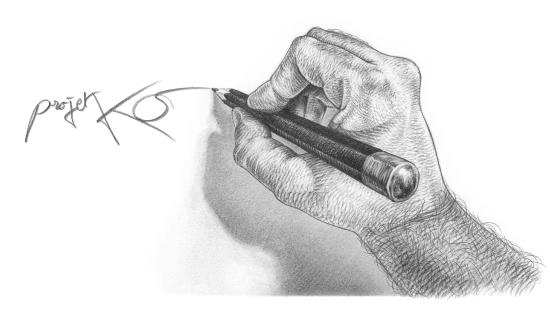


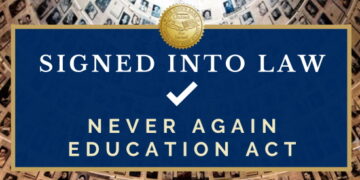














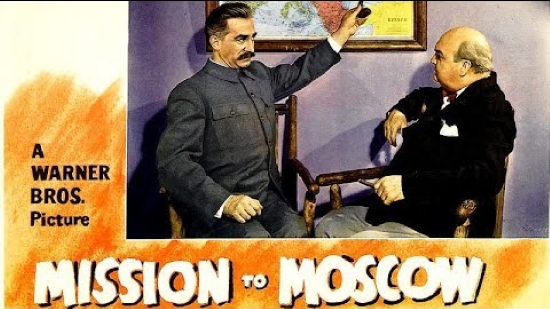



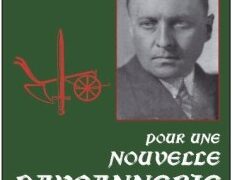


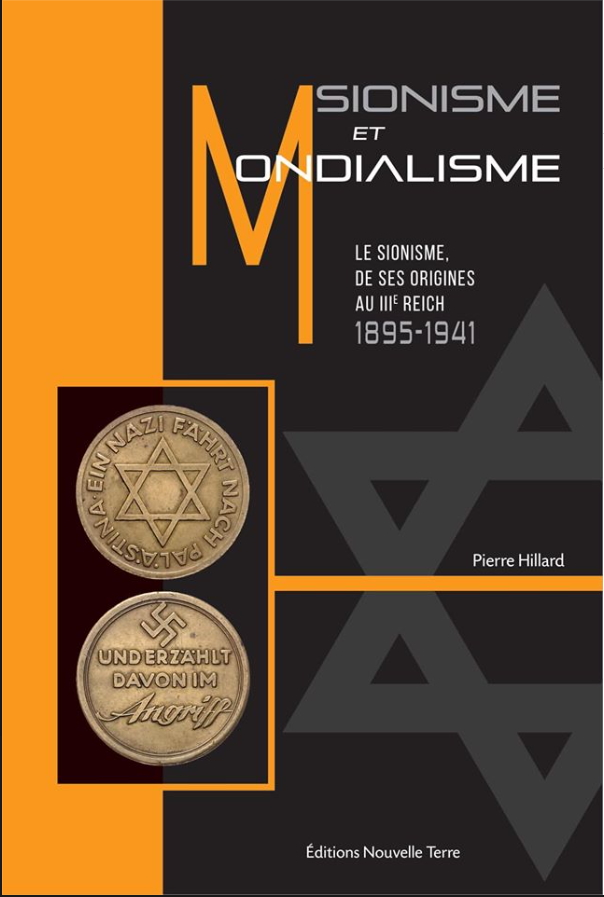
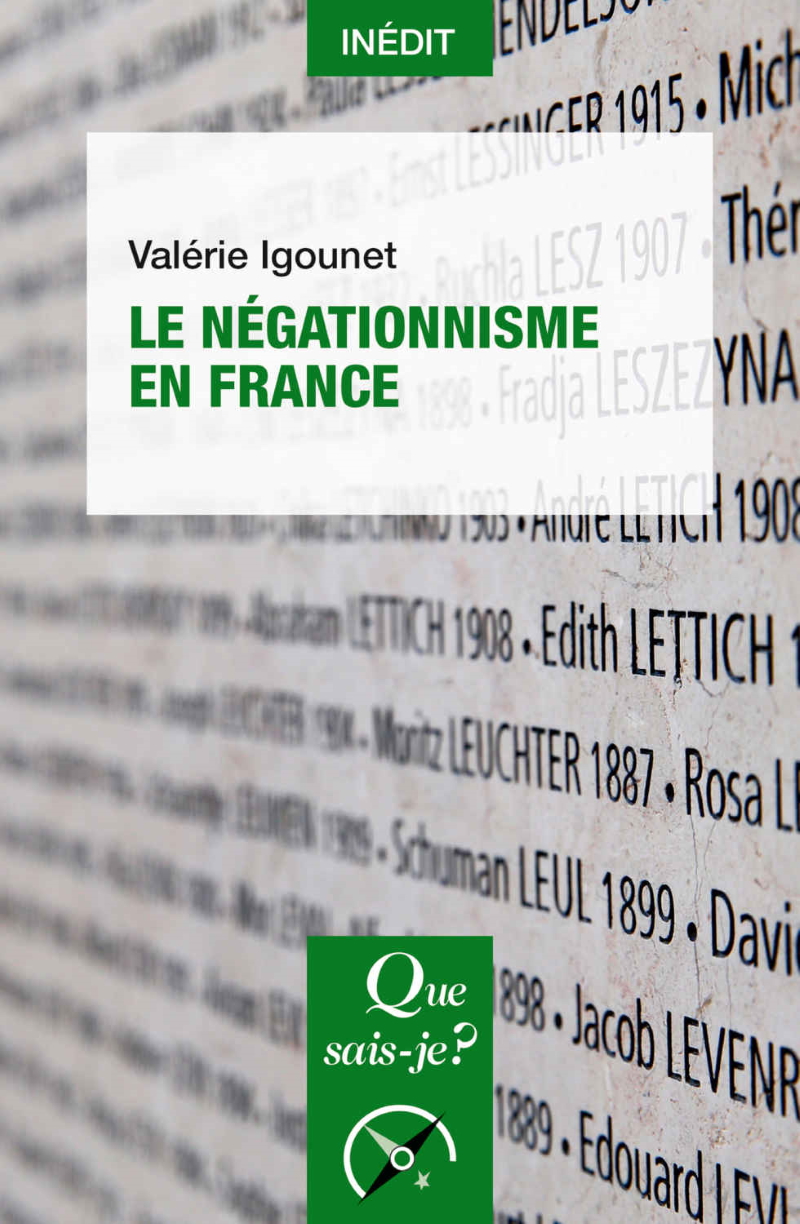



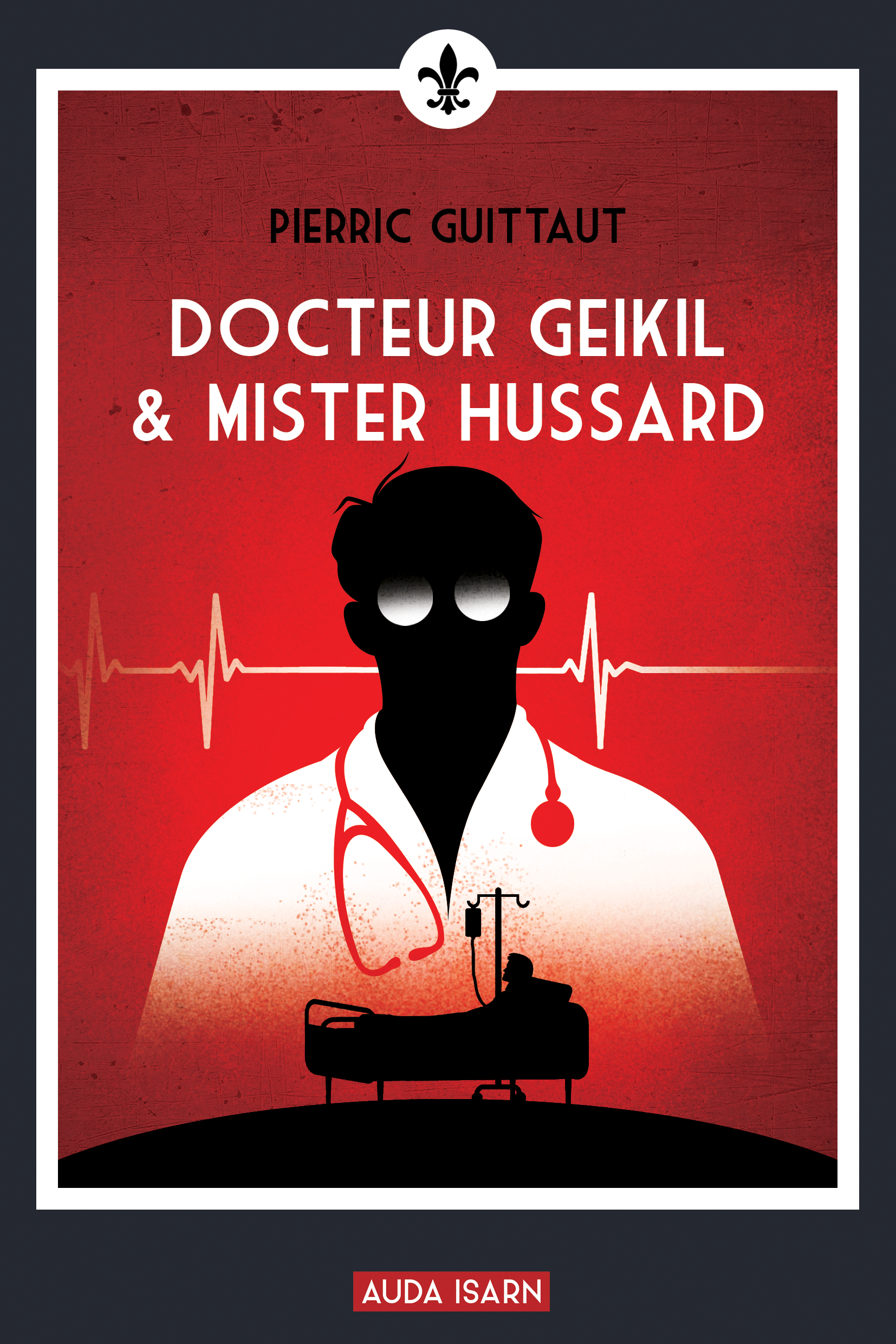









 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV








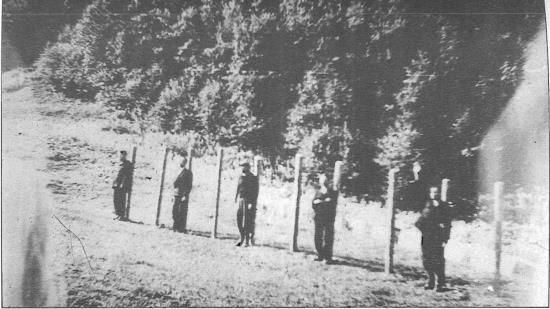
Commentaires 1