Roosevelt et l’affaire Tyler Kent en mai 1940
À quoi tient l’histoire. En mai 1940, le jeune Tyler Kent, agent du chiffre à l’ambassade américaine à Londres était sur le point de révéler au monde le double jeu de pompier-pyromane de Roosevelt en Europe. Pire, il avait les copies des documents prouvant que Roosevelt était en train de chercher à passer outre à la loi sur le statut de pays neutre votée expressément par le Congrès pour empêcher que l’Amérique ne soit entraînée dans un conflit en Europe (Johnson and Neutrality acte). Si Kent avait réussi à lancer l’alerte, l’effet sur le public américain aurait été monstrueux tant il était, à une écrasante majorité, pour la non-intervention. Le Congrès aurait pratiquement été obligé de destituer le président Roosevelt, l’aide matérielle des USA à l’Angleterre aurait sans doute été ralentie voire stoppée et la guerre probablement perdue pour elle.
Quelque 40 années plus tard, ce même Tyler Kent sort du silence et donne une conférence à l’Institute for Historical Review sur sa propre affaire. Un captivant mélange de grande et de petite histoire, un témoignage humain aussi sur un petit qui voit tout et qui veut changer le cours de l’histoire, mais aussi quelqu’un qui a de solides convictions anticommunistes … et antisémites. Antisémitisme, toute la clé de lecture de ce témoignage de Tyler est là : Tyler Kent ne reproche pas à Roosevelt de trahir l’Amérique au profit de l’Angleterre, une telle assertion n’aurait aucun sens, un Américain c’est un Anglais et vice-versa. Entre eux, ils ont cet adage : « blood is stronger than water », autrement dit, « le sang de la race qui nous unit est plus fort que l’eau de l’Atlantique qui nous sépare ». C’est tellement évident qu’il n’y a jamais eu aucune puissance, ni aucune personne, surtout pas Hitler, pour essayer de jouer l’Amérique contre la Grande-Bretagne.
Non, Kent reproche à Roosevelt de trahir l’Amérique au profit du communisme et des Juifs. À Londres, le petit réseau de Tyler Kent comprenait Anna Wolkoff, une émigrée Russe blanche opposée à l’entrée en guerre de l’Angleterre contre l’Allemagne : parce qu’elle voyait dans l’Allemagne un rempart contre le communisme et peut-être même un possible libérateur de la Russie. Mais on peut même laisser de côté l’anticommunisme qui au fond n’est qu’un intermédiaire dans le raisonnement de Kent, intermédiaire qu’on peut allègrement sauter et arriver à l’antisémitisme. Dans ce même réseau londonien, on trouvait à sa tête le capitaine Archibald Ramsay, membre du parlement, signe particulier : antisémite virulent. Ce dernier adressait à Churchill le même reproche que faisait Tyler à Roosevelt : trahir le pays au profit des Juifs, faire leur guerre.

Nous donnons ci-après une traduction de sa conférence, il manque le tout début jugé un peu trop général et la toute fin un peu trop salée, inutilement salée d’ailleurs, les faits parlent d’eux-mêmes. De toute façon, on trouve en fin d’article le lien vers la source en anglais et on peut donc retrouver cette conclusion. Pour le lecteur qui serait particulièrement rétif à la langue de Shakespeare, il peut mettre à la place n’importe quel passage de Céline contenant le mot Juif : ça fera parfaitement l’affaire.
Mais auparavant, quelques mots du toujours remarquable et passionnant Mark Weber celui-là même qui nous avait fait connaître « Les dossiers Potocki » , voir « La campagne de Roosevelt pour pousser à la guerre en Europe », à noter que dossiers Potocki et dossiers Kent se confirment mutuellement.
Francis Goumain
###

Jusqu’au 11 mai 1940, Churchill était premier Lord de l’amirauté (chef de la marine). Aussi, l’échange de messages entre lui et Roosevelt jusqu’à cette date présentait un caractère hautement irrégulier puisqu’il avait lieu dans le dos du Premier ministre anglais, Neville Chamberlain. Officiellement, les chefs d’État ne communiquent qu’avec leurs homologues. Dans le cas de la correspondance Roosevelt-Churchill d’avant le 11 mai, non seulement les échanges se faisaient à l’insu de Chamberlain, mais ils avaient quelque chose d’une conspiration contre lui. Churchill voulait supplanter Chamberlain et Roosevelt lui-même souhaitait que cela se produise. La communication était tenue d’autant plus secrète : jusqu’à ce qu’il devienne Premier ministre, Churchill signait ses messages à Roosevelt d’une simple « personne de la marine ».
La simple révélation de l’existence d’une correspondance Churchill-Roosevelt dans le dos de Chamberlain aurait été des plus embarrassantes pour eux deux. Mais si Kent avait réussi d’une manière ou d’une autre à faire connaître leur contenu au public américain, il y aurait eu un tollé pour exiger la destitution de Roosevelt.
Kent a intercepté et fait une copie du message de Churchill à Roosevelt du 25 décembre 1939 (télégramme 2720) par lequel Churchill informe le président que les bateaux de guerre anglais continueraient de violer la souveraineté américaine en arraisonnant les bateaux allemands dans les eaux territoriales US. Toutefois, dans le but de garder ces violations secrètes, Churchill promet que les arraisonnements auront lieu hors de la vue des côtes américaines. « Nous ne pouvons pas éviter de stopper des bateaux ennemis dans la limite internationale des trois miles puisque ces bateaux pourraient en profiter pour alimenter les U-boats ou les raiders de surface, mais des instructions ont été données pour ne les arrêter ou ouvrir le feu sur eux qu’en dehors de la vue de la côte américaine ».

Dans son message à Roosevelt du 28 février 1940 (télégramme 490), également intercepté et copié par Kent, Churchill écrit que les Anglais continueraient de saisir et de censurer le courrier américain en partance d’Amérique ou d’autres pays neutres à destination de l’Europe. « Toute notre expérience montre que l’examen du courrier est essentiel à l’efficacité des contrôles ». Il s’agissait bien entendu d’une violation patente de la neutralité américaine et du droit international. L’émoi a été considérable aux États-Unis lorsqu’on a réalisé, des années plus tard, toute l’étendue de la saisie et de la censure des Britanniques sur le courrier américain à destination de l’Europe. Si le message intercepté par Kent avait été rendu public en 1940 ou 1941, il y aurait un scandale de première grandeur.
Par leur correspondance secrète, Churchill et Roosevelt ont aussi élaboré des procédures d’échange d’informations sur la localisation des raiders de surface et des sous-marins allemands ce qui, là encore, violait au moins l’esprit, si ce n’est la lettre de la neutralité américaine. […]
Mark Weber
###

Cet agent du chiffre, c’était moi.
Je suis né en 1911, mon père était fonctionnaire au ministère des affaires étrangères des États-Unis, à l’époque, il était en poste en Chine. À notre retour, j’ai poursuivi mes études supérieures à Princeton et dans plusieurs universités européennes. En 1933, j’ai rejoint le personnel de la nouvelle ambassade américaine à Moscou qui venait d’être inaugurée suite à l’établissement de relations diplomatiques avec la Russie bolchévique par Roosevelt. Je possédais déjà des rudiments de russe et grâce à mon don pour les langues, durant ma mission là-bas, je me suis mis à le parler presque couramment. J’en ai profité pour me mêler aux citoyens russes de base à Moscou et faire leur connaissance, découvrant ainsi de première main la nature brutale du bolchévisme, me rendant compte de ce que cela pourrait signifier si cette barbarie orientale devait se propager. J’ai appris à me méfier de cette nouvelle idéologie mondiale soi-disant progressiste dont les tenants se répandaient en louanges au sujet de ce qu’ils appelaient « la nouvelle civilisation » de l’Union soviétique. J’ai aussi pu mesurer la toute-puissance de la propagande juive qui faisait sans cesse État de prétendues brutalités du régime national-socialiste tout en ignorant superbement celles, bien pires de l’URSS. Cette dernière avait pourtant en la matière plus de dix d’avance sur le régime nazi. La raison de ce deux poids deux mesures sautait aux yeux : en Allemagne l’État s’en prenait aux Juifs, tandis qu’en Union soviétique, la police secrète (le NKVD) était presque entièrement entre leurs mains jusqu’à la toute fin des années trente. Les goulags, les « camps de travail », à vrai dire, plutôt des camps d’extermination, étaient entièrement sous leur coupe et ils pouvaient donc laisser libre cours à leur vengeance contre leur ennemi de toujours : le peuple russe.
Les Juifs d’Amérique et leurs alliés « progressistes » n’ont pas tardé à déclencher tout un battage médiatique appelant à la destruction de l’Allemagne et, implicitement, au renforcement de l’Union soviétique, le futur allié. Roosevelt pensait naïvement qu’il pourrait contrôler Staline tant qu’il lui donnerait tout ce qu’il demandait. Il était entretenu dans ces illusions par des « experts » kremlinologues tels que George Kennan, Charles Bohlen et Joseph E. Devis. Tous ces grands mages n’avaient en réalité rien appris durant leur séjour en Russie des projets des Soviétiques et de leur politique. Leurs oracles ne faisaient que refléter l ‘idéologie gauchiste en vogue dans les universités américaines. Par exemple, la doctrine tellement vantée de Kennan de l’endiguement, adoptée en 1948 par le CFR (Council on Foreign Relations), loin d’endiguer l’Union Soviétique, a eu pour effet de permettre que sa mainmise s’étende sur environ 40 pour cent de la planète et que s’établisse une place forte à Cuba qui n’était jamais située qu’à quelques encablures de la côte américaine. Ce n’est qu’à partir de 1948 que les responsables américains ont commencé à donner des signes d’inquiétude au sujet d’une éventuelle attaque communiste sur le monde civilisé. En toute modestie, je pense pouvoir dire que j’avais vu clair avec10 ans d’avance sur les « experts » attitrés du Kremlin.
Je suis arrivé à l’ambassade américaine à Londres, ma nouvelle affectation, en septembre 1939. Dans l’exercice de mes fonctions, j’avais accès à des documents politiques hautement sensibles. Presque immédiatement, je me suis aperçu de ce que les activités clandestines de l’administration Roosevelt étaient à l’opposé de ses déclarations officielles. Cela valait aussi bien pour Roosevelt que pour des personnages moins connus de son entourage. La loi sur la neutralité votée au Congrès était délibérément bafouée.
Il m’apparut alors inéluctable que je devais essayer d’en informer les bonnes personnes aux États-Unis. Il faut avoir à l’esprit qu’il n’y avait alors pas d’unanimité sur la question de l’attitude à adopter en cas de guerre en Europe, passivité ou intervention, pas plus au Congrès que dans l’esprit du public. Pour les sondages, il y avait quand même une énorme majorité en faveur de la non-intervention, 83 pour cent, mais d’un autre côté, il y avait les Juifs qui étaient violemment hostiles à l’Allemagne et qui faisaient usage de tout leur pouvoir sur la presse pour tanner le public et le faire basculer en faveur de la guerre.
On ne voyait pas pourquoi le désir de 3 pour cent de la population devrait prévaloir sur celui des 83 pour cent, quoi qu’il en soit, le corolaire de cette politique belliqueuse, c’est qu’il fallait à Roosevelt développer tout un système d’alliances contre le troisième Reich dans la mesure où aucune puissance prise isolément n’était en mesure de rivaliser avec l’armée Allemande. En plus de sa coopération avec des agents britanniques à Washington, Roosevelt avait deux séides en Europe dont la mission était de faire en sorte que la guerre soit déclarée à l’Allemagne. À savoir William C. Bullitt à Paris et Anthony Drexel Biddle à Varsovie.
Bullitt avait été ambassadeur à Moscou, et c’est d’abord plein d’enthousiasme pour la « nouvelle civilisation » qu’il s’y était rendu. C’était en 1934. En 1936, il en repartait complètement désillusionné par ce qu’il avait vu et par la manière dont il avait été traité. Bullitt était la quintessence de l’anglo-américain Fabiano-progressiste. C’était le riche playboy rejeton d’une famille de la finance à Philadelphie qui dès sa jeunesse avait embrassé les idées « libérales ». Déjà en 1919, c’est lui qui pressait Woodrow Wilson de reconnaître le nouveau régime soviétique, « pour éviter qu’un régime plus radical ne prenne le dessus ». Il ne précisait pas qui dans son esprit pouvait être plus radical que Lénine, Trotski et consorts.
Bullitt n’était pas communiste lui-même, mais il s’est marié à Louise Bryant, une journaliste communiste veuve du communiste John Reed. Comme on le sait, les restes de John Reed se trouvent au mur du Kremlin en reconnaissance de ses services pour le régime communiste naissant en Russie. Je ne veux pas dire que toutes les vues d’un mari viennent de sa femme, mais disons que dans le cas de William Bullitt et de Louise Bryant, on peut dire que qui se ressemble s’assemble.
Depuis son avant-poste de Paris, Bullitt s’est fait le plus virulent va-t-en-guerre contre l’Allemagne du camp Anglo-Américain. Peut-être son ascendance en partie juive (Hurwitz) l’a rendu aveugle aux vrais intérêts de l’Amérique. Il était assez intelligent même s’il manquait de jugement. Il aurait dû voir que le gagnant dans une guerre qui éliminait l’Allemagne en tant que puissance militaire ne pouvait être que la Russie. Mais il était sans doute impossible à un Fabien de toujours d’admettre qu’il s’était trompé du tout au tout sur la « nouvelle civilisation ».
Les « dossiers de Potocki » [correspondance de l’ambassadeur polonais en Amérique, le comte Jerzy Potocki, découverte et publiée par les Allemands suite à leur entrée à Varsovie, voir « La campagne de Roosevelt pour pousser à la guerre en Europe »] dont j’ai appris l’existence à Londres, reflétaient avec clarté et exactitude les vues de Bullitt et de Biddle : les intérêts anglais d’abord, les intérêts américains ensuite.
(Les présidents américains qui ont suivi ne semblent avoir rien retenu de la leçon de la Deuxième Guerre mondiale, avec un Ronald Reagan qui en 1982 a encore donné la priorité aux intérêts anglais en se rangeant à leurs côtés lors du conflit des Malouines, préférant sacrifier les bonnes relations que son propre pays pouvait entretenir avec l’Amérique Latine.)
Seul le recul historique permet de trancher et de voir qui avait raison. Depuis maintenant 45 ans [au moment où Kent s’exprime] que Roosevelt a conçu sa désastreuse politique belliciste, un observateur impartial de la scène internationale d’aujourd’hui peut l’évaluer concrètement du point de vue des intérêts spécifiquement américains. L’Amérique n’a rien tiré d’avoir « gagné » la Deuxième Guerre mondiale, en conséquence, on doit la considérer comme une perte sèche, un échec. La virulence même de la propagande sur le thème de la « croisade contre le mal » qui encore aujourd’hui sature les ondes et la presse témoigne de ce qu’il n’y a rien d’autre à dire s’agissant d’évaluer les effets de la guerre. La sécurité du continent ne s’en est pas trouvée mieux. Les avantages commerciaux ont été éphémères. Seuls les Juifs ont gagné quelque chose en tenant leur revanche sur l’Allemagne nazie et en permettant l’extension du communisme à 40% de la planète, sans parler de la migration en Palestine d’un grand nombre de Juifs d’Europe.
Il paraît incroyable que les hommes d’État occidentaux n’aient pas réussi à voir qu’une Allemagne écrasée signifierait l’émergence d’une puissance militaire soviétique majeure et hostile à nos intérêts. Mais c’est pourtant ce qui s’est passé. L’Amérique d’aujourd’hui est incapable de s’en tenir à la doctrine Monroe qui durant plus d’un siècle l’avait préservée des agressions européennes et des idéologies étrangères. Nous devons avaler la pilule amère du docteur Castro, le proconsul soviétique de l’hémisphère occidental et rester impuissant devant la prolifération des régimes communistes au Nicaragua et un peu partout en Amérique Centrale. Mon « crime » aura été de pressentir tout ça alors que j’étais un agent du chiffre à l’ambassade américaine à Londres et d’essayer de faire quelque chose pour l’empêcher.
Toutes les calomnies envers moi tournaient autour de l’accusation de « déloyauté ». Le communiqué de presse du département d’État du 2 septembre 1944 le martelait encore. Mais à qui et à quoi ma loyauté devait aller ? J’avais fait allégeance à l’ambassadeur Joseph P. Kennedy et au président Roosevelt, c’est vrai. Mais un agent du gouvernement prête serment « de servir la loi et la Constitution des États-Unis contre tous ses ennemis, qu’ils soient étrangers ou de l’intérieur » (c’est moi qui souligne). Les événements ont maintenant montré que par rapport aux dégâts infligés aux intérêts de notre pays, aucun ennemi étranger n’aurait pu faire mieux que Roosevelt. C’était le plus grand « ennemi de l’intérieur » et aucun subordonné ne lui devait une quelconque loyauté dans la poursuite de ses activités illégales. Aucune cour de justice n’a condamné Franklin Delano Roosevelt, mais celle de l’histoire s’en chargera un jour. C’est là toute la substance de l’affaire « Tyler Kent » et la raison d’être de mon comportement à Londres en 1939 et 1940.
Personne, à commencer par moi, n’irait prétendre que ce 20 mai 1940 devrait passer dans l’histoire au même titre que « le jour d’infamie » de Roosevelt. Mais cette date n’est pas sans présenter un certain intérêt pour tous ceux qui tiennent en haute estime la constitution et le droit international. C’était dans la matinée de ce jour, vers 10 heures si je me souviens bien, que le gouvernement des États-Unis a pris une mesure des plus spectaculaires en permettant aux agents de la police britannique d’arrêter et d’incarcérer un membre du personnel de l’ambassade américaine à Londres, détenteur d’un passeport diplomatique donc en principe bénéficiaire de « l’immunité » qui va avec. Inutile de préciser que l’arrestation et l’incarcération d’un diplomate présentent un caractère tout à fait exceptionnel même si en l’occurrence l’événement n’était pas entièrement dépourvu de précédent.
Ce jour de mai était aussi exceptionnel pour une autre raison. Dans une ville réputée pour bien des choses mais pas pour son climat, il se trouve que c’était une très belle journée. Mais il était dit que je n’en profiterais pas.
À 10 heures du matin, j’étais saisi par le fracas de la porte qu’on défonçait et des verrous qui tombaient tandis qu’une solide escouade de gaillards du Scotland Yard faisaient irruption dans mon appartement, accompagnés d’un officier des services secrets britanniques et d’un officiel de l’ambassade américaine. Mes visiteurs se seraient-ils annoncés d’une manière plus conforme aux usages en vigueur de la politesse, en frappant à la porte par exemple, que je n’aurais pas manqué de leur ouvrir. Mais manifestement, ils préféraient faire voler les portes en éclats. C’est nettement plus impressionnant et c’est précisément l’effet recherché par les policiers quand ils ont recours à ce genre de procédés. Si l’heureux bénéficiaire de ce traitement de faveur pouvait, en plus d’être paralysé de frayeurs, surpris en pyjamas, c’est d’autant mieux pour eux.
Mais pourquoi toute cette mise en scène ? Pourquoi – pourrait-on se demander – le gouvernement des États-Unis devait-il se rendre complice d’une violation aussi flagrante qu’exceptionnelle de toutes les conventions et usages régissant l’activité du personnel diplomatique ? Ça ne pouvait être qu’en raison de circonstances jugées particulièrement graves et sérieuses. Et pourquoi ces événements, quelque 40 ans plus tard, n’ont-ils toujours pas été mis au grand jour ? Pourquoi surtout ai-je moi-même attendu si longtemps avant de les rendre publics ?
 La réponse est qu’il y a un temps pour tout et qu’en novembre 1945, date à laquelle j’ai pu enfin rentrer en Amérique après une incarcération en Angleterre qui aura duré toute la guerre, ce n’était vraiment pas le moment. Le pays nageait alors en pleine euphorie au lendemain de sa « victoire » sur le lâche ennemi. Non seulement il aurait été vain de tenter de faire remarquer que la victoire qu’on venait d’obtenir était une victoire à la Pyrrhus, la plus coûteuse de toute l’histoire de l’Amérique, mais l’auteur de ce genre de remarque aurait eu toutes les chances d’être proprement lynché. En tout cas, au sens figuré, il y a bien eu un lynchage psychologique d’un certain nombre de personnes par des médias en mains étrangères déchaînés [« médias en mains étrangères » périphrase de Kent pour dire « médias juifs »]. Non, décidément, en 1945, ce n’était pas le moment. Grâce à des amis et à des proches, j’ai pu faire un voyage à travers le pays pour prendre le pouls de la population. Dans l’ensemble, je n’ai trouvé que des gens incapables ne serait-ce que de concevoir l’ombre de la plus petite critique de Franklin le Grand, de l’entrée en guerre de l’Amérique ou des procédés utilisés pour nous entraîner dans ce conflit.
La réponse est qu’il y a un temps pour tout et qu’en novembre 1945, date à laquelle j’ai pu enfin rentrer en Amérique après une incarcération en Angleterre qui aura duré toute la guerre, ce n’était vraiment pas le moment. Le pays nageait alors en pleine euphorie au lendemain de sa « victoire » sur le lâche ennemi. Non seulement il aurait été vain de tenter de faire remarquer que la victoire qu’on venait d’obtenir était une victoire à la Pyrrhus, la plus coûteuse de toute l’histoire de l’Amérique, mais l’auteur de ce genre de remarque aurait eu toutes les chances d’être proprement lynché. En tout cas, au sens figuré, il y a bien eu un lynchage psychologique d’un certain nombre de personnes par des médias en mains étrangères déchaînés [« médias en mains étrangères » périphrase de Kent pour dire « médias juifs »]. Non, décidément, en 1945, ce n’était pas le moment. Grâce à des amis et à des proches, j’ai pu faire un voyage à travers le pays pour prendre le pouls de la population. Dans l’ensemble, je n’ai trouvé que des gens incapables ne serait-ce que de concevoir l’ombre de la plus petite critique de Franklin le Grand, de l’entrée en guerre de l’Amérique ou des procédés utilisés pour nous entraîner dans ce conflit.
Depuis, les choses ont quelque peu changé. Il y a des faits que même par la plus virulente des propagandes des médias aux mains de qui on sait ne peut plus maintenir sous le boisseau. Désormais, les moins politisés de nos concitoyens commencent à se demander comment il se fait qu’après notre plus grande guerre et notre plus grand triomphe, nous devions aujourd’hui faire face à la plus grande menace pour notre sécurité nationale que nous n’ayons jamais connue. Il doit bien y avoir un responsable, après tout, Roosevelt lui-même ne disait-il pas que « les choses ne font pas qu’arriver, elles sont décidées ».
Alors qui a décidé et pourquoi ? Qui a décidé d’abandonner 40 pourcents du monde au communisme ? Qui a décidé d’établir une base communiste à seulement 90 miles de nos côtes ? Et si la réponse c’est que personne n’en a décidé, alors, la seule explication alternative, c’est que quelqu’un a commis la plus colossale erreur politique de notre histoire. Nous est-il permis aujourd’hui de jeter le blâme ? Certains diront que c’est remuer la boue et que c’est particulièrement mal venu en ces heures critiques que nous vivons.
Mais qui sont ceux qui ont un intérêt particulier à préserver le mythe de Roosevelt ? Pour commencer, il y a tout le parti démocrate. IL fut un temps, c’était Thomas Jefferson qui était invoqué par eux comme leur saint patron. Depuis les années trente, c’est Roosevelt qui a pris la place. Jeter le doute sur la clairvoyance de Roosevelt et sur son jugement, c’est, pour certains, comme douter de l’existence de Dieu. Et puis, il y a les vétérans et leurs gigantesques organisations. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils acceptent de gaité de cœur s’entendre dire qu’ils « se sont fait avoir », « menés en bateau » et qu’ils ont combattu dans une guerre désastreuse pour leur pays. Quant aux organisations juives en Amérique, elles ne juraient que par la destruction de l’Allemagne, sans égard pour les intérêts à long terme de l’Amérique auxquels pourtant elles étaient suspendues.
Partons du principe qu’il n’y a que deux raisons pour un État d’appeler son peuple sous les drapeaux contre un autre État : 1) la perspective d’un butin que ce soit sous la forme d’un territoire ou autres et 2) pour défendre la nation contre une menace extérieure. La théorie du butin n’est pas pertinente à l’ère moderne, d’autant que Roosevelt a à maintes reprises durant la guerre, démenti toute prétention territoriale. (Chose qu’il a laissée à son partenaire, Joseph Staline). Dans d’innombrables déclarations, Roosevelt a fait valoir que son pays avait été forcé de prendre part à la guerre, soit en tant que belligérant, soit en tant « qu’arsenal » des démocraties » chargé d’assurer leur approvisionnement en matériel de guerre (illégal au vu du droit national comme international) dans le but de « garantir la sécurité du pays et de son avenir ».
Son leitmotive, c ‘était que si la Grande-Bretagne était vaincue, toute sa gigantesque Royale Navy tomberait aux mains des Allemands. L’Allemagne serait alors en mesure d’envahir l’Amérique du Sud ce qu’elle ne manquerait pas de faire. Une carte a circulé montrant les régions qui seraient conquises par les nazis. La carte s’est plus tard révélée être un faux concocté par l’Intelligence Service des Anglais, faux que Roosevelt s’est fait un plaisir, en toute connaissance de cause, de diffuser pour effrayer les Américains. Tout cela est connu de source anglaise ; l’affaire est clairement mise en avant dans la biographie de William Stephenson, le principal agent britannique aux États-Unis dont la mission était précisément de provoquer l’entrée en guerre de l’Amérique. Petit à petit, nous en savons plus sur l’étroite coopération entre l’Angleterre et les États-Unis dans la période d’avant-guerre. Le but était soi-disant de préserver la sécurité des États-Unis et même si par la suite on a pu montrer que les agissements de Roosevelt étaient hors la loi, on a conservé cette justification : c’était dans l’intérêt supérieur de la nation.
Revenons à notre 20 mai 1940, ce jour du printemps londonien qui a vu l’irruption intempestive de l’escouade du Yard dans mon appartement. Ils étaient accompagnés d’un certain Franklin Gowen, deuxième secrétaire à l’ambassade américaine dont nous aurons à reparler. On me bombardait de questions sur qui je connaissais et sur ce que je faisais. Je restais évasif. Pendant qu’on m’interrogeait, d’autres agents s’intéressaient à une penderie dans laquelle ils ne tardèrent pas à découvrir une valise en cuir pleine de documents de l’ambassade américaine. On a dit qu’il y en avait 1500, je n’en sais rien, je ne les ai jamais comptés, seul leur contenu m’intéressait. On m’a alors embarqué dans une voiture de police, direction l’ambassade, où j’ai été présenté à l’ambassadeur, Joseph Kennedy, avec qui j’ai eu une conversation aussi brève qu’électrique. Je pouvais comprendre sa colère, mais de mon côté, je pensais avoir été confronté à un cas de conscience. Je voulais, avant qu’il ne soit trop tard, dévoiler l’affaire devant le comité America First et certains sénateurs non interventionnistes. Or il est clair que je n’avais aucune chance – en tant qu’inconnu sans aucune « porte d’entrée » dans le monde politique – d’être écouté à mon retour aux États-Unis par des politiciens pas tombés de la dernière pluie si je n’avais pas de documents prouvant mes accusations.
Je savais bien qu’emporter des copies de documents de l’ambassade était en principe un acte des plus répréhensibles. Mais je ne l’ai fait qu’à partir du moment où j’ai acquis la conviction sans aucun doute possible que Roosevelt et ses envoyés diplomatiques étaient en train de nous emberlificoter dans une guerre contre la volonté d’une majorité d’Américains dont l’opinion sur la question n’était pas un mystère, tous les sondages d’avant-guerre et durant la drôle de guerre concordants à ce sujet. Les interventionnistes gauchistes n’ignorent rien de ces sondages, ce qu’ils contestent bruyamment, c’est que Roosevelt ait délibérément cherché à contourner l’opinion publique. Mais moi, je sais ce qu’il en a réellement été, de mon point d’observation privilégié à l’ambassade, je voyais passer les dépêches vers le département d’État ainsi que celles en provenance et à destination d’autres ambassades un peu partout en Europe. De toute part on avait le même son de cloche : guerre et intervention. « Je hais la guerre » affirmait Roosevelt, mais il la planifiait. Le 3 septembre 1939, juste après le début de la guerre en Europe, Roosevelt déclarait sur les ondes « Nous cherchons à protéger nos foyers de la guerre en l’empêchant de se propager à l’Amérique… Cette nation restera neutre. »
Dans le même temps, William C. Bullitt, l’ambassadeur des États-Unis en France et l’un des principaux architectes et agent de la politique interventionniste de Roosevelt, exerçait une intense pression sur le Premier ministre Édouard Daladier et sur son ministre des affaires étrangères, Georges Bonnet, pour rejeter d’emblée une proposition de Mussolini de rencontre de la dernière chance entre les dirigeants européens pour conjurer le spectre de la guerre imminente. Bullitt – en plein accord avec Roosevelt – voulait que la guerre commence et le plus tôt serait le mieux. Il lui fallait absolument prévenir tout effort de paix qui aurait pu contrarier l’engrenage de la guerre. Bullitt s’y employait de toute sa force de persuasion. Il était en cela grandement aidé par Julius Lukasiewicz, l’ambassadeur de Pologne à Paris, dont le pays venait d’être attaqué et qui exigeait l’intervention de la France, et donc de la Grande-Bretagne. Bullitt et Lukasiewicz ont ensemble réussi à dissuader le gouvernement Daladier de ne pas donner suite à l’initiative de Mussolini et donc à faire en sorte qu’un conflit généralisé en Europe éclate comme prévu.
À ce stade, il est utile de rappeler que les dossiers Potocki que les Allemands ont découverts en Pologne au ministère des affaires étrangères et qui sont si révélateurs des activités interventionnistes de Bullitt, sont parfaitement authentiques. On retrouve leur substance dans certaines dépêches qui ont transité par l’ambassade à Londres et que j’ai pu lire tout simplement parce qu’elles étaient rédigées en anglais. Mais lorsque ces dossiers ont été découverts et publiés par les Allemands, ils ont été qualifiés par Roosevelt et le département d’État de faux grossiers. De nos jours, de nombreux historiens réputés, bien que minimisant leur importance, s’accordent à dire qu’ils sont authentiques. Mais cette importance s’apprécie bien mieux si on les croise avec d’autres documents liés à la politique étrangère américaine de cette époque. Notamment les transcriptions des conversations de Biddle, l’ambassadeur américain en Pologne avec le ministre polonais des affaires étrangères, le colonel Beek et le général Rydz-Smigly, chef de l’armée polonaise à l’été 1939. Ces conversations ont été dument rapportées au département d’État.
Il faut garder à l’esprit qu’avant que les Allemands ne fassent leur magistrale démonstration de blitzkrieg, tous les Alliés y compris les États-Unis envisageaient de mener une guerre d’attrition à l’abri derrière des retranchements comme en 1914. Les Polonais étaient censés tenir des semaines ou même des mois. C’est pour ça qu’on pouvait voir un Biddle assurer les autorités polonaises de ce que l’assistance militaire américaine ne tarderait plus une fois vaincues les réticences du Congrès. Mince réconfort pour les Polonais, mais ils étaient bien obligés de faire semblant d’y croire.
Peu après ces entretiens entre Biddle et les plus hautes autorités polonaise, Roosevelt a eu la suprême hypocrisie d’adresser une lettre au président polonais, Moscicki, s’offrant en médiateur du litige avec l’Allemagne. Imaginez la situation : d’un côté l’ambassadeur des États-Unis pressant les Polonais de se battre en faisant briller l’espoir d’une aide militaire, de l’autre, Roosevelt proposant de jouer au médiateur, une branche d’olivier à la main : faites votre choix.
On retrouve dans la plupart des tractations bellicistes dans lesquelles étaient engagés les agents diplomatiques de Roosevelt à la fin des années trente, en particulier en France et en Pologne, ces mêmes exhortations verbales et promesses non écrites d’aides de toutes sortes, y compris d’interventions militaires directes. Tout chef d’État en Europe – Angleterre en tête – avait parfaitement conscience que si les États-Unis se trouvaient suffisamment impliqués sur le plan politique et économique, l’intervention militaire suivrait inévitablement. Il n’y avait pas besoin d’écrits, et, en général, rien de ce qui a fuité ne peut trouver une confirmation papier. Au grand désespoir des historiens, on ne retrouvera rien dans les archives nationales à titre de preuve irréfutable. Bullitt en France et Biddle en Pologne n’ont pas commis l’imprudence de s’engager noir sur blanc sur une aide militaire quasi automatique en cas de guerre, mais tel était le fil général de leurs conversations privées. La transcription de ces conversations se trouve dans les dossiers Potocki, mais ce n’est pas la seule source. Il y a les notes et les mémoires des personnes en activité à l’époque, des mémorandums qui, même s’ils ont été ensuite détruits, sont passés par différentes ambassades et sont restés dans les souvenirs de ceux qui les ont vu.
De plus, toute l’activité diplomatique n’a pas forcément été officiellement et dûment numérotée, datée et envoyée au département d’État d’où il aurait été très difficile ensuite de les faire disparaître. Il y a aussi le fait qu’une grande partie de la diplomatie se joue dans les réceptions. Un ambassadeur en attire un autre derrière un palmier en pot, un verre de champagne dans une main et une cigarette dans l’autre, et les deux règlent le sort du monde dans le dos des politiciens et des citoyens qui les ont élus. De tels contacts et négociations ont pu être rapportés à la Maison-Blanche, par exemple dans le cas de l’ambassadeur Bullitt, au moyen d’une ligne téléphonique brouillée ou par des lettres privées qui n’ont jamais été portées aux archives du département d’État. Dans ces cas bien sûr, on ne trouvera rien aux archives nationales. Dans de telles circonstances, se demandera-t-on, comment ai-je pu en savoir autant sur les tractations et les conspirations. Eh bien, il se trouve que l’ambassade à Londres était une sorte de plaque tournante de l’activité diplomatique américaine sur la scène européenne et elle bourdonnait d’un flot continu de messages et mémorandums entre les divers services. Des bribes de conversations ont pu être saisies qui offraient un aperçu des positions et des agissements qu’on peut parfois trouver dans des mémoires personnelles, plus rarement dans des écrits officiels, mais qui n’en sont pas moins intéressantes et qu’il est légitime de considérer. De nombreux mémoires étaient diffusés de manière restreinte à l’attention de quelques agents du ministère des affaires étrangères avec instruction de les détruire après lecture.
Est-ce qu’on pouvait raisonnablement s’attendre à trouver un engagement écrit de Roosevelt à Chamberlain au sujet d’une aide militaire avant que ce dernier n’annonce en mars 1939 que l’Angleterre et la France viendraient au secours de la Pologne si elle était attaquée ? Un tel engagement a pourtant bien été donné par Roosevelt à l’ambassadeur britannique à Washington et il y a eu une confirmation téléphonique à l’ambassadeur Kennedy à Londres. Ensuite, il y a eu un mémorandum qui a été diffusé parmi les agents de haut en rang et est resté à leur niveau.
La correspondance qui s’en est suivie est très claire sur ce point : il n’y aurait jamais eu de garantie Franco-britannique à la Pologne, et donc pas eu de Deuxième Guerre mondiale sans l’engagement américain. Chamberlain et Daladier étaient parfaitement conscients des limites constitutionnelles qui encadraient l’action d’un président américain au sujet de l’emploi de la force armée, mais la force de conviction des ambassadeurs Biddle et Bullitt était telle que les gouvernements polonais et français ont fini par croire que Roosevelt pourrait faire ce qu’il voulait. Le côté britannique était traité directement à Washington par Roosevelt avec l’ambassadeur anglais.
Le recours exclusif aux archives est la principale faiblesse de la thèse défendue par les deux historiens qui ont écrit sur « l’affaire Kent ». Warren Kimball et Bruce Bartlett, dans le dernier numéro de 1981 de Diplomatic History ont rédigé un exposé qui se proposait de traiter des engagements de Roosevelt envers Churchill avant-guerre. Par « avant-guerre » il faut en l’occurrence entendre l’entrée dans la deuxième Guerre Mondiale des États-Unis et non le début effectif des hostilités en septembre 1939. Ces deux universitaires ont fouillé dans les archives nationales à la recherche des câbles échangés entre Roosevelt et Churchill – ceux du moins qui étaient déclassifiés – et ils sont parvenus à la conclusion qu’il n’y avait pas de quoi en faire tout un plat. Mais qui a cherché à en faire tout un plat ? Pas moi. C’est la première fois que je fais une déclaration publique sur le sujet. Je m’y résous maintenant parce que les sinistres conséquences des « erreurs de jugement » de Roosevelt (si tant est qu’il s’agisse d’erreur et non d’une politique délibérée) sont désormais si évidentes que même des crânes d’œuf comme Kimaball et Barlett ne peuvent plus passer à côté.
Trop longtemps, les universitaires sont restés hypnotisés par les messages entre Churchill et Roosevelt et ont ignoré tout le reste de la correspondance entre les États-Unis et les autres pays. Ils ont, de même, mis de côté les déclarations de personnalités éminentes familières des événements. Le journal de Forrestal a été publié il y a plusieurs années et les éditeurs, Walter Millis and E.S. Duffield, étaient libres de publier ou non tout ce qu’ils voulaient. Personne ne se serait rendu compte de quoi que ce soit s’ils avaient omis d’inclure la citation directe d’une remarque faite par Neville Chamberlain à Joseph Kennedy selon laquelle « l’Amérique et la communauté juive ont forcé l’entrée en guerre de la Grande-Bretagne ».
C’est bien entendu une citation parfaitement exacte – et juste – mais on ne la trouverait nulle part dans aucun télégramme ou une quelconque missive entre l’ambassade de Londres et Washington.
Cette remarque de Chamberlain doit sûrement se trouver quelque part dans la documentation privée de Joseph Kennedy et il est peu probable qu’elle voie le jour tant que les politiciens et les historiens resteront tétanisés par les menaces de la ligue juive contre la diffamation. De mon côté, je cite l’exemple pour montrer que l’histoire exacte ne se situe pas en totalité dans les dossiers gouvernementaux archivés. Soutenir qu’il en est ainsi revient à dire que les dirigeants ne mentent pas, du moins pas ceux des démocraties. Pourtant, le fait est que même eux mentent. Peut-être moins souvent et de façon moins cruelle que les bolcheviks, mais eux aussi le font quand cela les arrange. Qu’on pense seulement aux dossiers Potocki auxquels on a déjà fait allusion. La Maison-Blanche et le département d’État avaient déclaré que c’étaient des faux, aujourd’hui, les historiens reconnaissent leur authenticité.
Que savent Kimball et Barlett des plans d’invasion de la Norvège par les Britanniques et du fait qu’ils y étaient vivement encouragés par les États-Unis au motif qu’il fallait faire quelque chose pour entretenir le moral des troupes Alliées en garnisons dont l’oisiveté forcée risquait de se muer en insubordination voire en mutinerie ? La « drôle de guerre » durait depuis déjà six mois. Le plan anglais était de faire sortir la flotte allemande pour une confrontation. Churchill et d’autres pensaient que le meilleur moyen d’y parvenir était de se lancer ouvertement dans une compétition pour l’invasion de la Norvège. Churchill était le digne représentant de cette race de chefs de guerre qui sont toujours en train de rejouer la précédente guerre. Il avait la conviction fanatique que la flotte anglaise pouvait résoudre tous les problèmes, il fallait juste inciter l’Allemagne à livrer bataille. Là comme souvent, les événements vont lui donner tort.
Le plan élaboré de connivence entre l’Angleterre et les États-Unis consistait pour l’Angleterre à faire des préparatifs d’invasion de la Norvège facilement détectables. Les services diplomatiques américains devaient de leur côté propager la nouvelle à toute l’Europe de sorte que les Allemands ne pouvaient pas manquer d’avoir vent du projet. Et effectivement, ils ont mordu à l’hameçon et ont organisé leur propre expédition pour arriver en Norvège avant les Anglais. Il y a eu un engagement naval dans le Skagerrak, le bras de mer qui sépare le Danemark de la Norvège, quelques bateaux ont été envoyés par le fond, des petites unités, mais pas assez pour empêcher les troupes de débarquer dans le pays où elles ne rencontrèrent qu’une faible résistance.
Qu’on la définisse par le droit international ou par le droit américain, le rôle des États-Unis dans la petite combinaison britannique ne peut certainement pas passer pour de la neutralité. Mais Roosevelt avait déjà prévenu les Américains qu’ils n’étaient pas tenus d’être « neutres en pensée ». Alors peut-être que les services diplomatiques étaient autorisés à avoir un coup d’avance et à ne pas non plus être neutre dans les actes. À ma connaissance, aucune instruction écrite sur le sujet, je veux dire, pas d’instruction directe du département d’État. Et pourtant, j’en ai personnellement vu passer, de ces mémorandums envoyés de l’ambassade de Londres un peu partout en Europe aux diverses têtes de mission. Elles donnaient des instructions très spéciales en vue de faire connaître le plus largement possible, sans éveiller la méfiance, les plans anglais sur la Norvège. Certains des envoyés « pas dans la confidence » ont demandé des précisions sur ces instructions, parce qu’ils ne voyaient pas pourquoi il fallait rendre public des plans militaires en principe secrets. Je ne sais pas ce qu’on leur a répondu pour apaiser leur doute, mais ça a marché. Peut-être qu’on a fait usage du téléphone brouillé de la Maison-Blanche pour leur dire quoi faire.
 Nos deux professeurs balaieront certainement d’un revers de main ce petit épisode en disant « qu’il n’est pas documenté » puisqu’il ne se trouve nulle part aux archives nationales et qu’ils font une confiance aveugle aux dires du département d’État. Mais alors, pourquoi, au sujet de « l’affaire Kent », sont-ils allés au-delà du communiqué de presse du 2 septembre 1944 de ce même département d’État ? Ce communiqué aurait dû être pour eux le fin mot de l’histoire, mais ils ont surenchéri alors pourtant qu’il s’agit déjà d’un fameux pot-pourri d’insinuations, de calomnies et de mensonges. On aurait dit une commande de la ligue juive contre la diffamation [des Juifs, évidemment], peut-être d’ailleurs a-t-il été rédigé par un de leurs agents infiltré au département d’État. Par exemple, ce communiqué soutenait que j’avais attiré l’attention des Britanniques parce que je connaissais Anna Wolkoff, une réfugiée de la Russie bolchévique. D’après la police, cette femme avait un canal de communication avec l’Allemagne dont elle faisait usage. L’insinuation était transparente : j’étais censé avoir transmis des informations à l’Allemagne par l’intermédiaire de Wolkoff. Au moment où le département d’État se fendait de ce communiqué, il avait déjà en sa possession la copie de la transcription de mon procès qui s’était tenu en 1940. Dans cette transcription, le procureur déclarait que : « Kent n’était pas au courant de la transmission (d’un certain document) et que l’accusation ne soutenait pas qu’il avait agi de conserve avec la coaccusée, Anna Wolkoff ». Mais même en possession de ces informations, le département d’État laissait entendre que j’aurais eu des contacts avec l’Allemagne ainsi qu’avec de vagues « confédérés » qui cherchaient à communiquer avec l’Allemagne alors que l’Angleterre était en guerre contre elle. Mais les Britanniques ne m’ont poursuivi que pour avoir en ma possession « des documents qui auraient pu être utiles à l’ennemi », pas pour les avoir transmis sciemment à une puissance étrangère.
Nos deux professeurs balaieront certainement d’un revers de main ce petit épisode en disant « qu’il n’est pas documenté » puisqu’il ne se trouve nulle part aux archives nationales et qu’ils font une confiance aveugle aux dires du département d’État. Mais alors, pourquoi, au sujet de « l’affaire Kent », sont-ils allés au-delà du communiqué de presse du 2 septembre 1944 de ce même département d’État ? Ce communiqué aurait dû être pour eux le fin mot de l’histoire, mais ils ont surenchéri alors pourtant qu’il s’agit déjà d’un fameux pot-pourri d’insinuations, de calomnies et de mensonges. On aurait dit une commande de la ligue juive contre la diffamation [des Juifs, évidemment], peut-être d’ailleurs a-t-il été rédigé par un de leurs agents infiltré au département d’État. Par exemple, ce communiqué soutenait que j’avais attiré l’attention des Britanniques parce que je connaissais Anna Wolkoff, une réfugiée de la Russie bolchévique. D’après la police, cette femme avait un canal de communication avec l’Allemagne dont elle faisait usage. L’insinuation était transparente : j’étais censé avoir transmis des informations à l’Allemagne par l’intermédiaire de Wolkoff. Au moment où le département d’État se fendait de ce communiqué, il avait déjà en sa possession la copie de la transcription de mon procès qui s’était tenu en 1940. Dans cette transcription, le procureur déclarait que : « Kent n’était pas au courant de la transmission (d’un certain document) et que l’accusation ne soutenait pas qu’il avait agi de conserve avec la coaccusée, Anna Wolkoff ». Mais même en possession de ces informations, le département d’État laissait entendre que j’aurais eu des contacts avec l’Allemagne ainsi qu’avec de vagues « confédérés » qui cherchaient à communiquer avec l’Allemagne alors que l’Angleterre était en guerre contre elle. Mais les Britanniques ne m’ont poursuivi que pour avoir en ma possession « des documents qui auraient pu être utiles à l’ennemi », pas pour les avoir transmis sciemment à une puissance étrangère.
Ceci n’a bien sûr pas empêché la presse « libre » américaine de barrer leur une de gros titres à mon sujet comme « il a aidé les nazis ». À ce sujet, j’ai en ma possession la déposition sous serment d’un certain Nathan Perlmutter [le prénom trahit la communauté], daté du 6 novembre 1963 faite dans le cadre d’un procès en diffamation que j’avais intenté aux Miami Herald et au St. Petersburg (Floride) Times. Peremutter avait apporté aux deux journaux de la documentation que la ligue juive contre la diffamation avait à mon sujet, et on lui doit la parution d’un article diffamatoire à mon encontre dans le Miami Herald, article à l’origine des poursuites en diffamation. Soit dit en passant, Perlmutter a fait un si bon travail qu’il est à présent le directeur national de la liguer juive contre la diffamation qui a son quartier général à New York : au moment de mes démêlés avec lui, il n’était que chef de l’organisation pour la Floride.
Kimball et Bartlett dans leur article sur « l’affaire Kent » estiment qu’il n’y a rien à y trouver s’agissant du rôle de Roosevelt en tant que conspirateur contre la paix. Je leur répondrais que Roosevelt était probablement le plus impudent menteur à avoir jamais occupé la Maison-Blanche et qu’il est celui qui a causé le plus de dommages irréparables à cette nation. D’ailleurs il faut croire que ceux qui étaient aux prises avec l’affaire à l’époque, à savoir, entre autres, le renseignement militaire britannique et Scotland Yard, devaient avoir une opinion diamétralement opposée à celle de Kimball et Bartlett, sans quoi, il n’y aurait tout simplement jamais eu « d’affaire Kent ».
Le 8 juin 1940, deux semaines après mon arrestation, l’ambassadeur Kennedy informait le département d’État par câble de ce que :
Les autorités concernées m’ont informé de ce que l’enquête sur l’affaire dans laquelle Kent est impliqué est conduite avec la plus grande attention et a demandé beaucoup de travail. La décision de poursuivre ou non Kent devrait intervenir dans les dix jours au maximum.
Le 11 juin, les mêmes autorités britanniques informaient Kennedy de ce que :
les enquêteurs affirment que ces papiers révèlent l’existence d’une dangereuse conspiration d’une poignée de traîtres pour aider l’ennemi. Les personnes accusées sont Miss Wolkoff, Capt. Archibald Ramsay, parlementaire, sa femme, Madame Ramsay, Madame Christbel Nicholson (l’épouse d’un amiral) et Monsieur Tyler G. Kent. Tous sauf le dernier nommé sont des sujets anglais. Il est de la plus haute importance, pour ne pas dire indispensable qu’un représentant de l’ambassade des États-Unis soit présent pour assister au procès et apporter certaines preuves formelles.
Les mots lourds de significations qui suivent devraient être examinés avec attention par les deux professeurs avant de conclure que « l’affaire Kent » est un non-événement.
Comme c’est compréhensible, ni le département d’État, ni le ministère des affaires étrangères ne sont, à l’heure actuelle, disposés, à ce que les documents en question fassent l’objet d’une discussion publique. On pense toutefois que certains documents pourront être choisis parmi eux qui, tout en incriminant suffisamment les accusés, pourront être convenablement produits devant la cour.
Mais si Kimball et Barlett ont raison, pourquoi tout ce secret ? Pourquoi fallait-il l’approbation du Premier ministre, Winston Churchill, pour entamer les poursuites ? Comme le rapporte Kennedy au département d’État le 6 juin 1940 : « le procureur britannique fait savoir [à Kennedy] que la position des accusés est qu’ils ne peuvent être ni poursuivis ni condamnés puisqu’aucun des gouvernements concernés n’ose discuter du sujet en public.
Comment se fait-il qu’ils n’osaient pas en parler en public ? Tout le nœud de l’affaire est là. La vraie raison pour laquelle j’ai été jugé et condamné en Angleterre et pas aux États-Unis saute aux yeux à la lecture de cette déclaration faite par les autorités britanniques à Joseph Kennedy : « les documents en question seront produits à huis clos, non seulement la presse n’aura pas le droit de publier leur contenu, mais aucun journaliste ne sera présent ».
Et voilà, les Anglais, tout comme les bolchéviques avaient encore leurs procès secrets, une survivance du moyen Âge, une époque à laquelle un monarque absolu pouvait se débarrasser en douce de ses ennemis sans provoquer un tollé général puisque les faits seraient tenus cachés jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour qu’on puisse y changer quoi que ce soit. En 1776, les treize colonies se sont soulevées contre l’Angleterre, entre autres à cause de ce genre de juridiction d’exception. Néanmoins les États-Unis de 1940 étaient trop heureux de pouvoir s’en servir contre ses propres citoyens pour couvrir certains agissements.
En septembre 1944, en réponse à certaines questions adressées au secrétaire d’État au sujet de mon incarcération, mon affaire ayant éveillé un certain intérêt au congrès, le département d’État a fait paraître un communiqué assez long censé mettre un point final à l’affaire. Je citerai la partie qui traite des raisons pour lesquelles on m’a remis aux mains des Anglais pour un procès à huis clos puisqu’une telle procédure est interdite par le 6e amendement de la constitution. Le 6e amendement prévoit qu’un procès pénal doit être « rapide et public ». Mon procès n’était ni l’un ni l’autre. Voici ce que le département d’État avait à dire : « l’intérêt de la Grande-Bretagne était prééminent…et c’est la justice britannique qui disposait de toutes les preuves et témoins ». Les vraies raisons, je les ai déjà indiquées en citant les messages de l’ambassade au département d’État. Le halo de secret entourant mon affaire était si épais (dans l’intérêt prééminent de la Grande-Bretagne) que même lorsque le New York Times a demandé à voir les minutes dactylographiées du procès, il lui a été répondu par l’ambassade britannique à Washington en ces termes :
Le gouvernement britannique n’est pas en mesure de donner un consentement écrit à l’examen par le New York Times d’une copie de la transcription en notre possession ou en la possession de quiconque. Il lui faudrait une loi du parlement et même le ministère de l’intérieur ne pourrait lever la restriction.
Un tel voile de secret jeté sur l’incident par le gouvernement concerné au premier chef et dont « l’intérêt prédomine » (celui de la Grande-Bretagne) a tendance à la longue à jouer en sens inverse du but recherché parce qu’il pique la curiosité des historiens et les incite à rechercher ce qui s’est passé. L’affaire devait être particulièrement sérieuse pour qu’il faille l’autorisation du Premier ministre Winston Churchill pour démarrer un procès et pour que les transcriptions ne puissent être rendues publiques sans une loi du parlement.
À présent, je souhaiterais aborder le cas de Franklin Gowan, second secrétaire à l’ambassade des États-Unis à Londres. Je l’appelle « chevalier de la table ronde » parce que son dévouement aux Anglais était tel – au-dessus de ce qu’exige le devoir – que les Anglais se montreraient bien ingrats envers l’un de leurs meilleurs agents au département d’État s’ils ne lui accordaient pas – à minima – un titre de noblesse. Comme je le disais, il accompagnait la police le jour où elle a fait irruption dans mon appartement et qu’elle m’a arrêté. Il devait par la suite être appelé à témoigner contre moi lors du procès, ce qu’il a fait avec un enthousiasme et une joie non dissimulée. Le jour de mon arrestation, Gowan s’est chargé de prendre ma place et de répondre au téléphone pour les appels qui m’étaient destinés à l’ambassade. Il devait ensuite fournir les noms et adresses de ceux qui appelaient à la police britannique, plus précisément à Sir Norman Kendall, le chef de Scotland Yard. Sir Norman a confié à Kennedy que :
Dans un cas comme celui-là, on ne peut rien considérer de ce qu’on nous donne comme un dû. Savoir qui étaient les amis de Kent, et les amis de ses amis, où ils se rencontraient et ce qu’ils faisaient est de la plus haute importance. Nous ne pourrions assez remercier l’ambassadeur Kennedy pour son aide inestimable dans cette affaire.
Le même jour, Galahad-Gowan [ironie Galahad est un chevalier de légende] se lance dans ce qu’on peut classer parmi une des plus bizarres activités du service des affaires étrangères des États-Unis. Dans l’après-midi, il intercepte un appel téléphonique d’une certaine personne qui a demandé que je me rende au numéro X de Chesham. Street. Gowan a aussitôt recruté un agent de Scotland Yard et, tous deux se sont rendu à l’adresse donnée. Là, dans les ténèbres d’une panne de courant, un inconnu lui a remis une note qui demandait que Kent se rende à un certain restaurant pour y retrouver certaines personnes. Gowan a fait suivre la note à la police et puis, le même soir, est retourné Chesham Street « pour garder à l’œil la maison » et relever les plaques d’immatriculation de chaque voiture qui pourrait s’y arrêter.
Avant l’interception de la note, Gowan avait retiré son pardessus et l’avait prêté au policier pour couvrir son uniforme de façon à ne pas alerter l’interlocuteur. Nous assistons là au spectacle extraordinaire d’un agent de ministère américain des affaires étrangères travaillant avec la police britannique et lui fournissant même le déguisement pour piéger des sujets britanniques. Goawan avait depuis longtemps fait tout ce qu’il fallait pour permettre mon arrestation. Maintenant, il étendait ses recherches en vue d’éventuelles arrestations d’Anglais qu’il ne connaissait pas et avec qui il n’avait pas le moindre lien. Même si ce qui précède est d’un intérêt anecdotique, ça illustre bien l’étroitesse de la coopération entre les officiels américains et anglais dès avant que l’Amérique entre en guerre et à quel point ils étaient disposés à faire fi de la légalité dans ce genre de coopération. Je suis bien certain que nulle part dans un règlement du département d’État, ne figure une quelconque exigence de faire le sale boulot de la police d’un pays étranger visant des citoyens de ce pays.
Ça a dû être les plus grandes heures de Sir Galahad-Gowan. Cet insignifiant second secrétaire chauve et bedonnant en a profité jusqu’à la dernière goutte et, à n’en pas douter, a régalé ses petits-enfants en leur racontant comment lui, seul et à mains nues, avait démantelé un dangereux réseau d’espions à Londres durant la guerre. Ce soi-disant réseau auquel j’aurais appartenu était dirigé par le capitaine Archibald Ramsay, un membre du parlement. Ramsay a par la suite été décrit par le procureur général lui-même, Sir William Jowitt, comme un homme honorable qui ne ferait jamais rien de nature à nuire à son pays. Cela n’a pas empêché Ramsay de se retrouver incarcéré pendant un certain temps durant la guerre même si on n’avait rien pu retenir contre lui.
Ces faits sont de notoriété publique, pour autant, le New York Times ne s’est pas embarrassé de scrupules pour imprimer et diffuser des déclarations diffamatoires selon lesquelles j’aurais confié à Ramsay certaines informations vitales concernant la défense que Ramsay aurait alors emmenées à l’ambassade d’Allemagne à Dublin pour transmission à l’Allemagne. Ramsay a poursuivi le New York Times en diffamation, il lui était facile de prouver qu’il n’avait jamais quitté l’Angleterre durant la période incriminée, encore moins rendu visite à une ambassade allemande à Dublin ou ailleurs. Il a gagné le procès. Le New York Times et l’auteur de l’article, un certain Raymond Daniels [Daniels idem Nathan] ont été pris en flagrant délit de mensonge.
Le temps que l’affaire de Ramsay passe en jugement, on m’avait déjà mis à croupir dans une cellule de la prison quasi médiévale de Wandsworth à Londres. J’avais entamé une grève de la faim et me trouvais à ce moment-là à l’infirmerie. Un matin, je fus informé que des avocats voulaient me voir. Pensant qu’il s’agissait des miens, j’ai accepté de les voir. Il s’est avéré qu’ils représentaient le bureau londonien du New York Times et qu’ils voulaient mon aide pour défendre le journal contre Ramsay. Ils m’ont présenté l’article diffamatoire, et j’ai tout de suite vu que c’était un tissu de mensonges. Je les ai promptement invités à débarrasser le plancher – ce qu’ils ont fait.
Plus tard, j’ai appris que l’article avait été inspiré par le colonel William Donavan. Donavan est devenu chef de l’OSS (Office of Strategic Services) à l’instigation de Frank Knox, le secrétaire de la Navy. Knox est un de ces républicains qui ont tourné leur veste et sauté en marche dans le train de Roosevelt. J’étais bien entendu privé de mes droits civiques et ne pouvais pas moi-même poursuivre le New York Times, mais ce dernier s’est par la suite sagement abstenu de tout commentaire sur « l’affaire Kent ».
S’il y a bien une évidence qui ressort de toute la correspondance de l’ambassade, c’est la situation réellement désespérée des Anglais après le fiasco en Norvège et à la veille de l’énorme défaite de Dunkerque qui a vu l’entière armée britannique s’enfuir pour sauver sa peau en laissant sur place toutes ses armes aux mains de l’ennemi. Les Anglais savaient où ils en étaient et le faisaient savoir à Roosevelt. Ils savaient que sans une aide militaire directe de l’Amérique ils étaient perdus. Toute la rhétorique grandiloquente sur l’air du « donnez-nous les moyens et nous allons terminer le travail » était du pur bluff Churchillien et les Anglais le savaient. Mais ça fournissait à Roosevelt des munitions pour persuader le congrès d’adopter la loi « prêt-bail » faisant des États-Unis, en violation des lois internationales et de notre statut de pays neutre, « l’arsenal des démocraties ».
Winston Churchill est devenu Premier ministre après la Norvège. Ceci parce qu’il pouvait se vanter d’avoir le bras long en Amérique et qu’il se faisait fort de convaincre ces puissances occultes qui tiraient les ficelles en coulisses de faire entrer l’Amérique dans la guerre. La correspondance de l’ambassade ne laisse aucun doute sur la politique de l’Angleterre après Dunkerque : tenir bon jusqu’à ce que Roosevelt puisse faire entrer l’Amérique dans la guerre. Il a tout fait pour ça dans l’Atlantique Nord, mais Hitler a esquivé toutes les provocations et les Anglais ont dû, bon gré malgré, patienter que Roosevelt passe par la porte de derrière avec Pearl Harbor. À plusieurs occasions, on voit Churchill menacer Roosevelt en agitant le spectre d’une reddition anglaise, ou du moins d’un compromis avec l’Allemagne à moins que l’Amérique ne se porte immédiatement à son secours. Ces messages jurent avec l’image publique d’un Churchill en combinaison, le cigare vissé au coin de la bouche, proclamant que « Nous ne nous rendrons jamais. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons dans les rues » etc. Tout ça c’était pour soutenir le moral de la population et on doit reconnaître que Churchill était excellent dans son numéro d’acteur.
Les Anglais n’avaient pas oublié le rôle joué par le naufrage du Lusitania dans l’entrée des États-Unis dans la précédente guerre. Nous connaissons maintenant le fin mot de cette histoire de source anglaise. Un livre fouillé qui a pour titre The Lusitania publié en Angleterre il y a quelques années montre que le bateau avec ses passagers américains avait été délibérément livré à son sort par les autorités britanniques. Elles étaient au courant qu’il y avait un sous-marin Allemand qui traînait au large de la côte sud de l’Irlande dans l’attente des paquebots de ligne et elles ont volontairement omis d’en avertir le capitaine du Lusitania. L’épave du Lusitania git dans des eaux relativement peu profondes et des plongeurs ont pu l’examiner. Ses cales étaient bourrées d’armements expédiés en contrebande vers l’Angleterre et le pont était équipé d’armes défensives ce qui en faisait un bateau de guerre et une cible légitime pour le sous-marin. Sachant l’effet psychologique du naufrage du Lusitania sur l’opinion publique et à quel point la mort de passagers Américains avait été décisive pour emporter l’adhésion à l’entrée en guerre, les Anglais n’ont pas perdu de temps pour remettre en scène un incident similaire très tôt après le début de la Seconde Guerre Mondiale. C’était, le 4 septembre 1939, la guerre avait à peine commencé depuis 24 heures, le naufrage de l’Athenia. Il y a eu une trentaine de victimes américaines. Mais le sentiment antiguerre était tellement fort, que cette fois, ça n’a pas fonctionné. Les gens ont plus ou moins réagi en haussant les épaules et en disant que « si vous ne voulez pas d’ennuis, vous n’avez qu’à rester à l’écart de la zone de guerre ».
C’est alors que j’ai vu passer des messages très intrigants. Ils émanaient du bureau de l’attaché naval, le capitaine Kirk. Par des questions pressantes, le capitaine Kirk a pu obtenir des Anglais l’aveu que l’Athenia a pu être coulé par leur ordre. Non pas qu’il ait été coulé par une torpille d’un sous-marin anglais, mais que cela serait l’œuvre d’un des deux sous-marins polonais qui ont réussi à échapper aux Allemands et sont arrivés en Angleterre où ils se sont placés sous le commandement de l’amirauté. Il est vrai qu’un commandant d’U-Boat a été forcé sous la torture et l’intimidation de confesser à Nuremberg qu’il avait coulé l’Athenia. Confession aussi crédible que toutes les autres obtenues dans les mêmes circonstances.
Comme le lecteur peut maintenant s’en rendre compte, le secret entourant mon affaire est longtemps resté virtuellement impénétrable. Est-ce que les « documents Kent » était de nature militaire ? Est-ce qu’ils comportaient des informations sur les troupes ou l’armement ? La réponse nous est donnée en ces termes par le juge, Mr. justice Tucker : « Je prends en considération le fait que les documents en question ne contiennent rien de militaire ». Mais s’il n’y a rien de militaire, alors quoi ? Que du politique évidemment. Du politique tellement sensible que les Anglais ont dit à Kennedy qu’on ne pouvait pas discuter publiquement de ces documents.
Mais qu’est-ce qu’ils pouvaient contenir qui justifie mon procès et mon incarcération ? Les États-Unis n’étaient pas en guerre à ce moment-là. Les Américains étaient dans leur écrasante majorité en faveur de la neutralité. C’est bien ça qui était la grande contrariété de Roosevelt. Il aura été un anglophile enragé toute sa vie. Déjà en 1915 quand il était secrétaire assistant de la Navy, il exprimait dans ses correspondances toute sa crainte de commettre un acte non conforme à la neutralité. Le cadre restreint de ses prérogatives à l’époque l’obligeait à mettre un frein à ses sympathies qui allaient entièrement à l’Angleterre. C’est la clé pour comprendre l’action diplomatique des États-Unis dans l’immédiate avant-guerre. Ça, et une certaine maladie mentale qui est devenue endémique dans tout le monde anglophone : le « fabianisme ». Ses travers sont une totale incapacité à évaluer correctement la véritable nature du marxisme et des buts, objectifs et méthodes des pays marxistes, ce qui à l’époque voulait dire l’Union soviétique.
 La société Fabienne a été fondée en Angleterre en 1884, principalement par Sidney et Beatrice Webb et George Bernard Shaw. Il s’agissait d’un groupe d’intellectuels dont l’objectif déclaré était de corriger les méfaits de la société industrielle britannique comme le travail des enfants, les salaires de misère pour les femmes et les très mauvaises conditions de vie pour les travailleurs en général : rien que de parfaitement louable. Mais tous ces grands esprits ont perdu tout sens des réalités quand a éclaté la révolution russe en 1917. Ils se sont ridiculisés en érigeant en exemple à suivre par l’humanité entière un régime sanglant inspiré et dirigé par les Juifs. C’est typiquement la faillite des intellectuels partout et dans la plupart des domaines, mais particulièrement en socio-politique : se fier aux mots sur le papier et mépriser les conclusions de bon sens basées sur l’observation directe.
La société Fabienne a été fondée en Angleterre en 1884, principalement par Sidney et Beatrice Webb et George Bernard Shaw. Il s’agissait d’un groupe d’intellectuels dont l’objectif déclaré était de corriger les méfaits de la société industrielle britannique comme le travail des enfants, les salaires de misère pour les femmes et les très mauvaises conditions de vie pour les travailleurs en général : rien que de parfaitement louable. Mais tous ces grands esprits ont perdu tout sens des réalités quand a éclaté la révolution russe en 1917. Ils se sont ridiculisés en érigeant en exemple à suivre par l’humanité entière un régime sanglant inspiré et dirigé par les Juifs. C’est typiquement la faillite des intellectuels partout et dans la plupart des domaines, mais particulièrement en socio-politique : se fier aux mots sur le papier et mépriser les conclusions de bon sens basées sur l’observation directe.
Les Webb sont les auteurs d’un volumineux pavé, Soviet Russia: A New Civilization. Malgré tout le temps qu’il a fallu pour l’écrire, c’était le pire guide possible pour comprendre la Russie bolchévique. Les Webbs ont amassé des millions de mots tirés des rapports soviétiques officiels, du droit et de la constitution de 1936 (forcément « la plus démocratique du monde ») et ont présenté ça au public comme le reflet fidèle et définitif de la Russie moderne. Quiconque avait comme moi fait ne serait-ce qu’un court séjour au « paradis des travailleurs » savait parfaitement à quoi s’en tenir au sujet de ce droit et de cette constitution censée protéger les droits de l’homme. Cette nation était, et est, dirigée par une élite qui se tient tout autant au-dessus des lois que ses prédécesseurs du régime tsariste. Ils font ce qu’ils veulent sans le moindre égard pour ce que pourrait dire la loi. Et pourtant, même encore de nos jours où la vérité sur la Russie est largement connue à travers le monde grâce à Alexandre Soljenitsyne et d’autres, il y a encore des universitaires dans notre pays pour enseigner le marxisme aux jeunes esprits sans défense. Harvard est un foyer marxiste. Est-ce que Roosevelt est tombé sous le charme du fabianisme à Harvard ? Après tout, il a un jour dit au congressiste Martin Dies :
Il n’y a rien de mal à être communiste dans ce pays. Plusieurs de mes meilleurs amis sont communistes. Je ne considère pas les communistes comme une menace présente ou future. En fait, je vois la Russie comme notre plus solide allié pour les années à venir.
Il a dit la même chose au cardinal Spellman, comme on peut le voir dans la biographie du prélat. Ce fabianisme non édulcoré est la clé de compréhension de la mentalité de Roosevelt et explique ses errements en politique étrangère. Ça explique aussi son héritage que nous avons sur les bras.
Les Américains sont un peuple pragmatique, du moins c’est comme ça qu’ils aiment se définir. Ça signifie qu’ils préfèrent regarder le monde d’un œil pratique plutôt qu’à travers les lunettes colorées de l’idéologie. La plupart des lecteurs ont entendu parler du Council on Foreign Relations (CFR). C’est une espèce d’agence extra-gouvernementale, à demi secrète et qui a pour membre des personnalités majeures dans le domaine de l’enseignement, de la finance, de la communication de la politique etc. Son but est de formuler des politiques puis de les préconiser au gouvernement. À cette fin, il est en mesure de placer ses membres dans des postes élevés de l’administration et du gouvernement. Quelle meilleure source pour faire foi au sujet de la position de l’Amérique envers la guerre en Europe en 1939 que le CFR ? Et voici ce qu’il a à dire :
L’objectif stratégique de l’Allemagne dans cette guerre est la destruction de la puissance de la marine britannique. Pour maintenir la communication avec les dominions, pour assurer l’approvisionnement en nourriture et pour l’empêcher de devenir une puissance de troisième zone, l’Angleterre doit maintenir sa suprématie navale. Il n’y a pas d’alternative, pour le Commonwealth, c’est une question de vie ou de mort… Toutefois, et c’est un point important à retenir, en défendant ses propres intérêts, [la Royal Navy] défend en même temps ceux de l’Amérique.
L’existence de l’Allemagne nazie, avec sa puissance, son ambition et sa dynamique est le facteur déterminant de la politique étrangère des États-Unis. C’est contre elle qu’on doit déployer notre défense, contre elle que nous devons diriger notre diplomatie, contre elle que nous devons trouver des alliés. Et c’est contre l’éventualité de son succès sur le continent que nous devons faire l’unité aux États-Unis.
Ces mots ont été écrits en 1938 et 1939. On ne peut pas être plus clair. Ces déclarations de temps de paix ne sont pas le fait de journalistes à la petite semaine, elles proviennent du gouvernement derrière le gouvernement, de ceux qui planifient et (bien qu’en langage légèrement voilé) appellent à la guerre et la font éclater. Advienne que pourra, dit le CFR, une victoire allemande n’est pas tolérable. En premier lieu, la diplomatie doit être dirigée contre l’Allemagne et c’est ce qu’on a vu qui est arrivé. On comprend mieux alors l’action spectaculaire des autorités dans l’affaire Kent. Mais même encore aujourd’hui, après 43 ans, le voile de secret n’est pas encore totalement levé, il en va de la réputation de certains des protagonistes.
J’ai parlé jusqu’ici de l’héritage de Franklin Delano Roosevelt. En fait, il y en a plusieurs. Il y a l’héritage de la politique économique inflationniste Keynésienne – un autre grand sujet qui mérite une étude à part. Je me focalise ici sur l’héritage en politique étrangère et sur sa conduite, et dans ce domaine, je peux prétendre savoir un petit quelque chose.
L’Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939. La raison officielle était d’honorer la promesse faite à la Pologne. La vraie raison était de préserver un équilibre précaire des forces en Europe et la suprématie de la marine anglaise dans l’Atlantique. Cette marine, selon le CFR, protégeait aussi l’Amérique. Le CFR a affirmé publiquement en 1939 « qu’on ne pouvait en aucun cas permettre à l’Allemagne nazie de l’emporter en Europe. ». Et en conséquence, le CFR s’est assuré que l’Allemagne ne pourrait pas gagner. Roosevelt a conçu le programme de prêt-bail, Roosevelt et Churchill en ont discuté pendant des mois au travers de leur correspondance privée. Roosevelt insistant sur le fait qu’il avait besoin de temps pour lever les objections du congrès, Churchill que si rien n’était fait, la Grande-Bretagne n’allait pas tarder à être mise à genoux. Alors Roosevelt a fait transférer 50 destroyers à la marine anglaise. On ne sait toujours pas comment il s’en est sorti pour le faire mais il y a réussi. C’était l’acte qui faisait le plus ouvertement fi de la neutralité de toute la période d’avant-guerre. De ça aussi ils en avaient discuté lui et Churchill. Plusieurs subterfuges ont été imaginés par l’un ou l’autre mais tous ont dû être écartés comme impraticables. À chaque fois, la pierre d’achoppement c’était les lois sur la neutralité du congrès. À la fin, le congrès a cédé sur le prêt-bail, ce qui signifiait pour l’Amérique la perte des milliards de dollars. Mais pour les destroyers, le congrès n’a pas eu son mot à dire et l’État de droit a été jeté par la fenêtre.
Avant cela, le lent travail de la diplomatie s’est poursuivi pendant des mois, et même des années, pour monter une coalition au moyen de promesses d’aides qui ne sont jamais arrivées à temps pour présenter une quelconque utilité à ceux à qui elle avait été promise : Pologne, France et Angleterre.
Aucune responsable en Amérique ne s’était attendu à une défaite aussi rapide de la France et de l’Angleterre. Dunkerque a changé toute la donne. Les États-Unis avaient escompté une petite guerre d’attrition bien tranquille à base de tranchées et de blocus naval par la marine anglaise pour étouffer l’Allemagne. D’où le prêt-bail et les destroyers. C’étaient les outils avec lequel les Anglais allaient « finir le travail » d’après Churchill. Mais la défaite de l’armée anglaise à Dunkerque a réellement semé la panique dans les rangs anglo-américains. L’impensable s’était produit. L’Allemagne avait gagné la guerre en Europe – chose dont le CFR disait qu’il ne fallait pas que cela puisse arriver un jour.
Mon arrestation est intervenue dans la foulée de la débâcle. Je suis resté en présent jusqu’en novembre 1945. On donnait l’impression que moi et mes amis étions plus ou moins responsables de l’effondrement. Avec le recul, il me semble que la spectaculaire action montée contre moi, le capitaine Ramsay et quelques autres, tenait plus de la propagande qu’autre chose. Les Britanniques venaient de subir la pire défaite de leur histoire, et leurs troupes repassaient la Manche en catastrophe sans même un fusil. Dans ces circonstances, il est bien venu pour le moral sur le front intérieur d’attribuer la défaite aux agissements d’une cinquième colonne. Pour les Anglais, cette cinquième colonne, c’étaient Ramsay, moi et les autres. Les flegmatiques britanniques peuvent parfois se montrer fébriles, et en l’occurrence, ils avaient quelques raisons. Plus tard, comme l’hystérie retombait, le capitaine Ramsay a été libéré, mais pas moi qui suis resté en captivité jusqu’au bout. Le procureur général qui poursuivait Ramsay disait, comme on l’a vu, que Ramsay était un sujet honorable qui n’aurait jamais volontairement causé du tort à sa patrie. Comme le capitaine Ramsay était mon principal contact à Londres en 1940, un observateur impartial aurait pu raisonnablement supposer que mes motifs étaient eux aussi honorables.
On m’a parfois posé la question, légitime, de savoir pourquoi, si mon but était de tenir les États-Unis en dehors de la guerre, j’avais montré les documents à des sujets britanniques ? La réponse est simple et sans détour. Ramsay et les membres de son Right Club savaient tous que les principaux va-t-en-guerre en Angleterre étaient Churchill, Eden, Duff Coopet et Vansittart. Et notre but commun à nous petits amateurs, était de miner la position de Churchill au parlement en faisant usage de certains des documents américains en ma possession. On comptait en cela sur le capitaine Ramsay qui, après tout, était quand même un membre du parlement. Nous savions tous que les démocraties occidentales ne seraient pas les vrais gagnants de cette guerre, que le vrai gagnant serait la Russie bolchévique. Il n’y aurait plus d’Empire britannique et l’Angleterre sombrerait au niveau d’une puissance de troisième classe, ce qui s’est produit.
Je sentais aussi que la menace pour la sécurité des États-Unis serait multipliée par cent. Curieusement, notre grand chef, Roosevelt ne l’avait pas compris. Le petit employé de l’ambassade si. Comme Cassandra, il a prophétisé dans le vide. Les Américains sont censés préférer les faits aux théories, voici des faits bruts. En 1939 le budget américain de la défense se montait environ à un milliard de dollars. En 1983 il se montait à 221 milliards de dollars. Même si on divise ce chiffre par deux pour tenir compte de l’inflation, on constate que nos dépenses militaires ont été multipliées par cent. Comme on peut supposer que les États-Unis n’ont aucune intention de se lancer dans une guerre majeure contre une quelconque puissance, ces 221 milliards de dollars sont pour nous protéger d’une attaque du seul ennemi potentiel, la Russie soviétique. En cherchant la destruction totale de l’Allemagne et sa reddition inconditionnelle, Roosevelt a fait de la Russie une puissance mondiale sans rivale sur la vaste plaque centrale eurasiatique.
Mais il a dit qu’il ne voyait rien de mal dans les communistes ou dans le communisme et que la Russie était notre allié naturel. Était-ce réfléchi ou était-ce une colossale erreur de jugement ? Pour le commun des mortels, le locataire de la Maison-Blanche ne doit pas faire d’erreur à cette échelle, il ne peut pas engager à la légère la sécurité de la nation. Il ne peut pas, lui le président, plaider l’ignorance alors que le flot d’informations sur la situation mondiale se déverse dans son bureau 24 heures sur 24, il ne peut pas dire que personne ne lui avait dit.
Pourquoi alors mes amis et moi savions au milieu de la tourmente en 1940 ? L’histoire nous le dira. […]
Tyler Kent
Traduction : Francis Goumain
Source : Texte de la conférence donnée par Tyler Kent à la quatrième conférence de l’IHR (Chicago) en septembre 1982 et publié dans The Journal of Historical Review à l’été 1983 (Vol. 4 N° 2, page 173 -203)
Le début de l’introduction et la fin de la conclusion n’ont pas été reproduits, mais on peut retrouver l’intégralité du texte ici : http://www.ihr.org/jhr/v04/v04p173_Kent.html
Pour completer la lecture
Ray Bearse and Anthony Read, Conspirator: The Untold Story of Tyler Kent. New York: Doubleday, 1991.
Patrick J. Buchanan, Churchill, Hitler and ‘The Unnecessary War’: How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World . New York: Crown, 2008.
Bryan Clough. State Secrets: The Kent-Wolkoff Affair. East Sussex: Hideaway Publications Ltd., 2005.
John Costello, Ten Days to Destiny The Secret Story of the Hess Peace Initiative and British Efforts to Strike a Deal with Hitler. New York: William Morrow, 1991.
Adam Curtis, “Wicked Leaks,” BBC, Dec. 2010.
( http://www.bbc.co.uk/blogs/adamcurtis/2010/12/wicked_leaks.html )
Thomas Fleming, The New Dealers’ War: Franklin Roosevelt and the War Within World War II. New York: Basic Books, 2001.
Germany, Auswärtiges Amt [German Foreign Office]. Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. Erste Folge Berlin: 1940.
Germany, Auswärtiges Amt. Roosevelts Weg in den Krieg: Geheimdokumente zur Kriegspolitik des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Berlin: 1943.
Robert Harris, “The American tearoom spy.” The Times (London), Dec. 4, 1982, p. 6.
Robert Harris. Report on Tyler Kent. BBC Newsnight, 1982.
( http://www.bbc.co.uk/programmes/p00ctr04 )
Adolf Hitler. Reichstag speech of Dec. 11, 1941 (Hitler’s Declaration of War Against the USA.)
( http://www.ihr.org/jhr/v08/v08p389_Hitler.html )
Warren F. Kimball, “Churchill and Roosevelt: The Personal Equation. » Prologue,Vol. 6 (Fall 1974), pp. 169-82.
Warren F. Kimball, and Bruce Bartlett, « Roosevelt and Prewar Commitments to Churchill: The Tyler Kent Affair,” Diplomatic History, Fall 1981 (Vol. 5, No. 4), pp. 291-311.
Jospeh P. Lash. Roosevelt and Churchill 1939-1941. New York: Norton, 1976.
James Leutze, “The Secret of the Churchill-Roosevelt Correspondence: September 1939-May 1940. » Journal of Contemporary History, July 1975 (Vol. 10, No. 3), pp. 465-491.
Francis L. Loewenheim, Harold D. Langley, and Manfred Jonas (eds.). Roosevelt and Churchill: Their Secret Wartime Correspondence. London: Barrie & Jenkins, 1975.
Saman Mohammadi, “Tyler Kent Vs. The Gods of History,” July 18, 2012.
( http://disquietreservations.blogspot.co.uk/2012/07/tyler-kent-vs-gods-of-history.html )
Peter Rand, Conspiracy of One: Tyler Kent’s Secret Plot Against FDR, Churchill, and the Allied War Effort. Guilford, Conn.: Lyons Press , 2013.
John Howland Snow. The Case of Tyler Kent. New York: 1946; New Canaan, Conn.: 1962
Mark Weber, « President Roosevelt’s Campaign to Incite War in Europe: The Secret Polish Documents, » The Journal of Historical Review, Summer 1983 (Vol. 4, No. 2), pp. 135-172.
( http://www.ihr.org/jhr/v04/v04p135_Weber.html )
Mark Weber, « Roosevelt’s ‘Secret Map’ Speech, » The Journal of Historical Review, Spring 1985 (Vol. 6, No. 1), pp. 125-127.
( http://www.ihr.org/jhr/v06/v06p125_Weber.html )
Richard Whalen, “The Strange Case of Tyler Kent. » Diplomat, Nov. 1965, pp. 16-19, 62-64.





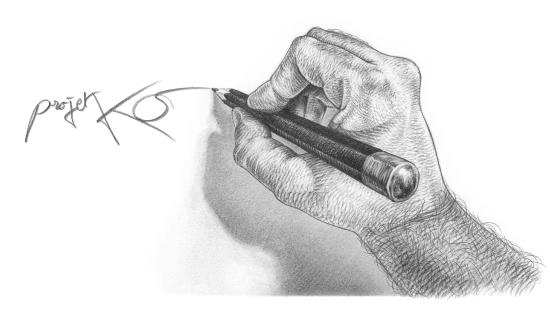


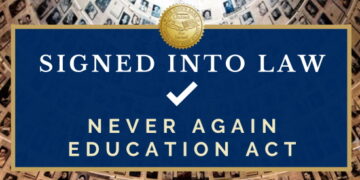














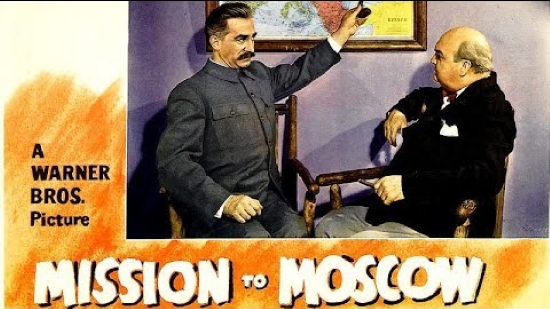



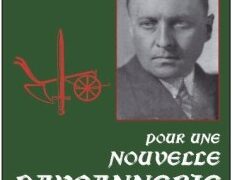


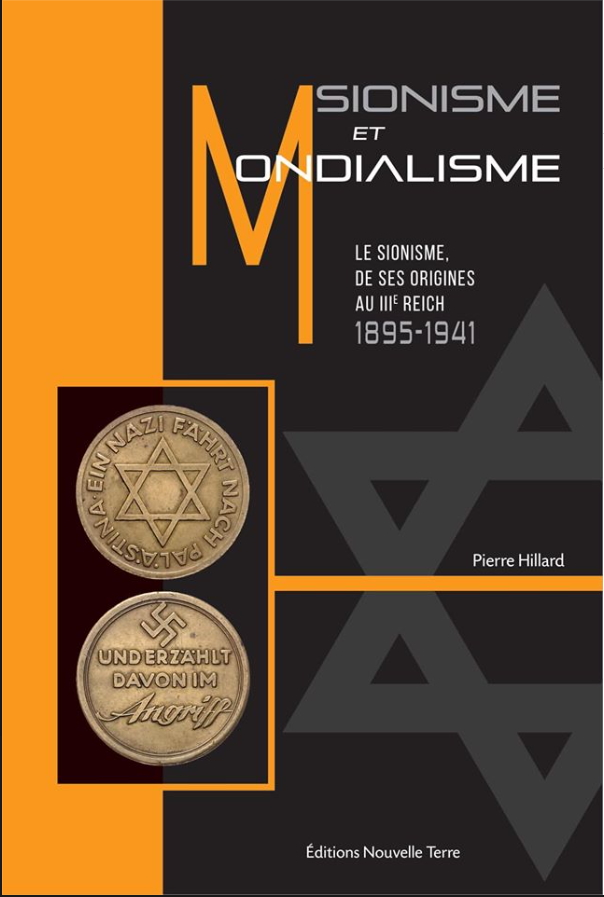
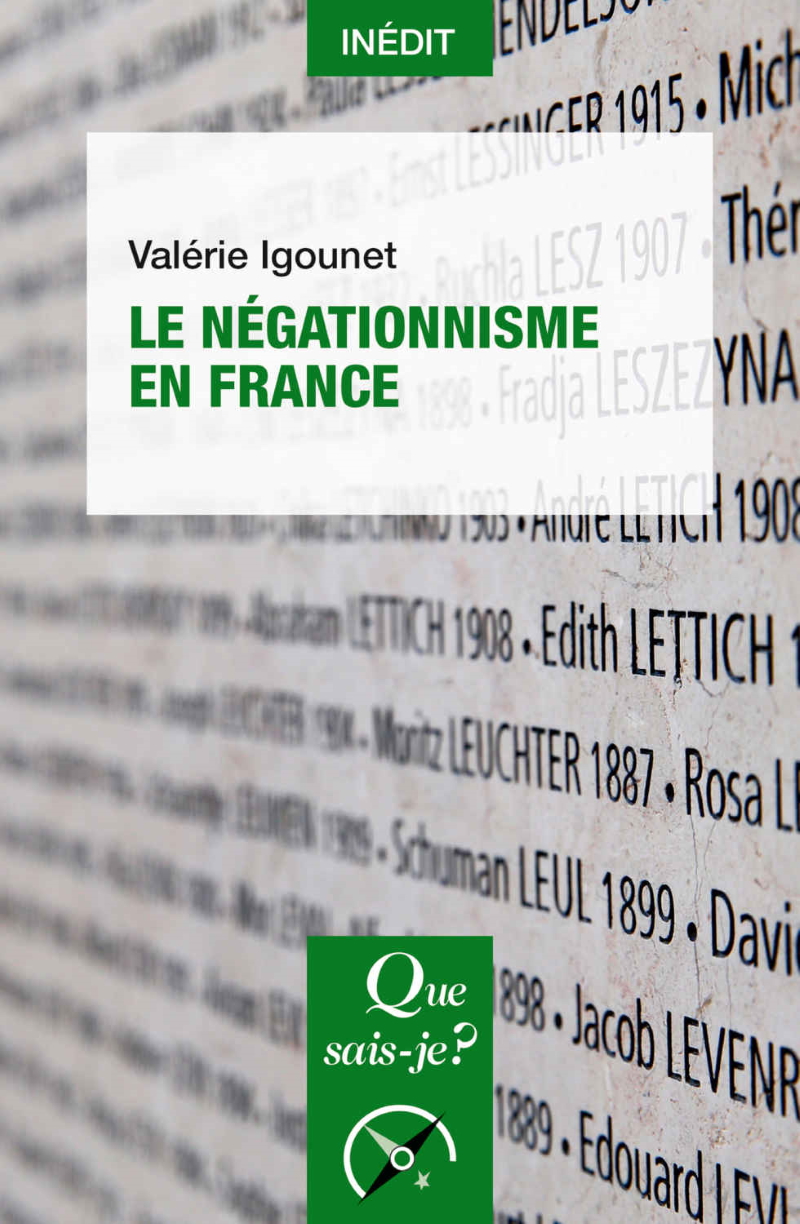



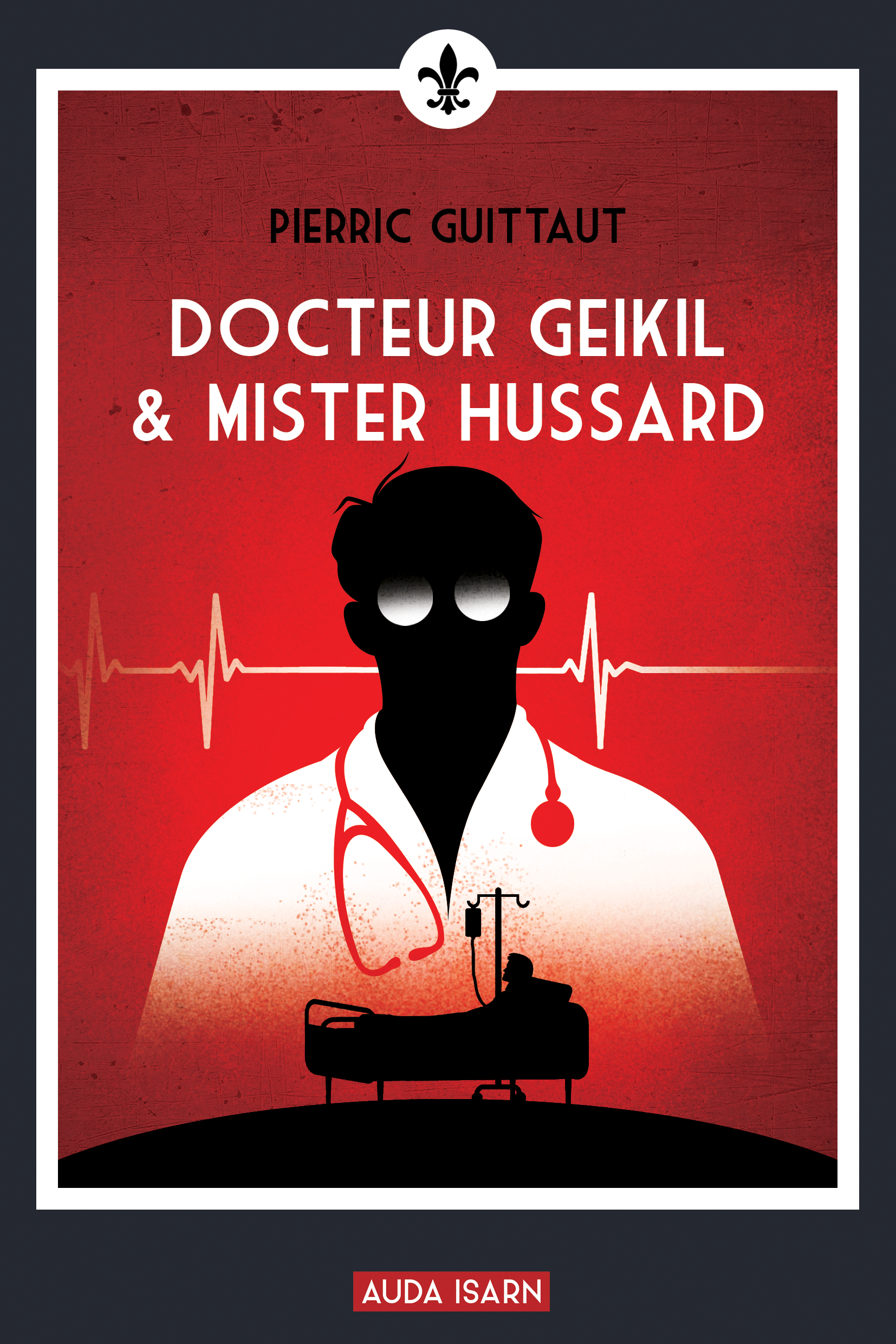









 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV








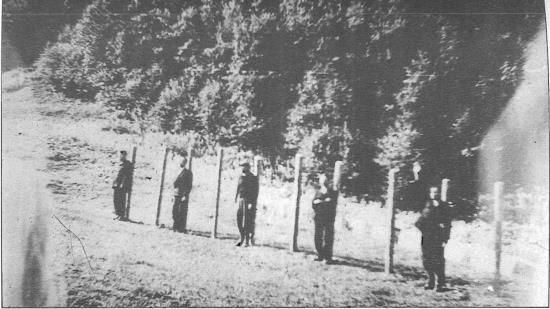
Commentaires 1