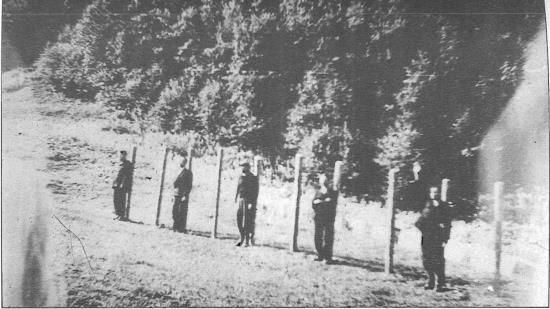Hommage à Pierre Laval à Paris
Des militants nationalistes se sont réunis le 17 octobre 2015 au cimetière de Montparnasse à Paris, pour rendre hommage à Pierre Laval. Une forte délégation normande avait fait le déplacement pour honorer l’ancien président du conseil du maréchal Pétain. Voici ci-dessous le discours prononcé sur sa tombe.
Président,
Soixante-dix ans ont passé depuis votre exécution. L’enseignement des calomnies ne pouvant perdurer en face des faits, nos gouvernateurs y firent succéder la damnatio memoriae ; ce faux silence établi sur la mémoire, loin du respect dû aux défunts, qui donnent des leçons sur la conduite à tenir, mauvais film de basse propagande diffusé sans arrêt, où vous apparaissez de temps à autre comme un mauvais génie, une âme damnée, une tache sur l’honneur de ce qu’ils appellent “ce pays” quand vous avez toujours dit mon pays. Oui, vous restez la bête noire et le bouc émissaire des traîtres et l’opinion imbécile qu’ils dirigent où ils veulent s’acharne à vous condamner sans vous entendre.
Pourtant vos paroles ne se sont pas envolées, le temps qui passe n’a pas roulé toutes les consciences comme l’air du temps roule, sous le ciel d’automne, les feuilles mortes à travers ce petit carré de Montparnasse. Malgré votre humilité, malgré votre méfiance instinctive pour les leçons d’histoire, souffrez alors qu’enfin vous soit rendu l’hommage des patriotes reconnaissants.
Vous voyez le jour à Châteldon, au sein du prolétariat. Vous n’oublierez point votre pauvre, mais belle jeunesse, ni le terroir auquel vous resterez par toutes vos fibres attachées : étudiant, jamais boursier, vous arriverez au barreau pour être l’avocat des pauvres. Vous épouserez la fille du maire de votre village et, devenu châtelain, propriétaire terrien, directeur d’usine, patron de presse, homme d’État, vous resterez cet homme enraciné, d’extraction populaire, les pieds dans la glèbe.
Vous n’avez pas eu à lire Barrès qui enseigna le retour à ce que, enraciné, habitant votre terre, habité par vos morts, vous ne quittâtes jamais. Ayant à l’esprit ces réalités, qui demeurent, au cœur le sentiment des intérêts communs de l’humanité, vous avez donc épousé à vingt ans la cause du socialisme dont vous serez à trente ans le plus jeune député, choisi par les syndicats : détaché de la religion, vous ne cherchiez en politique pas plus les dogmes que les démonstrations scientifiques, mais le règlement des problèmes de la Cité. De Kienthal à Stockholm, vous faites campagne pour mettre un terme à la guerre civile européenne, moment où la critique matérialiste la plus fine rejoignit la plus haute exigence spirituelle puisque la papauté militait aussi en faveur d’une paix sans annexions ni indemnités.
Votre fortune garantit votre indépendance ; aussi, chez vous, nul amour de l’argent, mais de la liberté que, bien employé, il peut procurer à l’honnête homme. Les bourgeois y virent clair, ne vous considérant jamais comme l’un des leurs. Militant fidèle, vous n’avez pas voulu consacrer la division quand il s’est agi de choisir entre la théorie sans volonté et l’action aveugle dirigée de l’étranger. La solitude ne vous a pas rendu opportuniste mais pratique et en fin de compte efficace.
Vous êtes resté du Peuple, « représentant de cette catégorie de Français qui sont à la fois paysans et ouvriers », toujours proche des laboureurs d’Auvergne comme des métallurgistes d’Aubervilliers, fraternel et populiste. Vous avez en partie aboli l’ancien régime social issu de Thermidor en construisant et en faisant voter la loi du 30 avril 1930 : au jour de votre mort, le responsable de l’assassinat fit rebaptiser, par une ordonnance, cette loi en Sécurité sociale, afin de présenter celle-ci comme une conquête de la prétendue libération. La Nation, par notre voix, devait enfin exprimer sa reconnaissance au père des assurances sociales et des allocations familiales.
Premier ministre reçu par le Pape depuis la fondation du régime, la Providence vous désigne pour restaurer la confiance entre la France et l’Église après la loi de Séparation et les menaces d’abolition du Concordat en Alsace-Moselle, vous le disciple de Briand, le fils prodigue dont la conduite privée et publique fut toujours en conformité avec la loi naturelle : époux vertueux, père aimant, ami fidèle et dirigeant incorruptible.
Assainissant nos finances, vous préservez les économies des plus modestes ; renforçant nos alliances, vous cherchez à conjurer le spectre d’un nouveau conflit, mais le bloc anglo-saxon s’opposant malgré vos mises en garde à la création d’une force défensive internationale, vous refusez de désarmer la France. Vous saviez que depuis 1914 la guerre de principes ne fait que des vaincus et que la barbarie technique, en constant progrès, ne peut y ajouter que plus de cadavres. Vous aviez rappelé aux professeurs d’histoire qui préparaient le massacre : « On a détruit l’empire austro-hongrois. Les protestants (…) n’ont pas voulu que subsiste cet empire catholique au centre de l’Europe et les forces mauvaises se sont liées pour la destruction d’un ensemble de pays qui, au regard de l’Allemagne et même après la victoire des Alliés, constituait un contrepoids ».
Le mal est fait. Comme la Grande Révolution s’est accomplie dans la guerre qu’elle ne voulait pas, vous initiez dans l’armistice, syndic de la défaite des autres, la Révolution nationale.
Le complot du 13 décembre fait retomber l’État dans une instabilité digne des errances du passé, mais vous revenez au pouvoir pour assurer l’ordre nouveau que vous avez institué, en avril 1942, avec le titre de Chef du gouvernement. Dans des circonstances encore plus difficiles, c’est la même tache que vous reprenez :
pour l’intérieur, vous chassez du pouvoir les agents de la banque Worms, autrement dit la Synarchie et entamez la restauration que Charles Péguy appelait la “République une & indivisible, notre royaume de France” ; non la démocratie d’État qui fait voter le nombre sans rien décider, mais l’autorité au centre, la souveraineté des habitants dans leurs communes, des artisans dans leurs corporations, des citoyens dans leurs provinces et des sujets dans leur Patrie. Socialisme en haut, libéralisme en bas : telle fut votre doctrine, exact contraire du désordre affairiste de gauche ou de droite laissant tout faire au capital, ne laissant rien passer au travail qu’il impose. Grâce à vous, nos trois couleurs seront arborées, place Beauvau et à l’Hôtel Matignon, jusqu’à la fin de l’occupation : à leur ombre, vous serez le premier résistant de France, luttant pied à pied contre les exigences de l’occupant ; non pas bien sûr pour contrarier l’effort de guerre germanique, mais pour soulager une France meurtrie afin que celle-ci, revenue à elle-même, puisse s’inscrire, en pleine possession de ses ressources, dans la mission de défense continentale. Protéger la population, assurer le retour de nos prisonniers, garantir l’intendance qui ne suivait point, continuer l’État, soutenir la Nation, servir la Patrie ; mission harassante à laquelle, investi de la dictature après l’invasion de la zone libre, fondant la Milice pour donner une chevalerie à Marianne, vous vous êtes voué sans espoir de gratitude, mais avec un succès incontestable.
Pour l’extérieur, vous apportez le soutien moral et matériel de notre pays à l’Europe en guerre avec le libéral-capitalisme d’un côté, de l’autre le soviéto-bolchevisme ; les courtiers de la City, les agents de Wall-Steet et les gardiens du Goulag se trouvant main dans la main pour liquider la civilisation. Soixante-dix ans après leur victoire, il suffit de comparer le bilan calamiteux dont ils s’honorent avec votre œuvre immense, Président, pour mesurer tout ce que nous avons perdu.
Ils ont choisi de ne pas voir les biens, les vies, le patrimoine, le corps de la France entière sauvés par vous malgré leurs bombardements et leurs débarquements inutiles. En refusant à vos avocats les pièces de l’accusation, ils ont inauguré la jurisprudence illégale sous la tyrannie de laquelle gémit le monde. Votre procès fut jugé sans être plaidé ; car il ne s’agissait que de vous faire tomber sous les balles du mensonge.
On vous empêche de mourir en Romain : vous mourrez en chrétien, Pierre-Jean-Marie Laval et ainsi, dans l’ignominie de l’assassinat, debout, pardonnant aux malheureux soldats français honteusement recouverts de l’uniforme étranger chargés d’exécuter ce crime politique, conserverez le panache de ce que vous avez toujours été : à la fois un homme ancien qui sauvegarde, grand seigneur féodal et, en tant qu’héritier du faisceau, de la francisque révolutionnaires, un homme de l’avenir qui édifie, celui sans la réhabilitation duquel nous ne pourrons retrouver les chemins du Bien commun qui passent par la Vérité.





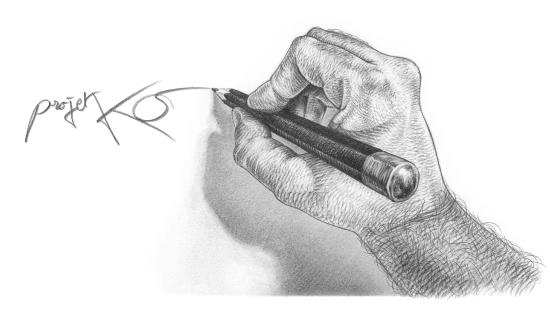


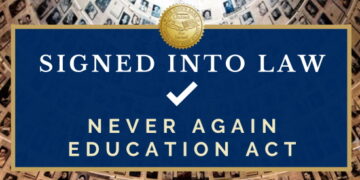














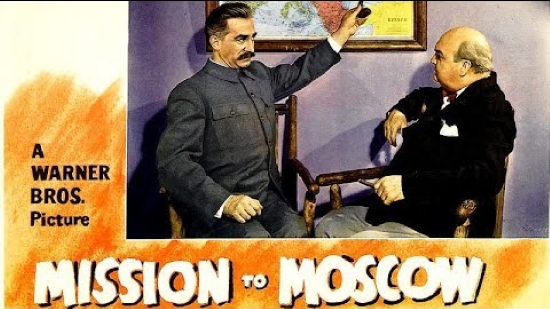



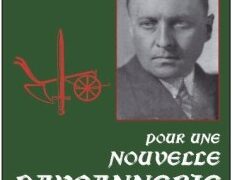


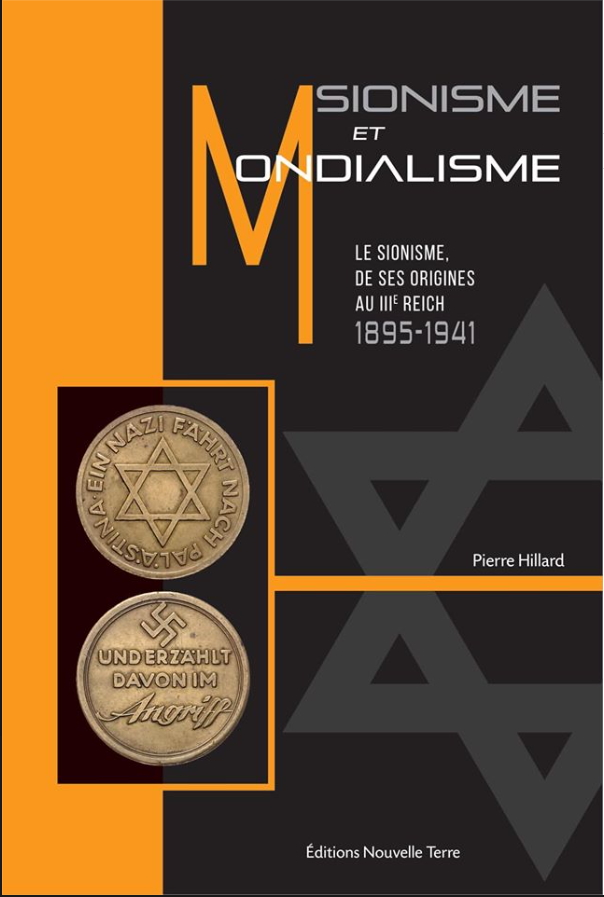
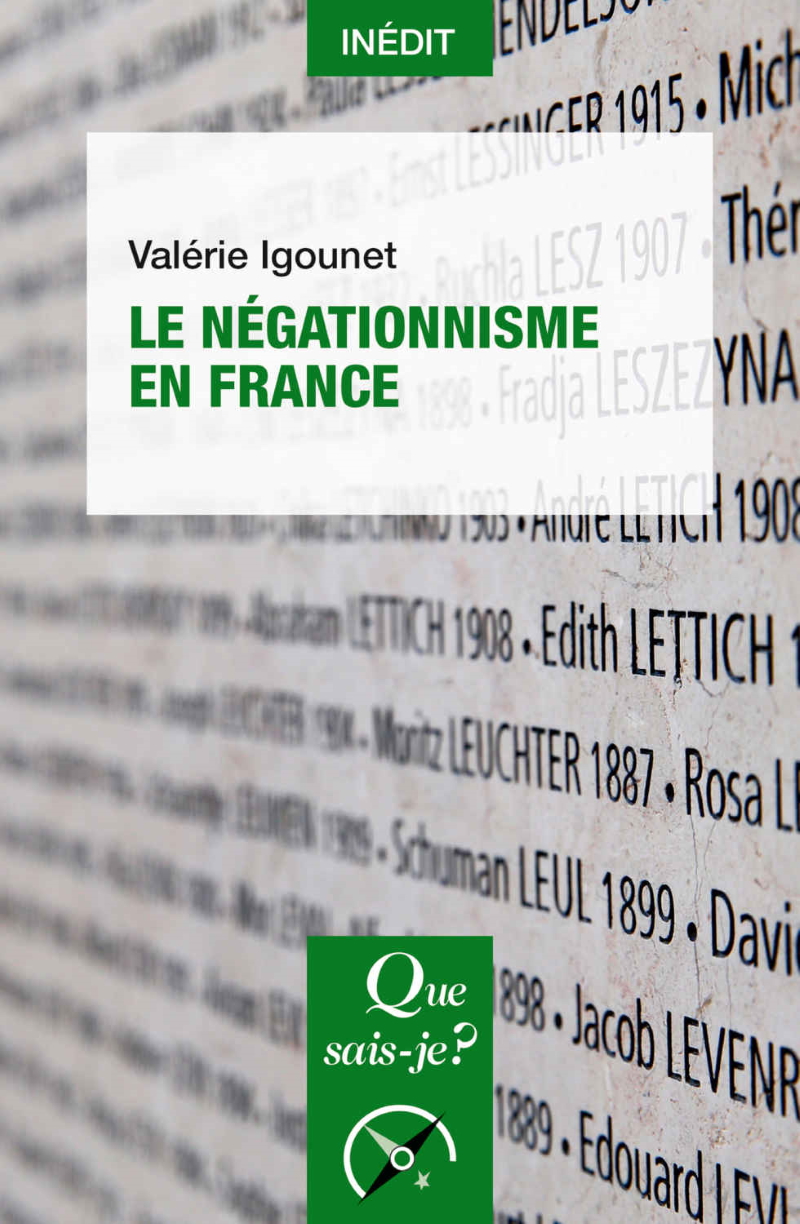



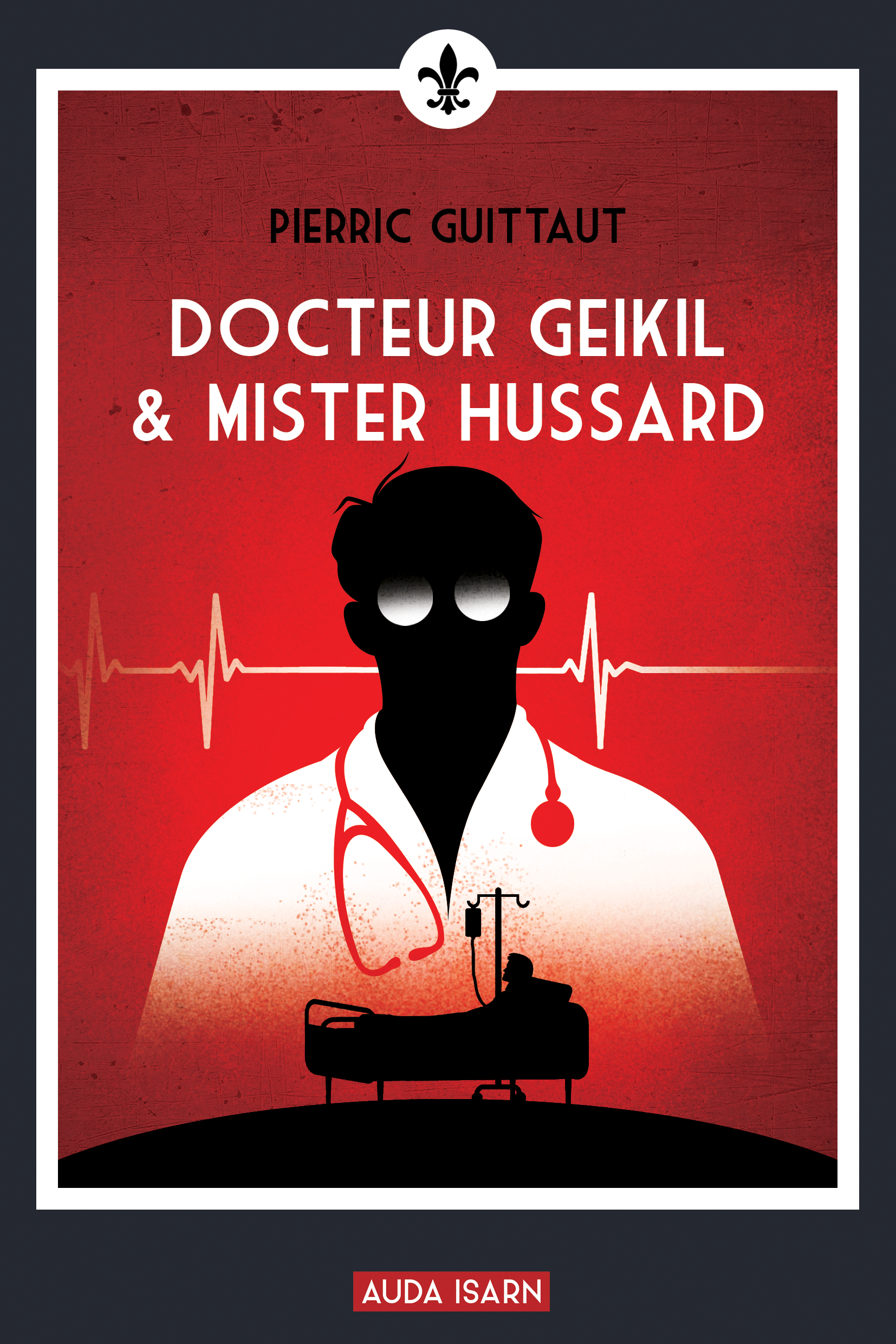









 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV