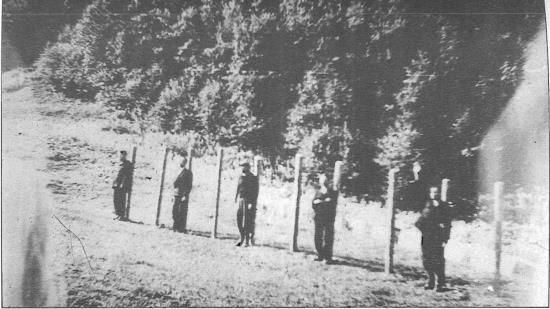La tradition et la révolution (par José Antonio de Rivera)
Traduction française extraite de La réponse de l’Espagne, textes choisis de José Antonio Primo de Rivera, Editorial Almena, 1964, p. 166-171.
Que nous assistions à la fin d’une époque est une chose que personne à moins qu’il n’ait des vues intéressées n’ose plus nier. L’époque qui agonise a été courte et brillante ; sa naissance peut se situer dans la troisième décennie du XVIIIe siècle, son moteur interne s’exprime peut-être en un mot : l’optimisme. Le XIXe siècle – qui se déroule sous les ombres tutélaires de Smith et de Rousseau – crut en effet qu’en laissant les choses à elles-mêmes, celles-ci donneraient les meilleurs résultats dans le domaine économique et dans le domaine politique. On espérait que le libre-échange, le libre jeu de l’économie laissée à sa spontanéité déterminerait un bien-être indéfiniment croissant. Et on supposait que le libéralisme politique, c’est-à-dire la dérogation à toute règle qui ne serait pas acceptée par le libre consentement de la majorité, amènerait des bienfaits insoupçonnés. Au début, les faits parurent donner raison à ces prophéties : le XIXe siècle connut une des périodes les plus énergiques, les plus joyeuses et les plus intéressantes de l’Histoire ; mais ces périodes ont été connues, dans une sphère plus réduite, par tous ceux qui se sont décidés à gaspiller la grande fortune dont ils disposaient héréditairement. Pour que le XIXe siècle pût se donner le plaisir de marcher la tête en bas, il avait fallu que des siècles et des siècles antérieurs accumulassent de grandes réserves de discipline, de dévouement et d’ordre. Peut-être que ce qu’on estimera comme la gloire du XIXe siècle sera, au contraire, l’exaltation posthume de ces siècles qui ressemblèrent le moins au XIXe siècle et sans lesquels le XIXe siècle n’aurait pas pu se payer le luxe d’exister.
Ce qui est certain c’est que l’éclat magnifique du libéralisme politique et économique dura peu de temps. Dans le domaine politique, cette irrévérence pour toute règle fixe, cette proclamation de la liberté de critique sans limites aboutit à un fait : au bout de quelques années, le monde ne crut plus à rien ; pas même au libéralisme lui-même qui lui avait appris à ne pas croire. Et dans le domaine économique, le progrès indéfini dont on rêvait tourna, un jour, la tête de façon inattendue et montra un visage crispé par les horreurs de la prolétarisation des masses, de la fermeture des usines, des récoltes qu’on jetait à la mer, du chômage, de la faim.
Ainsi, au XIXe siècle, surtout à partir de la guerre, l’âme s’emplit de la stupeur amère des désabusés. Les idoles, redevenues du plâtre dans des niches, n’inspiraient plus de foi ni de respect. Et d’autre part, il est si difficile quand on a déjà perdu la simplicité de revenir à la croyance en Dieu !
*
**
Rendre aux hommes l’ancienne saveur de la règle et du pain ; voilà la tâche de notre temps. Leur faire voir que la règle vaut plus que le déchaînement ; que même pour se déchaîner parfois il faut être sûr de pouvoir revenir à un point d’attache fixe. Et d’autre part, dans le domaine économique faire que l’homme remette les pieds sur la terre, le lier d’une manière plus profonde à ses choses : au foyer où il vit et à l’œuvre quotidienne de ses mains. Conçoit-on une forme plus féroce d’existence que celle du prolétaire qui vit peut-être pendant quatre lustres en fabriquant la même vis dans le même atelier immense sans jamais voir complet l’objet dont va faire partie cette vis et sans être lié à l’usine par autre chose que par la froideur inhumaine de la feuille de paye ?
Toutes les jeunesses conscientes de leur responsabilité s’efforcent de redresser le monde. Elles0 s’efforcent de prendre le chemin de l’action et, ce qui importe plus, celui de la pensée, sans la vigilance constante de laquelle l’action est barbarie pure. Nous, les hommes espagnols dont la jeunesse s’ouvrit au milieu des perplexités de l’après-guerre, nous pourrions mal nous soustraire à cette préoccupation. Notre Espagne se trouvait d’une part comme préservée de la crise universelle, d’autre part comme angoissée par sa propre crise, comme absente d’elle-même pour des raisons caractéristiques de déracinement qui n’étaient pas celles du reste du monde. Dans la conjoncture, certains espéraient trouver le remède en envoyant tout promener. (Cette idée de tout envoyer promener, quoi qu’il arrive, est une attitude caractéristique des époques fatiguées, dégénérées ; tout envoyer promener est plus facile que ramasser les morceaux, les recoller, séparer ce qui peut servir de ce qui est caduc… La paresse ne serait-elle pas la muse de beaucoup de révolutions ?) D’autres, avec une candeur risible, conseillaient en guise de remède le retour pur et simple aux antiques traditions comme si la tradition était un état et non un processus et comme si le miracle de revenir en arrière et de revenir à l’enfance était plus facile aux peuples qu’aux hommes.
Entre ces deux attitudes, il arriva à quelques-uns d’entre nous de se demander s’il ne serait pas possible d’arriver à une synthèse des deux choses : de la révolution – non comme prétexte pour envoyer tout promener, mais comme occasion d’une opération chirurgicale permettant de tout retracer d’une main ferme au service d’une règle – et de la tradition – non comme remède, mais comme substance, non avec le dessein de copier l’œuvre des grands ancêtres, mais avec l’espoir de deviner ce qu’ils feraient en de telles circonstances. La Phalange naquit. Ce fut le fruit de cette inquiétude de quelques-uns d’entre nous. Je doute qu’un mouvement politique soit venu au monde suivant un processus interne plus austère, suivant une élaboration plus sévère et avec un esprit de sacrifice plus réel de la part de ses fondateurs pour lesquels – qui va le savoir autant que moi ? – peu de choses sont plus amères que d’avoir à crier en public et à rougir de s’exhiber.
*
**
Mais comme tels ou tels modèles circulaient dans le monde et qu’un des traits caractéristiques de l’Espagnol est sa parfaite indifférence pour comprendre son prochain, rien ne put ressembler moins au sentiment dramatique de la Phalange que les interprétations qu’elle a fait fleurir autour d’elle dans l’esprit de ses amis et de ses ennemis. Depuis ceux qui sans ambages supposaient que nous étions une organisation destinée à distribuer des coups de trique jusqu’à ceux qui, avec plus d’allure intellectuelle, nous estimaient partisans de l’absorption de l’individu par l’État. Depuis ceux qui nous haïssaient comme les représentants de la réaction la plus noire jusqu’à ceux qui supposaient qu’ils nous aimaient beaucoup parce qu’ils voyaient en nous les futurs protecteurs de leurs digestions. Combien de stupidités n’aura-t-on pas dû lire et entendre sur notre mouvement ! Nous avons parcouru en vain l’Espagne en nous égosillant en discours. En vain nous avons édité des journaux. L’Espagnol, ferme dans ses premières conclusions infaillibles, nous refusait, même à titre d’aumône, ce que nous aurions estimé le plus : un peu d’attention.
Tout ceux qui comme nous sont venus au monde après des catastrophes comme celle de la Grande guerre et comme la crise, et après des événements comme la dictature et la République espagnole, sentent, ce qui est latent en Espagne, le besoin dont chaque jour réclame avec plus d’insistance la réalisation au grand jour – et je le soutins ici l’autre nuit – d’une révolution. Cette révolution a deux veines : la veine d’une justice sociale profonde et qu’il n’y a pas d’autre remède que d’implanter et la veine d’un sentiment traditionnel profond, d’une moelle traditionnelle espagnole qui peut-être ne réside pas où beaucoup de gens le pensent et qu’il faut à tout prix rajeunir.





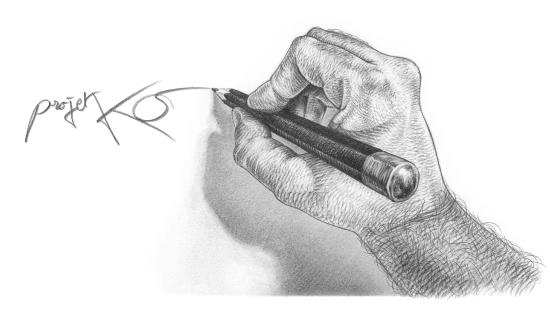


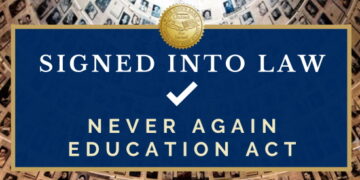














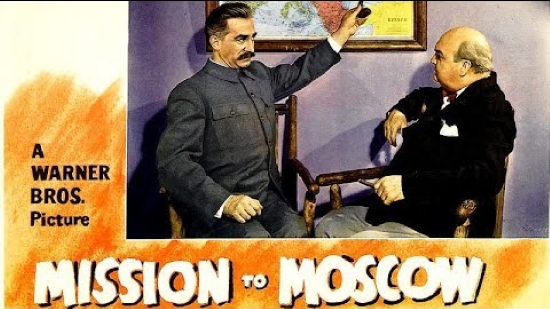



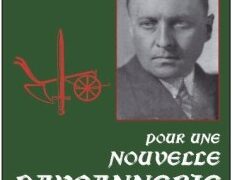


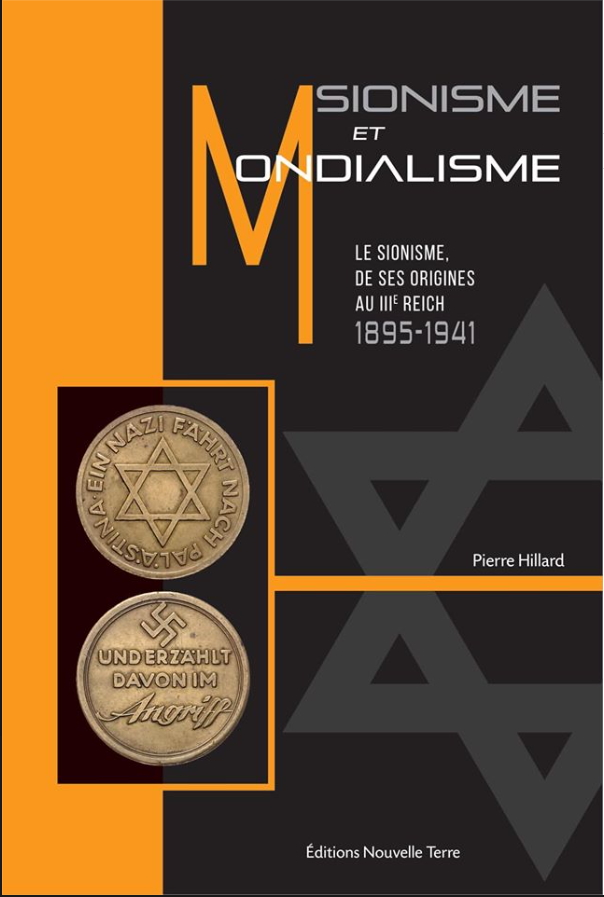
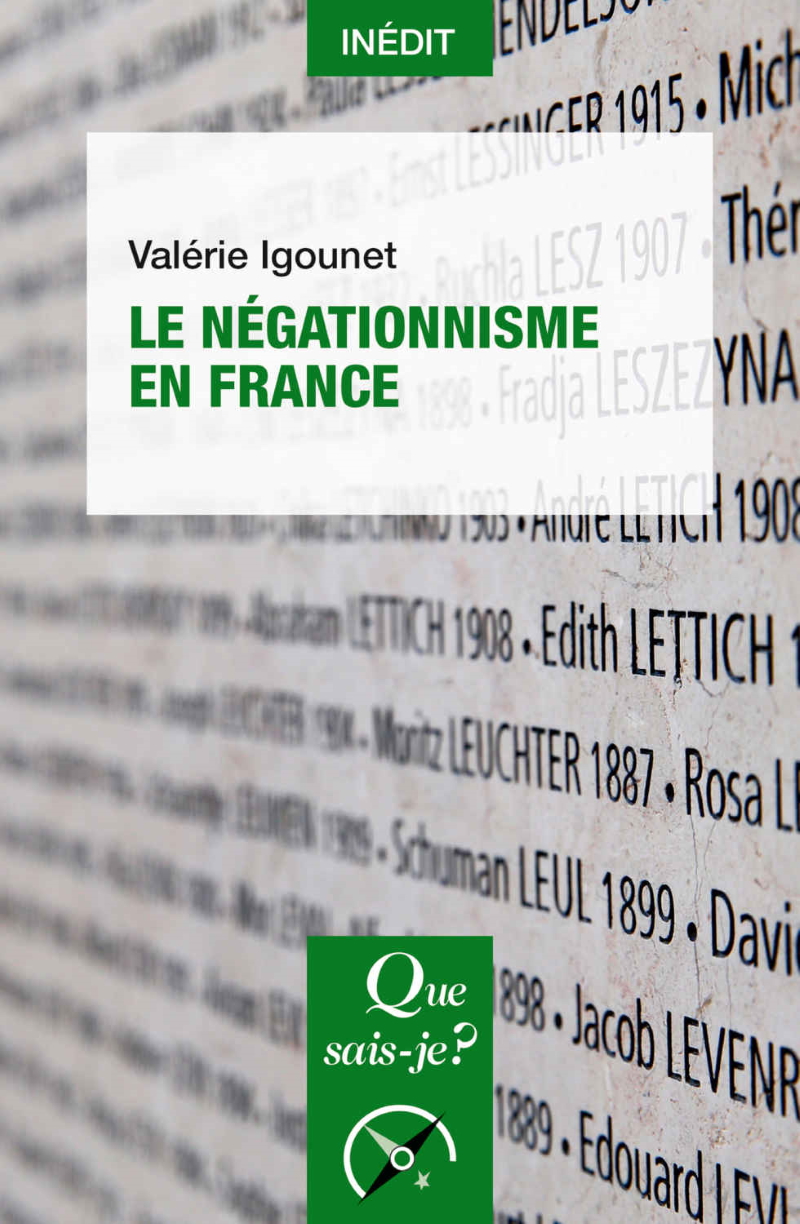



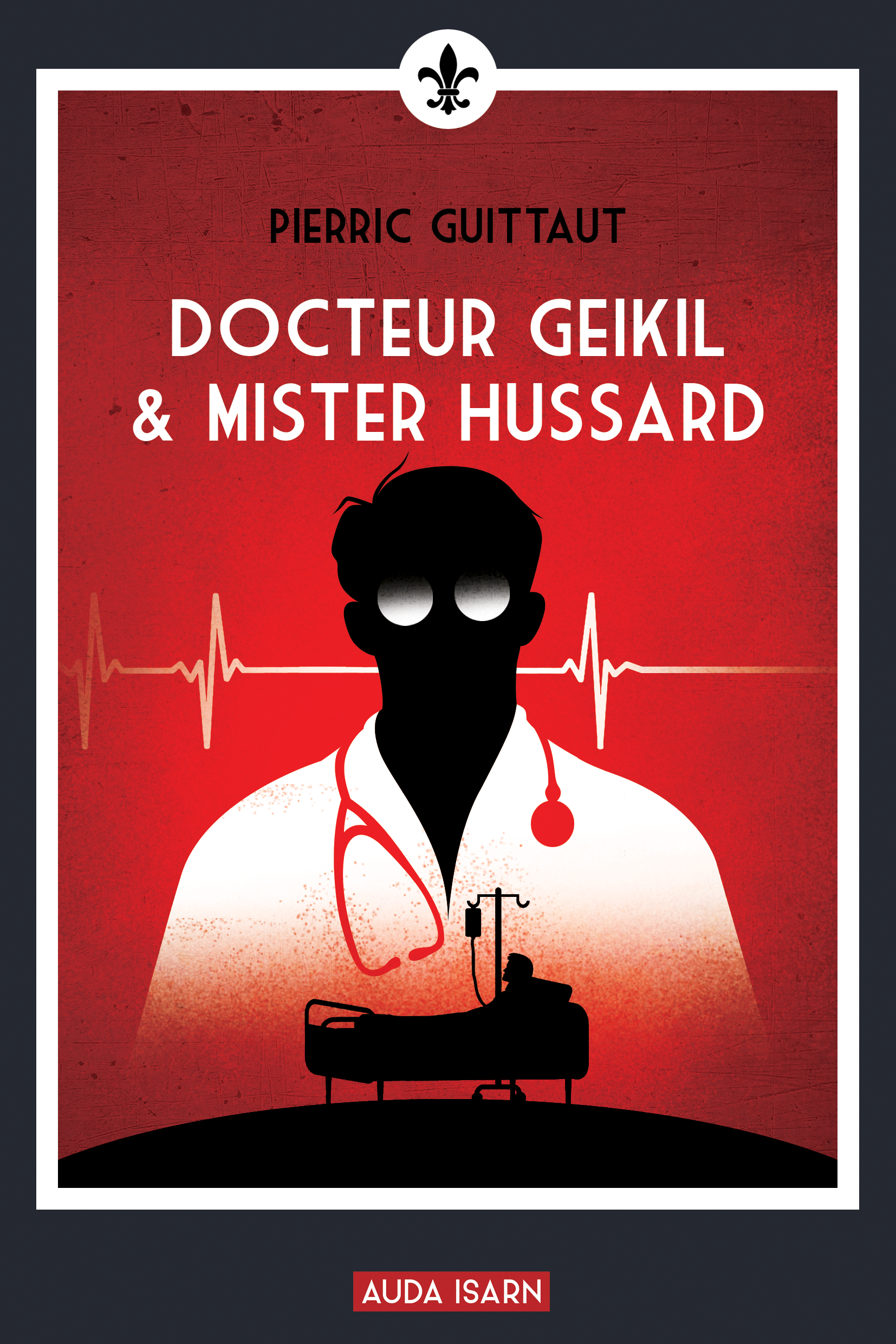









 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV