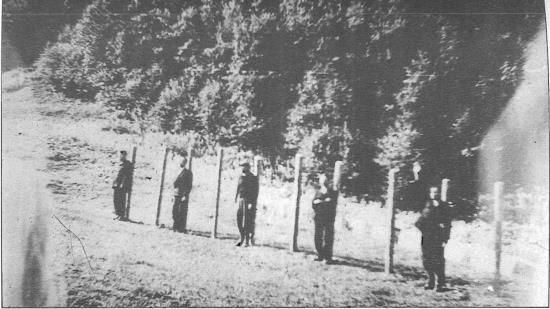Adriano Tilgher et l’histoire en tant que chaos (par S. Gerbert)
Malgré la réédition des deux essais La philosophie de Léopardi et Marxisme, socialisme et bourgeoisie aux éditions Boni, le nom d’Adriano Tilgher ne figure pas parmi ceux des auteurs que l’actuelle culture dominante a redécouverts et étudiés de son point de vue. Sa pensée, à part peut-être ce qui concerne ses articles de critique théâtrale, est restée en dehors du débat culturel de ces dernières années. Même le remue-ménage causé par le retour des maîtres de ce que l’on a appelé « la pensée négative » a été impuissant à le tirer de l’oubli, alors qu’en ce domaine Tilgher a écrit des pages capitales.
Tilgher, né à Résina, près de Naples, le 8 janvier 1887, se consacra très tôt, après des études de Droit, au journalisme et à l’essai. Avec Rensi, Giusso, Aliotta et Evola, il fut une des personnalités les plus marquantes du mouvement culturel qui, au début du siècle, se développa en marge du monde académique ou universitaire. Pour qualifier ce mouvement, les étiquettes ne manquent pas : relativisme, irrationalisme, scepticisme, mysticisme, pessimisme…
En fait, il resta profondément déçu de ses premiers contacts avec le néo-idéalisme italien. Il se mit alors à étudier un certain nombre d’auteurs qui se révélèrent rapidement beaucoup plus proches de son tempérament : Friedrich Nietzsche, José Ortega y Gasset, Oswald Spengler, Georg Simmel, Hans Vaihinger. Il s’agit là en fait des chefs de file de cette Lebensphilosophie, ou « philosophie de la vie » qu’il n’est pas aisé de définir autrement que d’une manière approximative. Globalement, il s’agit de toutes ces positions philosophiques qui, quoique souvent sans autre point commun, tendaient à réaffirmer la profonde relation qui doit toujours exister entre la vie et la pensée – l’une et l’autre vues dans leur essentialité concrète et non pas à travers les œillères d’une abstraite raison spéculative.
Selon Eugenio Garin, trois directions caractérisent la pensée tilghérienne : un « scepticisme théorique », un « relativisme moral », un « antifinalisme historique ». De son côté, Lorenzo Giusso relève essentiellement deux points : l’anti-historicisme, niant toute loi immanente du devenir historique, et le vitalisme, affirmant cette religion de l’action qui serait « la mystique de notre temps ». En fait, quand on étudie l’œuvre de Tilgher, on peut dire que l’un et l’autre ont raison mais s’il fallait indiquer où trouver l’essentiel de sa pensée, c’est à l’ouvrage Les relativistes contemporains qu’il faudrait se référer tout particulièrement.
Dans cette œuvre, l’introduction due à Mario Missiroli n’est pas la moins intéressante : « L’expérience de la guerre », écrivait-il « a jeté bas les idéologies et, plus encore, les habitudes mentales… La guerre mondiale a ruiné l’idéologie du progrès conçue comme une succession lente et ordonnée d’événements et d’institutions… elle a détruit cette conception bourgeoise, réformiste et évolutionniste du monde et de la vie, de l’action et de l’histoire. À la “rationalité”, qui fut la religion du siècle précédent, semble succéder peu à peu l’irrationnel »… Toujours à propos de l’histoire, il ajoute : « La vieille philosophie de l’histoire nous présentait le monde pratiquement pré-ordonné par une mystérieuse volonté qui dévorait en silence ses propres enfants, un monde où peu à peu les antagonismes se rejoignaient dans un devenir perpétuel qui obéissait à une logique originelle ».
Ce livre comprend une série de portraits d’un certain nombre de penseurs relativistes tels que Hans Vaihinger, théoricien de la philosophie du « comme si », le physicien Albert Einstein, les philosophes Oswald Spengler et Louis Rougier, ainsi que deux essais intitulés Actualisme idéaliste et Relativisme et Révolution.
Pour Tilgher, le relativisme a surtout rendu vaine cette prétention de la pensée de pouvoir être un miroir dans laquelle se refléterait, immuable, une réalité extérieure à nous ; en d’autres termes, la pensée n’est nullement en mesure de refléter l’objectivité de la réalité extérieure : c’est au contraire l’hypothèse même d’une telle objectivité qui, en fin de compte, perd toute signification.
Ce qu’enseigne Vaihinger, c’est que la pensée s’articule en symboles, catégories et fictions privées de toute correspondance objective avec la réalité : la pensée est une fiction qui, toute utile qu’elle soit, demeure toujours une fiction. La pensée vaut « comme si » la réalité qu’elle exprime était précisément celle qu’elle décrit, alors qu’en réalité elle n’est rien d’autre qu’une « forme » arbitraire de l’ordre des choses et, plus simplement, « une fonction biologique, un moyen de s’orienter dans la vie, pour la conserver et l’enrichir, pour rendre possible et faciliter l’action, pour prendre en compte la réalité et s’en rendre maître ». En outre, si la théorie einsteinienne s’est attachée à établir que « tout dépend du système de coordonnées choisi par l’observateur… et qu’en aucun cas celui-ci ne peut absolutiser le système dont il s’est servi », l’offensive menée par Louis Rougier et Oswald Spengler, d’une part contre « l’idolâtrie d’une Raison universelle » et d’autre part contre la conception d’un sens unique de l’histoire universelle, cette offensive substitue à la théorie d’Einstein une multiplicité d’univers historico-culturels reposant sur des intuitions distinctes du monde primordial.
Par ailleurs, Tilgher fait l’éloge de l’actualisme de Gentile (sur lequel il portera plus tard un jugement très critique) pour avoir exalté « l’acte pur de la pensée pensante » niant l’existence d’une « réalité objective en soi, préexistant à l’acte de l’esprit qui la pose comme objet » et démolissant « cette conception de la vérité en tant qu’adéquation de l’esprit avec ce qui est en dehors de lui ».
Mais ce n’est pas tout : selon Tilgher, un autre a priori de la culture philosophique a également mordu la poussière, celui de l’unicité du Moi. Le Moi n’est plus rien d’autre que cette notion pirandellienne d’un Moi « qui croit être un, alors qu’il est au contraire un rien à la puissance mille ».
On peut sans conteste affirmer que le relativisme de Tilgher visa tout d’abord l’idéologie « historiciste ». En effet, celui-ci fit la critique de l’optimisme mêlé de fatalisme d’une telle philosophie de l’histoire et de sa « tendance à lire dans l’histoire une marche lente et graduelle vers un mieux ».
La remise en cause générale qui suivit le traumatisme de la Première Guerre mondiale – en mettant à nu l’ingénuité d’une telle vision idyllique de l’histoire, supposée animée d’une rationalité intrinsèque – contribua sans aucun doute à l’anti-historicisme de Tilgher. « La guerre » écrivait-il « avait désormais jeté bas l’idole d’une histoire conçue comme une progression univoque, lente, inconsciente et ininterrompue vers un mieux ». Mais avant celle de l’histoire, l’idole de la science, conçue de manière positiviste, s’était elle aussi écroulée, elle qui avait la prétention de fournir des vérités intangibles et éternelles au nom d’une supposée connaissance objective.
Tout comme le scepticisme de Rensi, le relativisme tilghérien est fortement teinté d’irrationalisme ; celui-ci est au cœur même de l’existence mais non pas, pourrait-on dire, en tant que donnée absolue et définitive : il n’est qu’un nécessaire postulat destiné à rationaliser ce qui est, en soi, irrationnel. Comme l’a bien noté Sciacca, quand on lit Tilgher, « on a l’impression, non d’un irrationaliste résigné mais de quelqu’un qui espère et lutte pour donner un sens à l’existence. La vie nous présente une infinité d’éléments épars d’où il est possible de dégager une perspective déterminée qui leur donne une signification globale ».
Dans le droit fil de ses intuitions fondamentales, la pensée tilghérienne soutient qu’il ne saurait exister une version unique de l’impératif moral mais bien plutôt un pluralisme de morales qui correspondent aux divers codes éthiques, aux si nombreux styles de vie et conceptions du monde, difficilement réductibles entre eux.
Comme l’écrivit Renato Lazzarini, « pour Tilgher il n’existe pas de science morale unique mais un pluralisme de morales particulières qui émergent du pur chaos en vertu d’une initiative à la fois créatrice de valeurs et à la fois résultant de coïncidences fortuites ».
Sur le plan politique, Tilgher ne parvint pas à reconnaître dans l’idéologie originelle du Fascisme toutes les composantes vitalistes, relativistes et volontaristes qu’elle contenait et qui se feront encore sentir dans La doctrine du Fascisme dont la résonance est, sans équivoque, gentilienne. D’ailleurs, n’est-ce pas Tilgher lui-même qui a défini le Fascisme comme « l’activisme absolu transplanté sur le terrain de la politique » ? Et ce n’est pas par hasard que Mussolini, dans une recension du Popolo d’Italia du 22 novembre 1922 de l’ouvrage Les relativistes contemporains – qui contenait précisément cette définition – déclara : « Cette définition est tout à fait exacte… Le Fascisme a été un mouvement super-relativiste car il n’a jamais cherché à se donner une présentation définitive en accord avec ses complexes et puissants états d’âme mais a procédé par intuitions fragmentaires… Tout ce que j’ai pu dire et faire ces dernières années a été du relativisme intuitif… si Tilgher avait suivi de près, quotidiennement, l’œuvre du Fascisme… je dis sans la moindre vanité qu’il m’aurait compté, sinon parmi les théoriciens du relativisme, du moins parmi ses praticiens »…
D’une façon un peu paradoxale, après avoir versé tant d’encre contre l’historicisme, Tilgher finit par adhérer au Manifeste des intellectuels antifascistes rédigé par ce champion de l’historicisme que fut Benedetto Croce.
(Extrait de Linea, juin 1981).





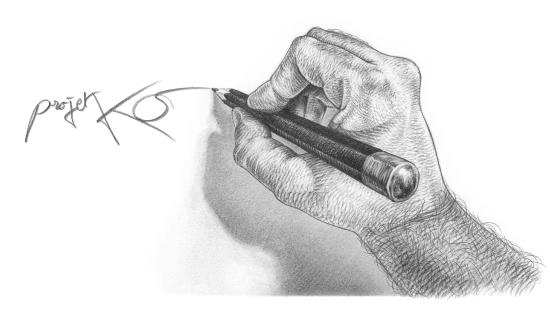


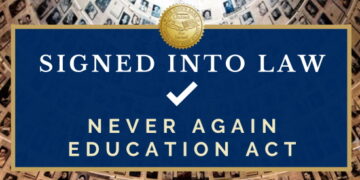














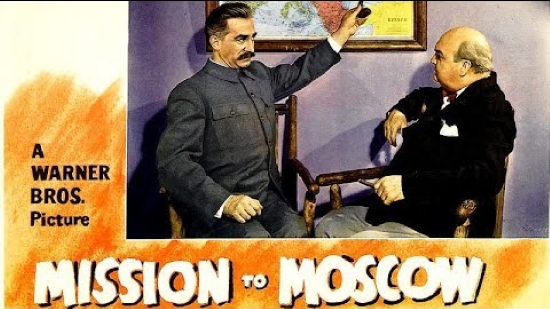



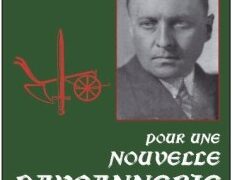


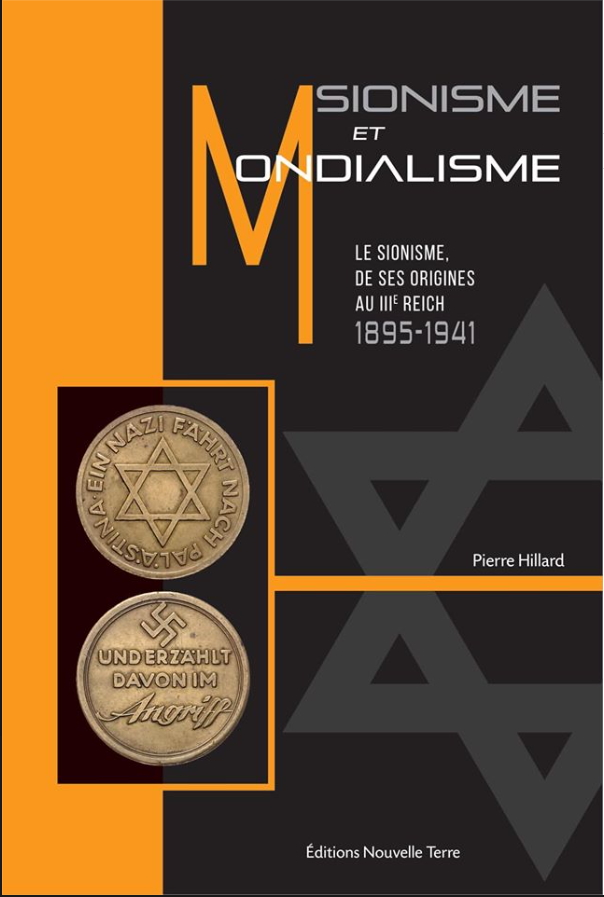
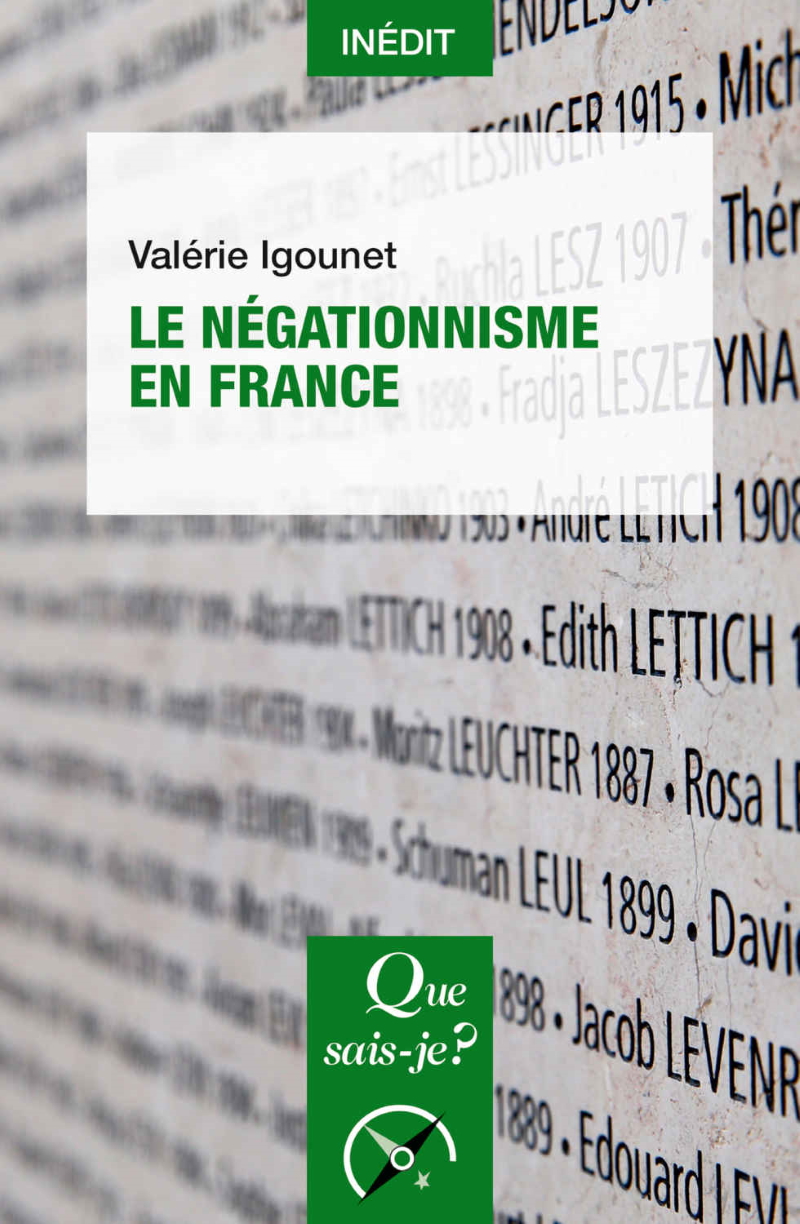



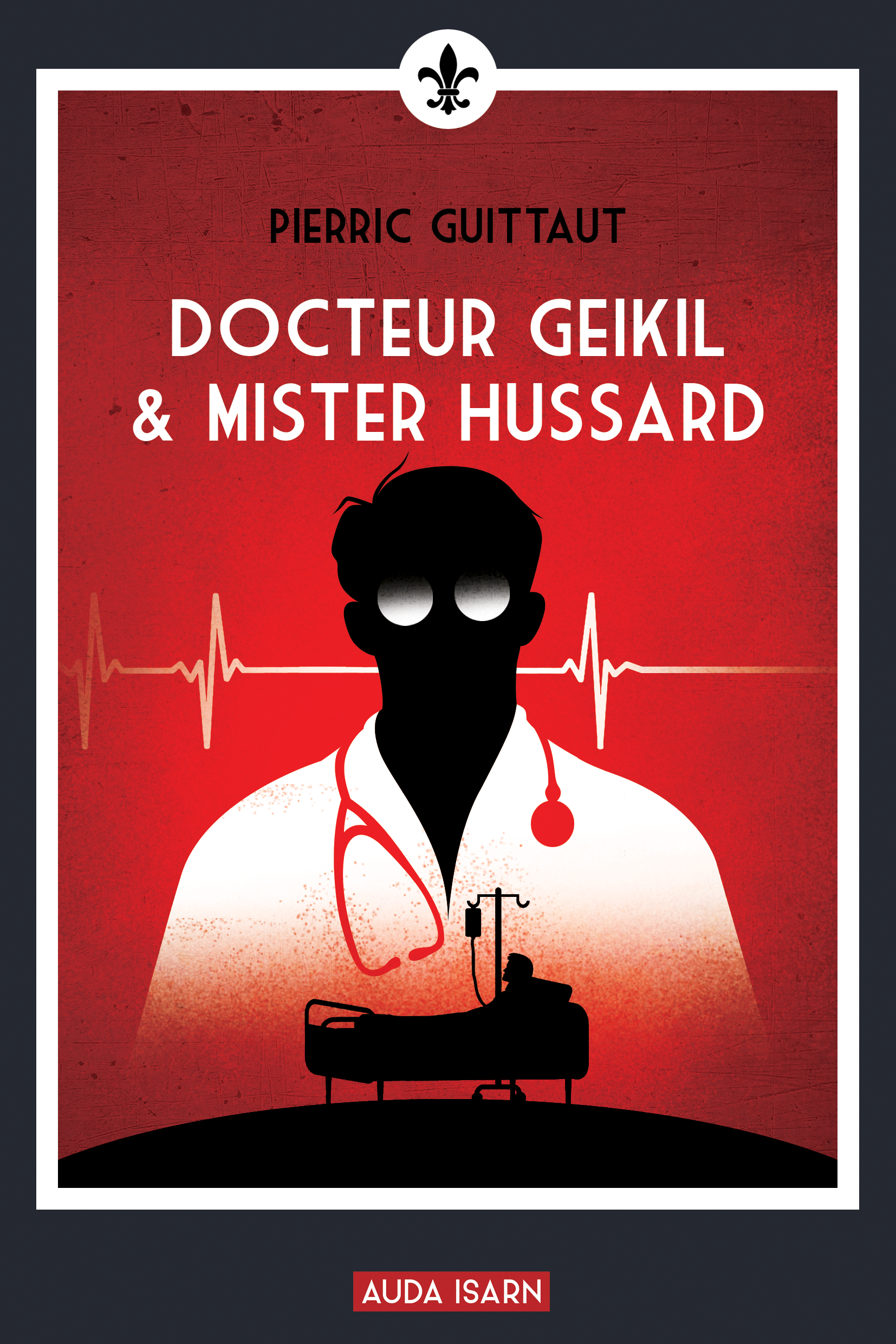









 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV